Sans aucun doute, l’allocution du premier ministre canadien était bien écrite, bien rendue, courageuse et empreinte de réalisme; ou de pragmatisme, comme il le dit souvent. Il a dit tout haut ce que beaucoup de chefs d’État semblent avoir de la difficulté à comprendre ou à accepter – du moins en public. Soit qu’il n’y a plus de grandes puissances économiques qui travaillent dans un esprit de collaboration.
Il ne faut cependant pas oublier où et devant qui ce discours a été fait. Le Forum économique mondial de Davos est une conférence sur le développement économique. Des milliers de chefs et cheffes d’État et d’entreprises y sont invités pour échanger sur la «croissance, la résilience et l’innovation», est-il écrit sur le site du Forum (traduction libre).
Les phrases coup de poing et les envolées lyriques de Mark Carney créaient une carte au trésor où le «X» était mis en évidence. S’il a peint l’image d’un monde où les relations internationales sont en pleine rupture et que les grandes puissances imposent l’instabilité, c’était pour mieux présenter le Canada comme un pays stable, fiable, où il est prudent d’investir.
À lire aussi : Commerce interprovincial : le Canada avance, tarifs ou non
Entre les constats politiques, il y avait plusieurs listes sur ce que le Canada a, ce que le Canada est. Le terme «we have» («nous avons») revient neuf fois dans le discours. Le terme «we are» («nous sommes») revient 18 fois en lien avec ce que le Canada fait ou représente.
Qu’est-ce que «nous avons», selon Mark Carney? Des baisses d’impôts, des ententes stratégiques existantes, la population la plus éduquée du monde, des capitaux, du talent et un gouvernement prêt et capable d’agir de façon décisive. Surtout, le «Canada a ce que le monde veut».
Ce que «nous sommes», toujours selon le discours? Une superpuissance énergétique, un pays qui collabore déjà avec les autres pays de la planète et qui entend poursuivre sur cette lancée. Et surtout, «un partenaire stable – dans un monde qui est tout sauf stable – qui construit et apprécie les relations à long terme».
Cette liste, qui présente l’économie canadienne de façon favorable, est avant tout un argument de vente destiné aux investisseurs et aux élus et élues assis dans la salle devant lui. Ce n’est pas un appel à la résistance.
Il vaut la peine de le répéter : il a fait le portrait d’un Canada clairement défini dans l’image d’un monde flou et imprévisible.
Son invitation à collaborer entre pays de taille moyenne plutôt que de construire chacun sa forteresse joue le même rôle : inclure le Canada dans la grande forteresse en investissant dans nos ressources naturelles.
À lire aussi : L’Afrique est-elle une alternative viable aux États-Unis pour le Canada?
Les hommes et les femmes d’affaires ont très probablement décelé ce discours dans le discours. Le directeur général des politiques économiques et énergétiques au Forum des politiques publiques du Canada, Jay Khosla, confirme l’intention de l’allocution dans un article de la Presse canadienne. Il dit que «M. Carney semble présenter le Canada comme un pays “en pleine croissance économique”».
Il ajoute qu’il aurait aimé que le premier ministre parle davantage des mesures d’accélération des projets nationaux. Des projets qui pourraient stimuler les investissements.
Ce que Mark Carney a dit dans son allocution, tous ceux et celles qui suivent de plus ou moins près la politique canadienne l’avaient déjà entendu. L’idée de ne plus se fier aux États-Unis, d’élargir les partenariats économiques, de regarder ailleurs, de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, l’électorat canadien connait cette vision. Le premier ministre l’a simplement présentée au reste du monde économique.
C’était donc un discours plus économique que politique, avec une dose de pragmatisme…
Les médias comptent parmi les indicateurs de vitalité qui reviennent le plus souvent dans les «exemples de questions pouvant servir à décrire l’état de la situation» de Patrimoine canadien. Plus souvent que «bilinguisme», «association», «évènement», «écoles», «garderie» ou «postsecondaires».
La présence de médias de langue officielle en situation minoritaire (MLOSM) permet de voir facilement si la communauté est culturellement active, si la langue minoritaire y est bien visible et d’évaluer ses relations avec les autres communautés linguistiques.
Les communautés de langue officielle en situation minoritaire doivent donc trouver une façon de participer activement à leur maintien et à leur dynamisme, tout en respectant leur indépendance.
À lire aussi : Les journaux francophones après un an de blocage de Meta

Les médias de langue minoritaire ont réfléchi à leur avenir en compagnie d’autres intervenants lors d’un forum en septembre à Ottawa.
Le constat que les communautés doivent s’engager dans la sauvegarde de leurs journaux et de leurs radios reste l’un des points les plus audacieux du Livre blanc : Vérités, défis, occasions à saisir et pistes d’avenir, produit par le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire. Il s’agit aussi de l’un des plus complexes.
On parle depuis longtemps de la responsabilité du gouvernement fédéral, mais le rôle des communautés elles-mêmes est souvent passé sous silence. Elles sont pourtant les premières à utiliser leurs médias.
Cependant, les journaux n’ont pas le devoir de seulement présenter le bon côté des choses. Ils doivent aussi dire quand les choses vont mal. L’incompréhension du rôle de chaque partie peut mettre du plomb dans l’aile d’une collaboration. Si les rôles sont bien compris et que les canaux de communications sont bien établis, la coopération est possible.
Pour bien comprendre les défis qui attendent les MLOSM, les communautés doivent savoir qu’une grande partie des solutions que trouvent les grands médias écrits pour assurer leur survie sont peu ou pas transférables aux MLOSM.
Préserver les médias communautaires est un défi de taille dans l’environnement actuel. Si les communautés veulent leur venir en aide, elles doivent comprendre qu’une grande partie des solutions développées par et pour les grands médias écrits sont peu ou pas transférables aux MLOSM. Ces derniers doivent donc innover encore plus, avec moins de ressources que les autres.
La plus grande limite peut être comprise avec les mathématiques les plus élémentaires : le nombre de francophones.
Comme le souligne le Livre blanc :
Les retombées financières demeurent insuffisantes pour que les canaux numériques assurent une source de revenus viable, capable de soutenir adéquatement les salles de rédaction ou le fonctionnement des médias.
La raison en est simple : les modèles publicitaires du Web ont été créés à partir de la possibilité de rejoindre des centaines de milliers de personnes. Aucun MLOSM n’a un lectorat potentiel assez vaste pour que le modèle publicitaire imposé par les grandes entreprises numériques des États-Unis soit rentable.
Et si les réseaux sociaux – ceux qui sont encore accessibles au Canada pour les médias – restent une bonne façon de rejoindre un public, surtout plus jeune, ils n’ouvrent pas la porte directement aux revenus.
La solution se trouve donc bien plus près des médias et de leurs communautés. À quels besoins non comblés le journal pourrait-il répondre? Quels canaux de communication peuvent renforcer le lien avec la communauté et rendre le média plus pertinent et intéressant?
On ne peut pas accuser le gouvernement fédéral de se croiser les bras. Plusieurs mesures de financement visent les MLOSM. Mais il donne parfois l’impression d’offrir d’une main et prendre de l’autre.
L’initiative de journalisme local permet aux médias de payer des journalistes. Par contre, la Loi sur les nouvelles en ligne ne leur offre pas de statut spécial et les critères sont trop restrictifs pour que plusieurs puissent en bénéficier.
Tous les médias ont besoin d’un gouvernement plus cohérent dans ses interventions pour protéger le système médiatique canadien. Ça peut commencer par le retrait du crédit d’impôt à l’achat de publicité en ligne sur des plateformes étrangère.
À lire aussi : Faut-il remercier Google d’avoir demandé une exemption? (Éditorial)
Le 28 septembre est la Journée internationale de l’accès universel à l’information, qui a été proclamée par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en 2015.
À l’échelle internationale, elle est présentée comme une invitation à la transparence des gouvernements afin de promouvoir l’inclusivité et la confiance.
Cependant, alors que l’information de piètre qualité, la désinformation et la mésinformation produites par l’intelligence artificielle envahissent le Web, le concept de droit à l’information – il faudrait peut-être commencer à dire «droit à de l’information digne de confiance» – doit dépasser les gouvernements.
Ce concept doit inspirer toutes les agences publiques, toutes les institutions et les entreprises qui ont la capacité d’influencer la société. Toutes les personnes qui ont le droit de voter doivent aussi s’en préoccuper sérieusement.
À lire : Une «tempête parfaite» pour la désinformation électorale
Le Canada est l’un des pionniers en matière de transparence de l’information. En 1983, il est devenu le cinquième pays a adopté une telle loi. Quarante-deux ans plus tard, elle a grandement besoin d’un coup de modernité.
Le 20 juin, le gouvernement du Canada a lancé l’examen de 2025 de la Loi sur l’accès à l’information. Une démarche obligatoire puisque, depuis 2019, un nouvel article ajouté à cette loi exige qu’elle soit révisée tous les cinq ans.
Justement, pendant sa campagne électorale du printemps, l’actuel premier ministre, Mark Carney, a promis un «examen objectif» de la loi.
Les médias et le Commissariat à l’information du Canada font la liste des ratés de la Loi sur l’accès à l’information depuis plusieurs années.
Dans des lettres au premier ministre et au ministre du Conseil du Trésor, la commissaire Caroline Maynard écrit : «Depuis que je suis devenue Commissaire à l’information en 2018, j’ai constaté un déclin constant du système d’accès à l’information, à un point tel qu’il n’atteint plus son but : permettre l’accès à l’information qui peut et doit être communiquée.»
La commissaire dit avoir remarqué que les institutions fédérales se préoccupent avant tout de ce que la loi leur permet de cacher, plutôt que de l’information qui doit être communiquée.
Le système fonctionne en quelque sorte à l’envers : vous devez demander d’avoir accès à une information publique.
Dans la mesure du possible, ces informations devraient être accessibles par défaut et non cachées derrière une bureaucratie qui cherche à garder des secrets. Dès qu’un mémo est lancé, dès qu’une lettre en envoyée, dès qu’un tableau est monté, ils devraient être rendus publics.
C’est ce qu’une loi remaniée devrait chercher à faire. Les technologies actuelles pourraient le permettre. Une telle transparence ne convaincra peut-être pas les ultrasceptiques, mais elle empêchera peut-être des personnes de le devenir.
À lire : Les francophones en milieu minoritaire, orphelins de données
Lisez notre infolettre
les mercredis et samedis
Du côté des médias, la discussion sur la transparence est entamée depuis quelques années. Des initiatives comme le Trust Project et la Journalism Trust Initiative sont nées du besoin de transparence dans la production de l’information.
Au tour du public de prendre ses responsabilités. La méfiance aveugle n’est pas plus productive que la confiance aveugle. Remettez en question ce que les campagnes de markéting, les médias et les influenceurs et influenceuses livrent comme information de la même façon que vous remettez en question les annonces gouvernementales.
Ne vous fiez pas seulement à ce qu’une source vous donne comme information pour construire votre opinion. Surtout si cette source ne contredit pas votre point de vue.
Tentez d’absorber le plus d’informations et de perspectives que possible pour élever le niveau de transparence des informations que vous avez et, ainsi, renforcer votre objectivité et votre prise de décisions.
Garantir l’accès à l’information est la partie la plus facile. Ce qui est plus difficile, c’est de regagner la confiance de la part de la population qui ne veut plus croire les autorités gouvernementales et ses représentants ainsi que la science et les preuves qu’elle apporte.
Il était déjà trop facile de remettre en doute la véracité d’une information ou d’une image. Ça se voit dans les cercles conspirationnistes. Par exemple, les personnes qui croient que la terre est plate déclareront instantanément qu’une photo ou une vidéo leur montrant que la terre est ronde ou que l’espace existe «a été créée de toutes pièces par ordinateur».
Les outils d’intelligence artificielle (IA) rendent cette excuse de plus en plus facile à utiliser pour les sceptiques. Sans garde-fou, sans règle d’utilisation et sans balise pour l’IA, le phénomène ne fera que s’accentuer.
Les notions de vérité et de réalité sont pourtant centrales à la recherche du droit à l’information. En tant que société, nous devons retrouver la façon de vivre dans la même réalité.
La transparence ne suffira malheureusement plus comme gage de confiance. Mais elle doit être le point de départ.
On peut débattre de la pertinence du terme «épidémie» dans les circonstances, mais on ne peut ignorer que beaucoup de personnes – de tous les âges – souffrent de solitude.
Selon Statistique Canada, à la fin de l’année 2024, 13,4 % des personnes déclaraient se sentir seules presque tout le temps; 36,9 % parfois seules. Des chiffres très similaires à ceux de la fin de l’année 2021, au cœur de la pandémie de COVID-19.
Les géants derrière les outils de génération de textes – ou les outils d’intelligence artificielle (IA), si vous préférez – ont flairé la belle affaire et arrivent en sauveurs avec une solution à ce problème sociétal.
Des thérapeutes sont accessibles instantanément à partir de votre clavier ou de votre micro. Le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, veut même que l’IA s’insère dans votre fil Facebook, comme un nouvel ami que vous n’avez jamais rencontré.
Les besoins sont tellement grands qu’il est difficile de ne pas voir la panacée dans cette solution fourretout. Et elle a certains mérites. Il y a des personnes qui bénéficient de l’appui psychologique fourni par une simple conversation où elles se sentent écoutées et soutenues.
Mais comme d’habitude, les promoteurs de ces remèdes miracles ne vous indiquent pas les contrindications.
La solitude n’est pas considérée comme un problème de santé mentale, mais elle a des effets négatifs sur celle-ci qui sont connus.
Une personne seule court davantage de risques de se retrouver avec des troubles de dépendance, de comportements antisociaux ou de dépression. Chez les personnes âgées, on a observé une augmentation du risque de démence.
À lire aussi : Vaincre la solitude des immigrants âgés par la langue
Les générateurs de textes et les robots conversationnels ont tendance à offrir des réponses qui feront plaisir à la personne qui les interroge. Ils peuvent également se tromper et inventer des solutions inefficaces. Du point de vue de la santé mentale, ces suggestions peuvent même être dangereuses.
Récemment, un homme de 60 ans s’est retrouvé à l’hôpital, victime d’un empoisonnement au bromure. ChatGPT lui avait suggéré de remplacer le sel (ou sodium) dans son alimentation par du bromure de sodium – plus proche parent des nettoyants que du sel de table.
Dans un autre cas, un homme de 76 ans a répondu à l’invitation d’une interlocutrice virtuelle – donc un robot conversationnel – qui lui avait donné rendez-vous à une adresse fictive. Il s’est blessé en chemin et est décédé, selon Reuters.
Ces cas extrêmes ne sont pas la norme, mais ils illustrent le manque d’empathie réelle de ces machines et les risques encore largement inconnus lorsqu’elles sont utilisées pour jouer avec les émotions humaines. Les psychologues ne nient pas leur utilité, mais font plusieurs mises en garde.
Les journalistes Kashmeer Hill et Dylan Freedman ont montré que la tendance à flatter dans le sens du poil pousse des outils d’IA à renforcer les affirmations faites par l’internaute, peu importe leur niveau de véracité.
À noter : L’équipe d’OpenAI a tenté d’éliminer cette tendance de ChatGPT avec le lancement de la version 5. Elle a été confrontée à une vague de messages comparant ce changement à un deuil ou à une peine d’amour. Elle a en partie fait marche arrière.
Si des internautes sont si attachés à un outil de génération de texte, c’est parce que le besoin de connexion est là et bien réel. Il ne faut pas minimiser cette partie de l’équation.
Par contre, un réseau social en ligne qui offre une solution à l’isolement social est la définition même d’un paradoxe.
Le modèle d’affaire des réseaux sociaux, rappelons-le, consiste à nous garder captifs. Mark Zuckerberg veut que nous restions sur Instagram le plus longtemps possible – loin des interactions en personne. Offrir des amitiés virtuelles n’est qu’une façon d’isoler davantage une personne seule.
Bien qu’il existe bien sûr des communautés accueillantes sur Internet, tout ce qui est offert en ligne n’est pas nécessairement bon pour tout le monde.
Des études publiées dans les revues Group Processing and Intergroup Relations en 2020, Sage Journal en 2021 et Political Psychology en 2022 arrivent à des conclusions similaires : la solitude et l’exclusion sociale font partie des principaux facteurs menant à l’adoption de points de vue extrémistes.
La solution ultime se trouve dans l’vrai monde.
Côtoyer davantage de gens en personne permet de développer davantage ses habiletés sociales, son empathie, sa capacité à socialiser et à entretenir des conversations sans en arriver aux injures.
Une personne âgée qui s’ennuie dans une maison de retraite a davantage besoin d’un humain pour l’écouter, discuter ou jouer aux cartes avec elle que d’une machine qui se fait l’écho de ses pensées.
Faites du bénévolat. Participez aux activités de la francophonie. Inscrivez-vous à des cours. Vous pourriez aussi y rencontrer de nouveaux amis qui vous veulent du bien.
À lire aussi : Intelligence artificielle : les véritables enjeux au-delà des craintes
Presque tous les médias se demandent en ce moment comment utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour maximiser l’efficacité de leur fonctionnement. De quelle façon peut-elle servir à améliorer la couverture médiatique, à accélérer le travail, à accroitre l’auditoire et à augmenter les revenus?
Or, il est impossible de se poser ces questions en faisant fi du fait que cette technologie existe grâce aux contenus qu’elle a volés, que ses immenses centres de données polluent énormément et que les hallucinations qu’elle génère donnent l’impression qu’elle est alimentée aux champignons magiques.
Pour les médias en milieu minoritaire, un défi s’ajoute. La performance des grands modèles de langage (GML) – les ChatGPT, Gemini et Claude de ce monde qui peuvent produire des textes – est supérieure lorsqu’ils ont été entrainés à partir d’une grande quantité d’information.
L’information qui existe sur le Web concernant les communautés francophones en milieu minoritaire est cependant loin de répondre aux critères de ce qui constitue une «grande quantité d’information».
Les GML sont plus performants maintenant qu’ils peuvent parcourir le Web et voler du contenu en temps réel. Malgré cela, ChatGPT a répondu à une requête toute récente que Michel Ouellette avait fondé le Théâtre du Nouvel-Ontario de Sudbury, en Ontario.
Pourtant, en 1971, année de fondation du Théâtre, Michel Ouellette avait 10 ans et vivait à Smooth Rock Falls, à 400 km au nord de Sudbury.
En toute transparence : d’autres GML à qui la même requête a été soumise ont fourni une bonne réponse, soit que le Théâtre a été fondé par un collectif de jeune issu de l’Université Laurentienne, dont André Paiement. L’un des modèles interrogés précise même avoir pris de l’information auprès de sources fiables, comme Francopresse…
À lire : Intelligence artificielle : les véritables enjeux au-delà des craintes
Chaque média doit trouver la limite qu’il ne veut pas franchir quant à la production de contenu et l’expliquer à ses lecteurs et ses lectrices.
Les nouvelles technologies ont de tout temps modifié le travail des journalistes. L’IA aura aussi un effet. Quelques outils permettent déjà d’économiser du temps pour résumer des documents ou retranscrire des entrevues audios, par exemple.
Mais ces outils et les GML ne changent pas l’un des principes de base du journalisme : parler de l’expérience humaine en connexion avec la société dans laquelle nous évoluons.
Les GML peuvent écrire rapidement et avec précision la description d’un match de hockey, déchiffrer un rapport de police ou résumer un rapport économique. Ils ne peuvent cependant pas interroger des spécialistes et des gens lors d’un évènement.
La francophonie minoritaire a survécu parce que les êtres humains qui la composent se sont serré les coudes. Ils ont crié pour dénoncer les injustices, ils se sont levés pour raconter leurs histoires et rappeler leurs succès.
Pendant que chaque média explore quel rôle les outils d’IA peuvent jouer dans la salle de nouvelles, il ne faut pas perdre de vue ce qui distingue les journalistes d’une machine à recracher des mots.
Les journaux en milieu minoritaire sont le reflet de leur communauté. Vos médias ont besoin de vous pour y arriver. Ils ont besoin que vous les lisiez, mais surtout que vous leur parliez, aussi bien pour les remercier que pour les inviter à faire mieux, et que vous leur transmettiez de l’information.
Les IA ne pourront jamais jouer ce rôle de façon empathique. Elles ne seront jamais par et pour la francophonie minoritaire.
Et si les médias francophones disparaissaient, les GML n’auraient plus de sites où tirer les actualités de la francophonie. Dans ce cas, où allez-vous les trouver?
À lire : Bonjour Gemini, au revoir nouvelles sur la francophonie (Éditorial)
Francopresse a toujours mis les enjeux et les êtres humains de la francophonie de l’avant. Ce désir reste une priorité. Nous ne croyons pas que l’information est authentique si le texte qui présente aux lecteurs et lectrices l’expérience d’une personne était écrit par une machine.
Francopresse n’a jamais publié de texte écrit par une IA et ne prévoit pas emprunter cette voie.
Cela dit, l’équipe de Francopresse utilise à l’occasion certains outils alimentés par l’IA pour faciliter certaines tâches. La transparence étant au cœur de la confiance, Francopresse affichera dorénavant de quelle façon ces outils ont été utilisés dans la production et la révision d’un texte.
Si un outil a servi à résumer un rapport, à transcrire une entrevue menée par un ou une journaliste ou à raccourcir un paragraphe, nous le préciserons en fin de texte. Nous n’allons pas privilégier les images faites par l’IA, mais si nous devons en utiliser une, nous l’indiquerons.
Des êtres humains en chair et en os continueront d’écrire tous les textes, et les informations trouvées grâce à des outils d’IA feront toujours l’objet d’une vérification.
Cette façon de faire respecte nos valeurs de rigueur, d’exactitude et d’esprit critique. Elle constitue aussi une façon de rester branchés à notre humanité collective et à notre instinct de défense de nos droits en tant que minorité linguistique.
À lire : L’IA est-elle une menace pour la création littéraire francophone?
Google ne veut plus être une entreprise de recherche. Elle veut être une entreprise d’intelligence artificielle.
Le géant du Web a en bonne partie confirmé cette intention lors de la conférence Google I/O – où l’entreprise dévoile chaque année ses intentions de développement – à la fin de mai en Californie.
Au moyen des «agents» d’intelligence artificielle (IA), l’entreprise veut être votre agent de voyage, votre maitre d’hôtel, votre serviteur, votre fournisseur de rêve… et votre geôlier.
L’objectif des services – en plus d’accroitre les revenus de l’entreprise, bien sûr – est de vous garder le plus longtemps possible prisonnier de l’écosystème de Google.
Désert informationnel à l’horizon
Ce qui est pour l’instant seulement un aperçu occupera de plus en plus de dans tout l’écosystème de Google. La société voudra que son IA soit tellement présente qu’elle nous l’imposera à tous les détours.
Il faudra redoubler d’efforts pour voir autre chose que les réponses de Gemini – le nom de l’IA de Google. La liste des sites qui contiennent, en réalité, les informations que vous cherchez sera moins mise en évidence. Autrement dit, une bonne dose de merdification.
À lire : L’IA ou la prochaine «merdification» (éditorial)
Pour garder le trafic dans son écosystème, Google doit le retirer à d’autres. Pourquoi aller sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada si Gemini vous explique comment avoir accès à un crédit d’impôt?
La perte de trafic dans les sites du gouvernement est une chose, mais elle sera désastreuse pour les médias. Ceux du Canada sont déjà coupés d’un outil de découvrabilité depuis deux ans : Facebook. Apparaitre dans les résultats des moteurs de recherche était une des dernières façons d’espérer élargir son lectorat et d’intéresser la population à l’information locale.
Les médias d’information en milieu minoritaire seront encore plus perdants. Pourquoi consulter le site de La Voix acadienne, par exemple, si Gemini peut prétendument vous résumer l’information qui touche la francophonie de l’Île-du-Prince-Édouard?
Et si personne ne va sur le site de l’Express-ca de Toronto, qui payera les journalistes de ce média pour produire du nouveau contenu d’information?
Et si L’Eau vive en venait malheureusement à disparaitre, comment Gemini saura ce qui se passe en français en Saskatchewan?
C’est un cercle vicieux. En voulant tout récolter, Google assèchera le terreau fertile de l’information, créera une désertification et ne cultivera plus rien de nutritif, surtout pour la francophonie.
Les intelligences artificielles du type grands modèles de langage dépendent de l’information produite par des humains. Des tests ont montré que les réponses d’une intelligence artificielle entrainée à partir des réponses d’une autre intelligence artificielle perdent en qualité.
Pas de boule de cristal
En réalité, il est difficile de prévoir à quel point Google réussira à changer les habitudes des «Googleux et Googleuses».
Les évènements comme I/O servent avant tout à épater les investisseurs et investisseuses à coup de rêve sur écrans géants. Les rêves ne se concrétisent pas tous. Pour l’instant, les réponses de l’IA sont loin d’être parfaites. Par contre, les plus jeunes adoptent quand même cette technologie.
Chose certaine, Google voudra imprimer Gemini sur nos rétines et dans nos cerveaux. L’entreprise gagnera en prudence seulement quand un nombre suffisant de vacanciers et de vacancières en colère se seront retrouvés à Sydney en Australie au lieu de Sydney en Nouvelle-Écosse, parce que l’agent IA a fait une mauvaise réservation.
À lire : Intelligence artificielle : les véritables enjeux au-delà des craintes
Pour se protéger
En attendant, si la bonne information vous tient à cœur, résistez à l’uniformisation. Continuez à consulter des sites de médias variés. Usez de votre esprit critique le plus affuté et ne croyez pas les promesses des prophètes de l’IA sur parole – ni l’IA elle-même d’ailleurs.
Si vous ne voulez pas que la production d’information de proximité disparaisse et que l’IA prenne toute la place en ligne, il faut éviter d’installer une dépendance.
Il est en fait déjà possible de ne pas voir les réponses générées par Gemini. Pour éviter les hallucinations ou pour ne pas gaspiller d’énergie, vous pouvez ajouter «-IA» à la fin de votre requête dans Google.
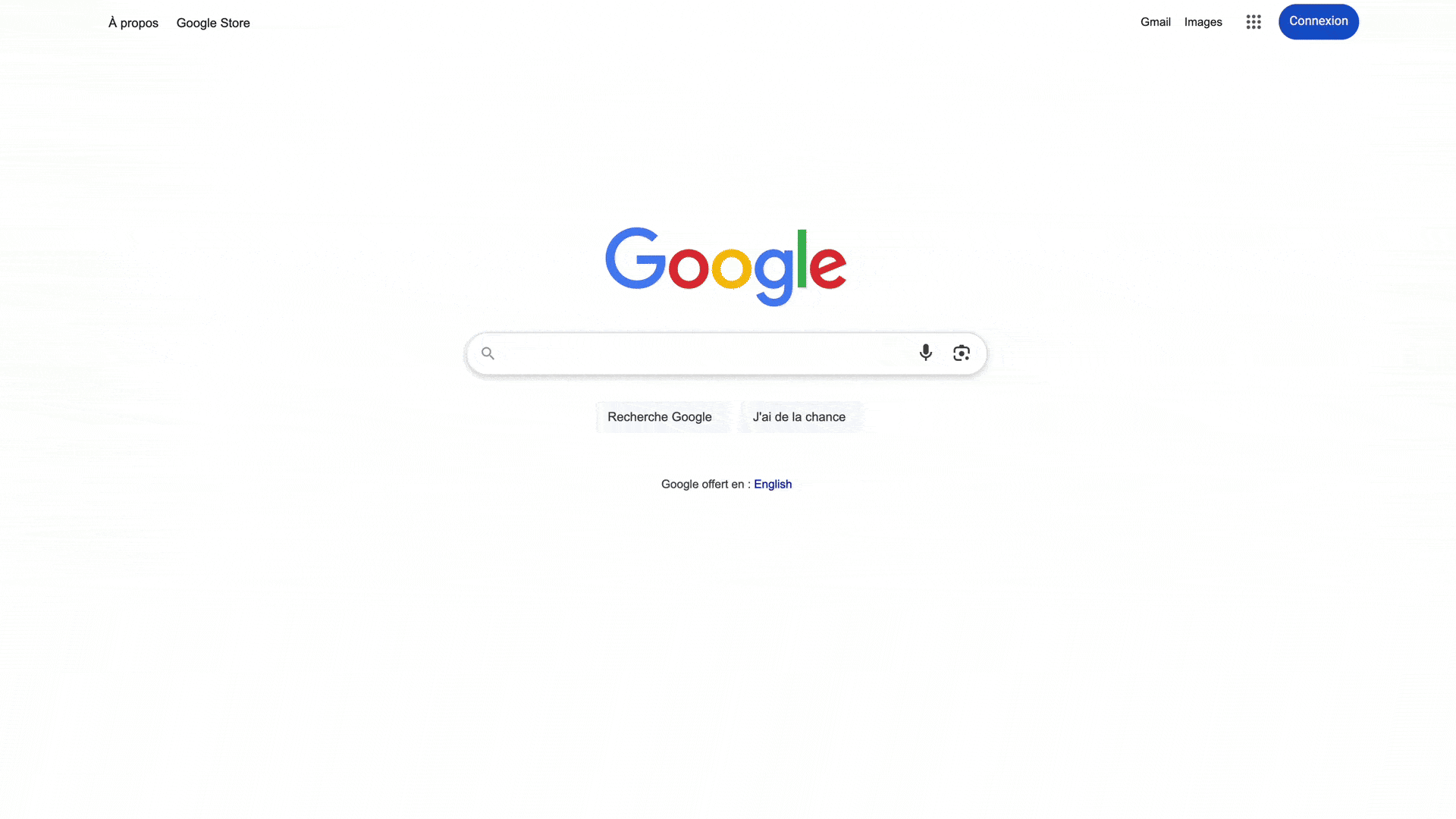
Vous pouvez aussi tourner le dos à Google. Ce n’est pas parce que cette entreprise est la plus connue qu’elle est la seule. DuckDuckGo et Ecosia, par exemple, n’ont pas encore intégré l’IA par défaut dans leur interface.
De leur côté, les médias ont aussi des devoirs à faire. Ils doivent – encore – trouver des solutions innovantes à un problème qu’ils n’ont pas créé. Et comme d’habitude, la tâche s’annonce plus complexe pour les médias francophones en milieu minoritaire.
À lire : Les petits médias francophones face aux défis de la vidéo
Au début, l’algorithme de TikTok a mené la danse de la recherche.
Lors de la première séance, il a fallu ignorer des vidéos pendant une bonne trentaine de minutes avant de finalement tomber sur une vidéo d’information en français. Il s’agissait de la chaine française Infos Minutes. Radio-Canada est apparue presque tout de suite après.
Après plusieurs séances de furetage sur TikTok, d’autres chaines dites d’information se sont mises à apparaitre de temps à autre. Finalement, la recherche active de comptes a permis de dénicher un peu plus de contenu d’information en français, mais peu d’actualités.
Et non, le «vieux monsieur» qui approche la cinquantaine n’était pas si seul dans cet espace. Avec des extraits d’émissions de Stéphan Bureau, de QUB Radio et autres, il est clair que le public de TikTok ne compte pas seulement des jeunes de moins de 35 ans. Mais ceux-ci restent minoritaires, selon les récentes données de l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval.
Pêlemêle
Suivre l’actualité en français sur TikTok ne se fait pas sans efforts.
D’abord, beaucoup de contenu informationnel arrive de France. Radio-Canada assure une bonne présence sur TikTok, tout comme Le Devoir, TVA et Noovo. Il y a par contre un nombre inquiétant de comptes qui ne font que rediffuser les vidéos des chaines d’information, c’est-à-dire des contenus qui ne leur appartiennent pas.
Mais même après avoir essayé de «cultiver» un algorithme efficace, la fonction de vidéo aléatoire présente plus d’humoristes que d’actualités. TikTok continue de livrer ce qui fonctionne le plus pour nous garder sur la plateforme, pas nécessairement ce que nous cherchons. Le fil aléatoire n’est donc pas un idéal de découvrabilité de l’information.
Sans oublier que TikTok est une sorte de machine à voyager dans le passé très imprécise. Les dates des vidéos ne sont pas toujours bien indiquées. Il est difficile de savoir si l’information est récente ou non. Parfois, elle date de plus d’un mois.
Ce n’est pas une lubie de «vieille personne» que de vouloir situer une information dans le temps. La chronologie est importante pour suivre une situation qui évolue ou pour la situer dans son contexte.
Cela dit, il y a des producteurs de contenu plus spécialisés qui présentent une nouvelle, une information ou une analyse sous un angle différent. On tombe alors plus dans l’information lente, ce qui peut être une mauvaise chose.
Les francos sont là
La francophonie minoritaire canadienne est présente sur TikTok. L’Acadie en particulier, y a plusieurs chaines qui présentent entre autres des vidéos de «traduction» de mots typiquement acadiens. Il y a aussi des chaines en Ontario, mais plus rarement dans le reste du pays.
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse et tout récemment l’Aurore boréale sont pour l’instant les seuls médias francophones en milieu minoritaire que nous avons trouvé qui maintiennent une présence active sur TikTok.
Qui ça?
Ce qui reste le plus difficile, c’est de déterminer le degré de crédibilité à accorder à une chaine. Surtout les premières fois que l’on tombe sur son contenu.
Quelle confiance peut-on accorder à un jeune qui parle d’impôts en se faisant couper les cheveux chez son barbier? Qu’est-ce qui garantit qu’il a les compétences nécessaires pour livrer ce type d’informations?
Est-ce que cette femme en blouse blanche qui parle de crise cardiaque est vraiment médecin comme elle l’affirme?

TikTok est un univers relativement différent des autres réseaux sociaux. Il faut y entrer avec l’esprit ouvert et son sens critique bien réveillé.
Il est plus facile de confirmer la crédibilité d’une personne quand une chaine fournit un lien vers un site Web externe. D’autres, par contre, existent seulement sur TikTok, ce qui complique la vérification de la notoriété.
Sans savoir qui parle, il est impossible de savoir si la personne a les compétences nécessaires pour être dignes de confiance dans le domaine qu’elle aborde.
La capacité d’identifier une source et de vérifier ses compétences est pourtant l’une des bases de la confiance en information. Un bon critère, peu importe l’âge de la personne qui s’aventure sur les médias sociaux.
TikTok n’est pas une plateforme d’actualités, mais on peut s’y informer. Les vidéos peuvent servir de porte d’entrée vers la recherche plus approfondie d’un sujet et mener vers les sites des médias reconnus pour la qualité de leur travail journalistique.
À lire : Le réseau social TikTok : un outil pour la réconciliation? (L’Aquilon)
Une place à l’ombre
Le mot d’ordre chez les médias est d’atteindre les consommateurs d’information là où ils se trouvent. Les jeunes de 18 à 34 ans, eux, se trouvent sur YouTube et TikTok.
Selon les données de l’Académie de la transformation numérique, 70 % des personnes de cette tranche d’âge visitent YouTube et 51 % utilisent TikTok.
Le défi reste important. TikTok ne favorise pas la découvrabilité des contenus médiatiques. Les jeunes font peu confiance aux médias traditionnels. Les codes de ces vidéos ne sont pas les mêmes.
De plus, ces réseaux construits pour donner toute la place au contenu de masse laissent peu d’espace aux petits médias. Ceux-ci doivent se faire remarquer – en 5 secondes – sans pour autant dénaturer leur ligne éditoriale.
En même temps, quel est l’avantage de donner notre contenu à une plateforme sur laquelle la monétisation est impossible au Canada? Est-il éthique de donner notre contenu à une plateforme qui exploite les biais cognitifs pour créer une dépendance?
Mais il s’agit d’une occasion de reconstruire la confiance dans les médias. La planche de salut est peut-être là. Si un créateur ou une créatrice de contenu peut arriver à inspirer la confiance de son auditoire au fil du temps, peut-être que les médias traditionnels peuvent y arriver aussi.
P.-S. Oui, Francopresse a maintenant un compte TikTok, mais il ne compte aucune vidéo pour l’instant.
À lire : Interdiction des cellulaires en classe : éduquer plutôt que réprimander
Selon le recensement de 2021, il y avait 6 275 journalistes au Canada en 2020. En comparaison, le pays comptait 83 420 professionnels et professionnelles en publicité, en markéting et en relations publiques. Soit un ratio de 13 spécialistes en communication pour 1 journaliste.
Il est normal qu’il y ait plus de gens qui travaillent en communication qu’en journalisme. La catégorie inclut une bien plus grande variété d’emplois et représente un plus grand éventail d’entreprises et d’agences.
Cependant, pendant que les médias d’information perdent des joueurs, les relations publiques grossissent à vue d’œil. Depuis le recensement de 2016, le nombre de journalistes a diminué de quelques centaines, alors que les effectifs en publicité, en markéting et en relations publiques ont bondi de près de 30 000 personnes.
Selon une étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), le ratio était de 2 pour 1 en 1990 au Québec.
À lire aussi : Le journalisme : «un métier sous pression»
Le déséquilibre s’accentue très rapidement, non seulement dans le nombre d’employés, mais aussi dans la nature du travail.
Comme le rappellent les chercheurs de l’IRIS : «Alors que les [journalistes] cherchent à rapporter les faits de la manière la plus objective et la plus équilibrée possible, les [relationnistes] diffusent de l’information formatée par des intérêts politiques ou économiques.»
Une équipe en communication peut avoir besoin de quelques heures pour développer un message.
Les journalistes, qu’ils soient seuls ou en équipe, auront besoin de bien plus de temps – et parfois plus d’un article – pour déterminer si le message est valide, s’il n’omet pas une partie de la réalité.
Ce déséquilibre a un nom : la loi de Brandolini, ou asymétrie du baratin. Celle-ci s’applique surtout aux fausses nouvelles, mais le principe fonctionne pour les demi-vérités : beaucoup plus de temps et d’énergie sont nécessaires pour corriger une mauvaise information que pour la produire.
Si 83 000 agents de communication produisent chacun une minute d’informations biaisées, combien de temps auront besoin 6 000 journalistes pour présenter tous les faits? Après cet exercice, qui a le plus de contrôle sur l’information?
À lire aussi : L’éducation aux médias pour lutter contre la désinformation dès l’école
Il faut garder ce concept en tête quand on parcourt les réseaux sociaux. Surtout en campagne électorale. Derrière chaque parti politique, derrière chaque message, il y a une équipe de communication qui a pour mandat de vendre des idées et des slogans.
Pour cette raison, le travail journalistique pendant cette période est doublement important. Les annonces vont extrêmement vite, elles fusent de tous les côtés et elles sont présentées dans leur plus bel emballage.
Les journalistes les déballent, les démontent et décrivent la partie du message qui ne cadre pas entièrement avec la réalité, ou le morceau de casse-tête qui manque.
Pour un électeur, suivre une campagne électorale uniquement à partir des médias sociaux d’un parti politique ou de leurs communications officielles ouvre une porte vers un univers parallèle.
À lire aussi : La désinformation politique et les enjeux 2SLGBTQIA+
Malheureusement, au Canada, il faut faire un plus grand effort pour garder les deux pieds dans la réalité et accéder à du contenu non biaisé, puisque les médias sont absents de Facebook et Instagram. Sans oublier Twitter qui fait un X sur la vérité.
Pour l’élection fédérale de 2025, les journalistes ne sont pas admis à bord de l’avion de campagne du Parti conservateur du Canada. Les conférences de presse et les évènements seront accessibles aux journalistes, mais les médias nationaux auront plus de difficulté à être sur le terrain pour poser des questions.
À lire aussi : Pierre Poilievre inspiré par le plan de communication républicain (Éditorial)
Les médias régionaux – incluant les journaux francophones en milieu minoritaire – joueront donc un rôle de premier plan dans la couverture électorale et dans le «déballage» des promesses. Ils seront mieux placés pour comparer les messages bien écrits de tous les partis politiques aux réalités sur le terrain.
Gardez donc un œil sur leurs pages.
En ligne et dans la culture populaire, l’effet Dunning-Kruger est utilisé pour expliquer pourquoi les personnes qui ont peu de connaissances dans un domaine donné se croient plus compétentes qu’elles ne le sont vraiment, parfois même plus que les spécialistes du domaine en question.
Après avoir vu quelques vidéos au fil des ans, le sujet était déjà en partie maitrisé. Cet éditorial devait présenter cet effet afin que vous y soyez sensibles et que vous puissiez éviter d’en être victimes.
Sauf que cette définition de l’effet Dunning-Kruger est erronée.
Tout ce que l’étude des sociologues David Dunning et Justin Kruger a pu montrer en 1999, c’est que le commun des mortels se croit aussi bon sinon meilleur que la moyenne des gens. Inversement, les personnes plus compétentes sous-estiment leurs habiletés.
Les chercheurs ont demandé à des étudiants et étudiantes de répondre à des tests écrits, puis de donner d’abord leur avis sur leur propre niveau de réussite et ensuite sur leur niveau de réussite par rapport aux autres.
Les données de l’étude semblaient montrer que plus le résultat obtenu était mauvais, plus l’écart entre la perception de la réussite et la réalité était grand.
En plus d’avoir été mal interprétés par certaines personnes, les résultats de cette première étude dans le domaine sont contestés.
Même si elle a pu être reproduite par d’autres équipes de recherche, elle a mené à des résultats différents quand le niveau de difficulté des tests variait.
Aussi, selon d’autres scientifiques, les résultats s’expliqueraient au moins en partie par un effet statistique.
À lire : Notre cerveau primitif : pourquoi croit-on toujours avoir raison? (éditorial)
Sans recherche supplémentaire, ou avec une recherche limitée à des vidéos sur YouTube présentant une version inexacte des conclusions de Dunning et Kruger, le présent texte aurait perpétué une mauvaise information.
Heureusement, puisque même un éditorial, ou tout bon texte d’opinion, doit reposer sur des faits vérifiables, il fallait creuser le sujet.
Après la consultation de sources de plus en plus variées sur l’étude et les résultats, il est devenu évident que la véritable définition de l’effet Dunning-Kruger n’était pas la même que celle qui est la plus couramment diffusée.
Seul un approfondissement du sujet a permis aussi d’apprendre qu’il ne bénéficie pas d’une reconnaissance unanime dans le milieu scientifique et qu’il est remis en question par d’autres recherches.
Cette conclusion vaut pour tout sujet d’actualité. Pour bien comprendre une nouvelle, il est préférable de ne pas lire la version d’une seule source. Il faut consulter des médias variés et des médias aux points de vue différents.
Cela ne veut pas dire qu’il faut visiter des sites de nouvelles spécialisées dans la désinformation, mais plutôt qu’il faut lire sur un même sujet un texte écrit par un média de droite, un média de gauche et un média reconnu comme étant plus neutre pour arriver à faire plus facilement la part des choses. À se former une opinion plus éclairée.
David Dunning le dit lui-même : pour sortir de l’effet, il faut toujours chercher à en apprendre plus, à demander l’avis d’autres personnes et à remettre en question ce que l’on sait.
Que l’effet soit réel ou non, ce sont de bons conseils.
À lire : Une «tempête parfaite» pour la désinformation électorale
Malgré ses promesses en campagne électorale, le premier ministre a souvent été absent de l’action, des débats et des annonces touchant la minorité francophone.
Pour un chef accusé – par les anciens ministres Marc Garneau et Bill Morneau – de concentrer le pouvoir décisionnel au sein du cabinet du premier ministre, Justin Trudeau semble pourtant avoir laissé toute la place à sa ministre Ginette Petitpas Taylor lors de la refonte de la Loi sur les langues officielles.
À d’autres occasions, le gouvernement de Justin Trudeau a cependant oublié que les communautés francophones en situation minoritaire doivent être protégées.
À lire : Francophonie et langues officielles : l’héritage de Justin Trudeau en question
Le postsecondaire francophone, un des grands oubliés
L’un des plus récents exemples d’oubli remonte à janvier 2024, quand le ministre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Marc Miller, a annoncé une réduction du nombre de permis d’études délivrés aux personnes étrangères.
Les établissements postsecondaires francophones ont alors tiré la sonnette d’alarme, parce que la diminution des revenus apportés par ces étudiants et étudiantes allait lourdement diminuer leurs revenus.
Dans les semaines suivantes, il a été impossible de savoir comment la mesure affecterait les établissements postsecondaires francophones; jusqu’à l’annonce d’un nouveau programme pour eux.
En 2021, Justin Trudeau faisait campagne avec la promesse de financer les établissements postsecondaires francophones à hauteur de 80 millions de dollars par an de manière permanente. Un financement qui ne s’est jamais concrétisé dans le Plan d’action pour les langues officielles.
Important, mais pas toujours…
Quand Justin Trudeau n’était pas absent des débats, il semblait tout simplement oublier les besoins des communautés francophones en situation minoritaire.
Lisez notre infolettre
les mercredis et samedis
En 2019, il a nommé une lieutenante-gouverneure unilingue anglophone dans la seule province officiellement bilingue du Canada.

Lors de son entrée en fonction comme gouverneure générale du Canada, Mary Simon avait promis d’apprendre le français.
En 2021, Justin Trudeau a persisté et signé avec l’installation d’une gouverneure générale qui ne parle pas français, Mary Simon. Certes, elle est autochtone et sa nomination représente un geste louable pour se rapprocher des Premières Nations, mais la population francophone du pays s’est sentie, encore une fois, oubliée.
D’ailleurs, la prorogation du Parlement au début de l’année a rejeté dans les limbes deux projets de loi qui auraient modifié la Loi sur les compétences linguistiques et rendu obligatoire le bilinguisme pour les postes de gouverneur général du Canada et de lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick.
Autre exemple d’oubli, au début de la pandémie de COVID-19, le premier ministre a défendu la décision contestée de Santé Canada d’autoriser l’étiquetage unilingue en anglais afin d’accélérer la production de certains produits désinfectants, antiseptiques et d’entretien.
Dans ce dernier cas, le commissaire aux langues officielles a cependant conclu que la mesure avait été «raisonnable».
À lire : Quatre projets de loi en lien avec la francophonie victimes de la prorogation
Comment ne pas montrer l’exemple
Tous ces exemples d’oublis n’ont pas la même portée grave que d’autres préjudices passés subis par les francophones en situation minoritaire. Ils ne se comparent pas au Règlement 17 ou aux difficultés d’obtenir des écoles de langue française. Ils n’ont pas fait reculer les droits des francophones.
Ils démontrent cependant un manque de leadeurship qui envoie un très mauvais message à la fonction publique et à la population, tant francophone qu’anglophone.
Le commissaire aux langues officielles indiquait d’ailleurs dans son rapport annuel de 2024 que des institutions fédérales «ne semblent ni adhérer à la vision d’une fonction publique bilingue ni appuyer la création de milieux de travail dans lesquels les fonctionnaires se sentent habilités à travailler dans la langue officielle de leur choix».
Un très vieux problème qui disparaitra seulement lorsque la personne à la tête du gouvernement canadien offrira plus qu’un bilinguisme d’apparence, plus que des discours dans les deux langues officielles.
Elle montrera que le français est aussi important que l’anglais. Elle rappellera que les francophones ont aussi aidé à construire le pays. Elle n’oubliera pas que les communautés minoritaires ont des enjeux spécifiques.
Justin Trudeau en avait peut-être l’intention, mais il n’a pas été cette personne.
À lire : Fonction publique : «Il faut changer cette culture d’être unilingue»