Simon Forgues observe le milieu de la radio communautaire dans les francophonies canadiennes depuis plus de 30 ans. Pour lui, cela ne fait pas de doute : lorsque les mesures sanitaires sont venues transformer la vie sociale de la population canadienne, «les bingos à la radio ont connu un immense boum», remarque ce conseiller en stratégie et communication à l’Alliance des radios communautaires du Canada depuis 2007.
Certaines personnes cherchaient à se divertir, d’autres à joindre l’utile à l’agréable en remportant des lots intéressants. Le bingo radio a été une activité sociale essentielle pendant la COVID-19 et est resté une tradition bien ancrée dans de nombreuses collectivités, même si le niveau de fréquentation est parfois revenu aux niveaux d’avant la pandémie.
À lire aussi : La promotion du radio bingo depuis le blocage de Meta (Le Courrier de la Nouvelle-Écosse)
Le phénomène a été observé à Hearst, dans le Nord de l’Ontario, où le bingo se joue hebdomadairement depuis 1995. Au plus fort de la pandémie, les recettes provenant du bingo ont grimpé de 30 à 35 %, ce qui peut représenter 250 joueurs de plus par semaine, dans cette petite ville où le bingo est devenu une tradition.

Pour Simon Forgues, les bingos à la radio ont connu «un immense boum» lors de la pandémie de COVID-19.
Dans plusieurs communautés de l’Ontario et de l’Atlantique, le modèle du bingo à la radio est connu et éprouvé. Hearst, Kapuskasing, l’Est ontarien, Pokemouche au Nouveau-Brunswick et Clare en Nouvelle-Écosse y jouent abondamment. «C’est le genre de place où le monde se fait des réunions pour jouer au bingo ensemble», illustre Simon Forgues.
Nicholas Monette, originaire de l’Est ontarien et directeur des opérations chez Unique FM, à Ottawa, acquiesce : «C’est une institution, pratiquement.»
À Hearst, le taux de participation et les recettes sont revenus à leurs niveaux pré-pandémiques, mais le bingo a sauvé les emplois du personnel des Médias de l’épinette noire, estime son directeur général, Steve McInnis. Les publicités gouvernementales et le bingo ont permis de garder l’organisme à flot, soutient-il.
Aujourd’hui, environ 850 cartes se vendent par semaine (1200 lorsque les lots sont plus élevés). Le bingo représente environ le tiers des revenus de l’organisme, soit entre 250 000 et 300 000 $ par année.
Nicholas Monette y voit un phénomène social : «Je ne sais pas, peut-être que le bingo vient jouer un certain rôle communautaire. Ça devient une façon d’aller rencontrer tout le monde une fois par semaine», même si c’est par les ondes.
À lire aussi : Radiodiffusion : vers une consultation accrue des francophones?
Devant un tel succès et l’engouement décuplé en temps de pandémie, d’autres radios ont aussi voulu tenter l’expérience du bingo, comme Nord-Ouest FM à Falher, dans le nord de l’Alberta, et Unique FM.

Natalie Aloessode-Bernardin a remarqué que certains de ses amis et amies originaires de pays étrangers ne connaissaient pas le bingo radio.
«J’ai l’impression que la radio, notre radio en tout cas, cherchait à “ride the wave”», commente la directrice générale de la radio ottavienne, Natalie Aloessode-Bernardin.
Unique FM a cependant coupé court à l’aventure en septembre 2024. Cette radio urbaine a eu du mal à s’imposer dans un marché où l’offre culturelle et récréative abonde. Même si elle a réussi à présenter un bingo qui n’était plus déficitaire, les recettes ne justifiaient pas l’énergie qu’il fallait y mettre, indique la directrice.
L’équipe de direction lance l’hypothèse suivante : les changements démographiques ont peut-être été un frein au bingo de la radio. Natalie Aloessode-Bernardin a constaté que, pour ses amis et amies du Bénin et du Mali, ce jeu leur était complètement inconnu.
«Nous, on joue au bingo à la maternelle. C’est comme si ça faisait partie de nos mœurs canadiennes-françaises. Mais eux, ils ont zéro cette référence-là.»
À Falher, le bingo en est aujourd’hui à sa deuxième année d’existence. Il s’agit de l’un des deux organisés dans la province, l’autre étant animé par une radio communautaire autochtone.
En janvier, Nord-Ouest FM a vendu environ 300 cartes, apportant des revenus autonomes essentiels, estime l’adjointe administrative de la radio, Marianne L. Houle. Les subventions n’étant jamais garanties, «la radio bingo, c’est notre propre argent», souligne-t-elle.
À Hearst, grâce à la diffusion en ligne et l’accès à Internet haute vitesse, CINN FM vend maintenant des cartes de bingo à Hornepayne et à Greenstone, des communautés situées à 125 et à 250 km du studio. Avec peu de promotion, les ventes ont déjà augmenté de 10 %.
Néanmoins, la communauté, même fidèle, est plus difficile à engager depuis aout 2023, rappelle Simon Forgues. L’entreprise américaine Meta, en bloquant l’accès aux contenus des médias canadiens sur Facebook et Instagram, a sabré le plus grand canal de promotion des radios.
Celles-ci ont dû repenser leurs stratégies de communication et faire preuve de créativité pour rejoindre les gens, leur page Facebook comptant souvent des milliers d’abonnés et d’abonnées «gagnés tranquillement au fil des années», témoigne le conseiller. «Ç’a frappé fort pour plusieurs radios», se souvient-il.
Certaines radios ont créé une nouvelle page, identifiée autrement et qui n’est pas bloquée, utilisent des pages communautaires, les pages des membres de leur personnel ou de leurs bénévoles, mais «c’est sûr que ça demande beaucoup d’effort de se reconstruire un noyau de fidèles abonnés avec une nouvelle page Facebook».
En Alberta, l’équipe de Nord-Ouest FM demeure optimiste et patiente : la croissance est lente, mais constante. Marianne Houle souhaite d’ailleurs élargir la zone où il est possible de se procurer des cartes de bingo, un défi compte tenu de l’immensité du territoire couvert par la radio. «Mais c’est pas mal populaire. Le mot se passe. On a toujours de nouveaux joueurs à toutes les semaines.»
En majorité, les personnes qui jouent ont moins de 40 ans et jouent avec leurs parents ou leurs grands-parents. C’est aussi le cas à Hearst, où des groupes de personnes ainées se rassemblent aussi pour jouer ensemble. «C’est rare qu’il y ait un qui joue tout seul», ajoute Marianne L. Houle.
Le président-directeur général de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), Martin Normand, a insisté sur l’apport des étudiants étrangers sur le plan académique.

Martin Normand souligne l’importance des étudiants étrangers francophones au sein de l’écosystème postsecondaire canadien.
«Leur présence permet d’élargir l’offre de programmes, en compensant le faible nombre d’inscriptions locales qui, à lui seul, ne suffirait pas à justifier la création de nouveaux cursus. Cet apport contribue à renforcer un écosystème universitaire dynamique et compétitif, tant sur le plan national qu’international», a-t-il expliqué lors d’un des trois panel du symposium Dynamiques institutionnelles et population étudiante en changement.
«C’est pourquoi les établissements francophones cherchent à se démarquer face aux changements de politique fédérale. Ils saisissent ces opportunités pour renforcer leur positionnement en mettant en place des stratégies de proximité et d’accompagnement sur le terrain à l’étranger.»
À lire : Épargner les établissements francophones du plafond d’étudiants étrangers
Le symposium a également mis en lumière la contribution des étudiants étrangers au rayonnement des universités canadiennes. Selon le Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI), le Canada en comptait 1 041 000 à la fin de l’année 2023.
La même année, les dépenses de ces étudiants, ainsi que celles de leurs familles et amis en visite, ont contribué à hauteur de 37 milliards de dollars à l’activité économique du Canada, se traduisant par une contribution de 40 milliards de dollars (soit 1,2 %) au Produit intérieur brut canadien, rapporte Affaires mondiales Canada.
De leur côté, ces étudiants et étudiantes choisissent le Canada pour des raisons très personnelles. Deux ont participé à la discussion coorganisée par l’Observatoire sur l’éducation en contexte linguistique minoritaire (OÉCLM), le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités (CIRCEM) et le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone (CCRMF).

Adjmal Younoussa, étudiant en informatique à l’Université d’Ottawa, partage son expérience des défis rencontrés par les étudiants étrangers francophones.
Étudiant au baccalauréat en informatique à l’Université d’Ottawa, Adjmal Younoussa a choisi le Canada pour son «rapport qualité-prix», surtout comparé à son voisin américain. Le bilinguisme français-anglais est également un atout majeur pour cet étudiant originaire des Comores.
Pour sa part, Clémence Gnintedem, candidate au doctorat en littérature française, souligne la disponibilité des moyens didactiques qui permettent aux étudiants de s’épanouir dans leurs recherches.
Barrières linguistiques, contraintes administratives, difficultés d’accès au marché du travail : la communauté étudiante internationale francophone doit surmonter plusieurs défis, notamment l’adaptation au système éducatif, «qui diffère grandement de celui des Comores», explique Adjmal Younoussa. «Le système financier est également très différent de ce que l’on retrouve dans d’autres pays.»
Celui qui assure la présidence de l’Association des étudiants internationaux de l’université d’Ottawa (UO-ISA) souligne également la difficulté d’accès à l’information. «Il y a une période d’adaptation qui est nécessaire. Je connais un étudiant qui a raté un devoir parce qu’il ne savait pas où aller chercher l’information sur le campus virtuel (Brightspace)», explique-t-il.
À lire aussi : La littératie financière, un levier essentiel pour l’intégration des immigrants
Clémence Gnintedem souligne la barrière linguistique liée à la proximité entre le français et l’anglais, qui entraine parfois un glissement de certains mots et expressions, pouvant prêter à confusion pour les étudiants.

Christine Rwayongwe évoque les défis d’intégration rencontrés par les étudiants, comme la maitrise de l’anglais.
Ne pas maitriser l’anglais entraine aussi son lot de complications. «Les étudiants doivent souvent travailler pour subvenir à leurs besoins, mais, à Ottawa, la plupart des employeurs exigent le bilinguisme», explique Christine Rwayongwe, coordonnatrice des services d’établissement au Centre d’établissement, de soutien et d’orientation communautaire (CÉSOC). «Nous les orientons donc vers des employeurs à Gatineau.»
La situation est encore plus complexe pour les étudiants établis dans d’autres provinces canadiennes. «Par exemple, un étudiant international au Campus Saint-Jean en Alberta, dont la formation exige un stage en entreprise, risque de compromettre sa réussite s’il ne parvient pas à trouver un milieu de pratique», avertit Martin Normand.
La crise du logement affecte particulièrement les étudiants étrangers, qui rencontrent des difficultés à accéder aux logements. «À Ottawa, nous les orientons également vers des prestataires privés», précise Christine Rwayongwe.
Certains se retrouvent également en perte de statut d’immigration en raison de la lenteur du traitement de leurs demandes de résidence permanente. «Ils ne peuvent même pas quitter le Canada faute de lettre de refus. Certains ont essayé, sans succès, de faire une demande de permis de travail, car ils doivent continuer à vivre en attendant une réponse d’IRCC [Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada]», déplore la coordinatrice.
À lire : Les étudiants étrangers face au mur de l’emploi
Pour améliorer la situation de la population étudiante internationale francophone, Martin Normand recommande à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) de clarifier la politique d’immigration et de mieux informer les personnes intéressées, «afin d’éviter que des étudiants arrivent au Canada avec de faux permis d’études», souligne-t-il.
Christine Rwayongwe prône pour sa part une synergie entre les établissements d’enseignement supérieur, les organismes communautaires et les autorités responsables de l’immigration pour mieux orienter les étudiants francophones qui choisissent le Canada.
À lire : Des étudiants étrangers francophones engagés dans la vie universitaire
Près de 2000 personnes se sont rassemblées pour assister au couronnement de Mark Carney. Chrystia Freeland termine deuxième, quand même loin derrière, avec 8 % des votes. Karina Gould obtient 3,2 % des voix et Frank Baylis 3 %.
L’ancien banquier devrait être assermenté comme premier ministre mercredi 12 mars. Des élections pourraient être déclenchées d’ici la semaine prochaine, selon plusieurs sources libérales consultées par Francopresse.
Résultat des votes

Mark Carney a pris le temps de remercier Justin Trudeau pour quelques-unes de ses réalisations, comme avoir diminué la pauvreté des enfants et fait avancer la réconciliation avec les Premières Nations.
Il a assuré aux libéraux que son gouvernement mettra en action un plan pour bâtir une économie plus forte, des relations commerciales entre les provinces et pour protéger les frontières du pays. «Ça demandera de grands changements», a-t-il prévenu.
Il a déjà annoncé vouloir supprimer la taxe carbone et de «construire un Canada plus fort» dans un contexte de «division».
Le nouveau chef a remercié ses trois adversaires, qui ont amené «une belle énergie» à la campagne, a-t-il souligné.
À lire aussi : Course libérale : un débat en français qui parle peu de français

Justin Trudeau a reçu un accueil chaleureux pour son dernier discours en tant que chef du Parti libéral.
Le couronnement de Mark Carney marque la fin de l’ère de Justin Trudeau.
Avant l’annonce du gagnant, Justin Trudeau a livré un discours d’adieu aux partisans libéraux. Introduit avec émotion par sa fille, Ella Grace Trudeau, le désormais ancien chef du PLC a rappelé aux libéraux du pays que «le futur est désormais entre vos mains».
Puis, en ciblant les conservateurs indirectement : «C’est quand on essaie de mettre les libéraux sur la touche que nous, les libéraux, on montre nos vraies couleurs!»
Contre Trump et Poilievre
Lena Metlege Diab, députée francophile de Halifax Ouest et qui soutenait Chrystia Freeland, assurait avant l’annonce des résultats : «Qu’importe le nom du gagnant, nous sommes des libéraux. Nous devons nous serrer les coudes.»

«Aux États-Unis, la santé est une grosse business. Au Canada, c’est un droit», a dit Mark Carney pendant son discours.
Pour elle, la ministre Chrystia Freeland avait l’expérience, notamment face à Donald Trump qui, selon elle, reste la principale menace actuelle pour le Canada. «Pierre Poilievre n’est pas l’homme pour cette situation», a-t-elle assuré.
Une idée mise en valeur par le nouveau chef dans son premier discours : «Pierre Poilievre laissera notre planète bruler. Ce n’est pas du leadeurship, mais de l’idéologie qui trahit les valeurs canadiennes. Contrairement à lui, j’ai travaillé dans le secteur privé […] cette connaissance est particulièrement utile maintenant, au moment où […] on construit de nouvelles relations», a déclaré l’ancien gouverneur de la Banque du Canada.

À gauche, Elaine Tracey. À droite, Rosemary Flood.
Elaine Tracey, une militante ontarienne, a voté pour Mark Carney. Elle n’a pas aimé la façon dont Chrystia Freeland a quitté le cabinet de Justin Trudeau et estime que le leadeurship libéral a besoin d’un nouveau visage. Elle a confiance dans l’expertise économique du nouveau chef.
«Je pense toujours que Trudeau pourrait faire la job, je le soutiens toujours. Mais je suis contente de voir Carney dans la course.»
Une autre militante ontarienne, Rosemary Flood, était venue soutenir Chrystia Freeland. D’après elle, l’ex-ministre était la bonne personne pour faire face à Pierre Poilievre, à Donald Trump et à Vladimir Poutine.
«Tous les candidats sont excellents, mais elle a de l’expérience comme ministre et elle a de l’expérience à l’international. […] Elle a un leadeurship horizontal et non vertical. Elle va consulter et elle pense à la base libérale, comme nous.»

Jean Chrétien a invité le prochain chef à recruter les premiers ministres des provinces et les dirigeants d’autres pays pour tenir tête à Donald Trump.
Dans son discours, le nouveau chef libéral a affirmé que si le Canada devient le 51e État américain, «il n’y aura jamais de droits à la langue française». «La joie de vivre, la culture et la langue française font partie de notre identité. Il faut les protéger, les promouvoir. On ne les échangera jamais contre n’importe quel accord commercial.»
En entrevue avec Francopresse, la députée libérale franco-ontarienne Marie-France Lalonde a confirmé son appui envers Mark Carney. «C’est la personne dont je crois que le Canada a besoin pour les semaines, les mois et les années à venir, dit-elle. En politique, des fois, c’est tout à propos du timing, du bon moment.»
Mark Carney n’a pas d’expérience à propos des dossiers des langues officielles, mais cela n’effraie par la députée, qui estime que le nouveau chef est «entouré d’excellents députés, membres du caucus et autres gens qui l’entourent dans son équipe».
Il comprend très bien l’enjeu du déclin du français, non seulement au Canada, mais aussi au Québec.
Rappelant qu’Ottawa vient de dépasser sa cible d’immigration francophone dans les communautés de langue minoritaire, elle ajoute que Mark Carney est au fait des enjeux concernant l’immigration francophone hors Québec.
«Il va falloir qu’il améliore son parler, c’est sûr […], mais quand je lui parle, il me parle en français et on se comprend très bien.»
À lire : Dépassement de la cible en immigration francophone : «On veut s’assurer des ressources»
Son collègue, le député libéral franco-ontarien Marc Serré, a lui aussi soutenu l’ancien banquier. En plus de l’expérience économique et de sa capacité à gérer la relation tumultueuse avec les États-Unis, il saura ramener le PLC au centre, estime-t-il.

Marc Serré soutient Mark Carney.
Dans le Nord de l’Ontario, où se trouve sa circonscription de Nickel Belt, les enjeux de foresterie, de minéraux critiques et de l’emploi sont cruciaux. Mark Carney, avec son expérience en économie, le rassure.
«Je pense qu’on a besoin de quelqu’un comme Mark Carney, qui a de l’expérience au niveau international avec l’Angleterre, évidemment la Banque du Canada, et aussi au niveau des Nations Unies, au niveau du changement climatique, mais relié à l’emploi, lié aux investissements verts, aller chercher des argents», explique le député.
La question de l’investissement sera particulièrement importante pour les communautés francophones en situation minoritaire, relève-t-il. C’est la prochaine étape maintenant que la Loi sur les langues officielles a été modernisée : investir.
Pour le postsecondaire francophone, il faut selon lui «des investissements au niveau de la recherche, du personnel, de la programmation».
«Les francophones n’ont pas le choix de cours. Alors, il y a un besoin d’une concertation avec les institutions. […] Ensuite, quels sont les défis, les lacunes, [où] le fédéral devrait-il aider? Sans oublier le rôle des provinces.»
Marc Serré serait content de voir Frank Baylis, Chrystia Freeland et Karina Gould dans le cabinet ministériel de Mark Carney.
À lire aussi : Course libérale : Frank Baylis évite le débat sur le déclin du français
Ariane Millette a grandi en tant que personne malentendante dans l’Est ontarien, un milieu où la majorité des échanges se faisaient en anglais. Comment a-t-elle vécu cette expérience? «Difficilement», répond-elle simplement.

Ariane Millette a écrit un roman pour expliquer le quotidien des personnes sourdes.
«Tout le monde parlait anglais autour de moi à Ottawa. Sauf ma famille. Même à l’école, durant les pauses, mes amis étaient bien plus à l’aise en anglais. Ils pouvaient facilement changer d’une langue à l’autre. Pas moi», raconte-t-elle par écrit.
Dépendante de sa mère pour les services en français, elle a mis des années avant de gagner de la confiance en elle et de réussir à interagir avec des anglophones.
Ce n’est pas l’écoute ou les cours qui l’ont aidée à devenir bilingue, mais bien la lecture. «Je me suis décidée à lire en anglais parce que je n’étais pas tentée d’attendre après la traduction française d’une série», confie-t-elle. Une immersion linguistique contrainte, mais nécessaire pour évoluer dans un environnement largement anglophone.
Si l’apprentissage de l’anglais était un défi, l’accès aux services dans sa langue maternelle en était un autre.
Rares étaient les activités sportives auxquelles mes parents m’inscrivaient qui avaient un entraineur parlant français.
Dépendre des indices visuels devenait alors sa stratégie d’adaptation.
À lire : Repenser une société juste pour les personnes handicapées ou malades (chronique)
Même dans la communauté sourde, être francophone apporte son lot d’obstacles supplémentaires.
En Ontario, la majorité des malentendants utilisent l’American Sign Language (ASL), car elle est liée à l’anglais, langue majoritaire de la province. «Il est donc beaucoup plus difficile de recevoir des services en LSQ [langue des signes québécoise, NDLR] ou de trouver des interprètes FR-LSQ», commente Ariane Millette.
Une réalité que le directeur général de l’Association des Sourds du Canada, Richard Belzile, confirme.
Dans un contexte minoritaire, le défi devient la pénurie d’interprètes en LSQ. Les employeurs ou les institutions qui disposent de budgets conséquents, comme les universités ou les hôpitaux, peuvent se permettre d’embaucher des interprètes, mais dans de nombreuses régions, l’offre est quasi inexistante.
Au-delà du manque de services, le problème réside aussi dans la formation des interprètes en milieu minoritaire.
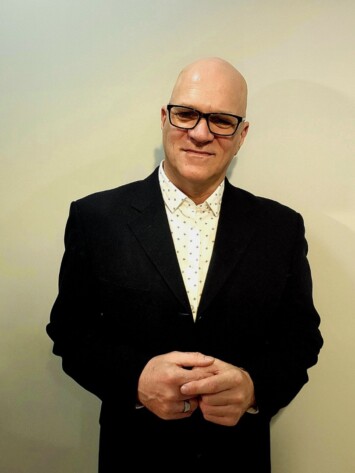
«Que ce soit pour réussir économiquement, socialement ou même dans sa vie familiale, la communication est essentielle», souligne Richard Belzile.
«Former un interprète en LSQ prend des années», explique Richard Belzile. «Il faut être bilingue français-anglais, comprendre la culture sourde et celle des entendants, et savoir adapter le message pour le rendre accessible. Or, les budgets étant souvent limités, cela crée une barrière énorme pour les personnes sourdes qui souhaitent des services en français.»
Il cite l’exemple d’un malentendant francophone vivant dans une région où l’ASL domine. «La seule option, souvent, est d’apprendre la langue des signes de la majorité, l’ASL. Ce n’est pas impossible, mais cela demande un effort supplémentaire considérable.»
Le principal défi des personnes sourdes et malentendantes reste donc l’accès à la communication. «Que ce soit pour réussir économiquement, socialement ou même dans sa vie familiale, la communication est essentielle», souligne-t-il.
Or, si la Charte canadienne des droits et libertés interdit la discrimination fondée sur le handicap, certaines limites sont permises. Le directeur évoque le concept juridique de «préjudice injustifié», qui sert à déterminer quelles adaptations sont essentielles et lesquelles peuvent être ignorées si elles engendrent un cout ou une contrainte excessive pour une entreprise.
«Cela signifie qu’un petit commerce, par exemple, n’est pas tenu d’engager un interprète en LSQ ou ASL pour accueillir un client sourd», illustre-t-il.
À lire : Ottawa : Mieux comprendre la «culture sourde», selon le Théâtre Tremplin (Le Droit)
Carine Jacques Lafrance, directrice générale du Regroupement des parents et amis des enfants sourds et malentendants franco-ontariens (RESO), souligne que l’accès aux ressources éducatives en LSQ pour les enfants sourds francophones est insuffisant.

Selon Carine Jacques Lafrance, il est crucial de donner aux enfants sourds et malentendants les moyens d’accéder à une langue, dès le plus jeune âge, pour garantir leur épanouissement futur.
«Combien de services de garde en Ontario ont des éducateurs capables de communiquer en LSQ? Très, très peu», déplore-t-elle.
La surdité touche environ 700 à 1000 enfants francophones en Ontario, dont une centaine avec une surdité sévère ou profonde, rapporte-t-elle. Or, pour assurer un développement linguistique et cognitif équilibré, il est crucial que ces enfants aient accès à une langue visuelle dès le plus jeune âge.
«S’ils ne sont pas exposés à une langue visuelle avant l’âge de 6 ans, ils risquent une privation langagière qui aura des conséquences sur leur développement cognitif, social et affectif», alerte-t-elle.
Elle insiste sur la nécessité de former des professionnels capables de répondre aux besoins des enfants sourds et malentendants en milieu minoritaire.

Un roman pour sensibiliser
Ariane Millette est aussi autrice. Son roman, Déchiffrer la tempête, paru aux éditions Hurtubise en octobre 2024, plonge le lecteur dans la réalité des personnes malentendantes.
À travers ce récit, elle souhaite permettre aux lecteurs d’avoir une idée de ce que vivent les personnes sourdes et malentendantes. «Mon roman donne un aperçu littéralement visuel de la déformation de la parole qu’entend une personne malentendante, et ce, dès le prologue», indique-t-elle.
«J’entends par cela non seulement les barrières communicatives, mais aussi le parcours d’acceptation de sa différence, l’impact social sur l’individu et sur son entourage, les visites chez l’audiologiste et l’audioprothésiste», précise-t-elle.
À lire : Vers une revitalisation de la langue des signes inuite (Le Nunavoix)
La Française Jeanne Mance arrive à Ville-Marie (Montréal) en 1642 pour y établir une mission avec l’intention d’évangéliser et de sédentariser les Autochtones. Elle fonde un dispensaire qui devient un hôpital de huit lits, l’Hôtel-Dieu, en 1645. Pour soutenir les activités de l’hôpital, elle recrute en France des religieuses de Saint-Joseph.

Le Musée Pointe-à-Callière, à Montréal, est aménagé tout près du dispensaire ouvert par Jeanne Mance et possède une collection dédiée à celle-ci, dont une statue de cire.
Après le décès de Jeanne Mance (qui est laïque) en 1673, ces sœurs hospitalières poursuivent le travail. Elles fondèrent, plus tard, des hôpitaux en Ontario (Kingston, Windsor et Chatham) et au Nouveau-Brunswick (Tracadie, Campbellton et Saint-Basile).
Peu d’informations sont disponibles sur ses relations avec les Autochtones, outre le fait qu’elle ouvrait son dispensaire à «tous». Une lettre authentifiée en 2024 prouve cependant qu’elle était à Ville-Marie en pleines guerres franco-iroquoises, lorsque la Confédération cherchait à chasser la colonie française. Cette lettre implore Paul de Chomedey de Maisonneuve d’envoyer des soldats pour les repousser. Ce qui fut fait.
Jeanne Mance a fondé l’Hôtel-Dieu, mais a joué un rôle plus essentiel dans l’établissement de la colonie. Elle était de facto l’intendante, veillant à la gestion des finances et au recrutement de colons. Cependant, elle n’a pas été reconnue comme cofondatrice de Ville-Marie avant 2012 par la Ville de Montréal. Elle a aussi été intronisée au Temple de la renommée médicale canadienne en 2020.
Figure de la première période d’esclavage des personnes noires au Canada, Marie Marguerite Rose a passé 19 ans en servitude chez une élite coloniale de Louisbourg, à l’ile Royale (aujourd’hui le Cap-Breton).

Depuis une vingtaine d’années, Charlene Chassé incarne Marie Marguerite Rose au Lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg.
Affranchie en 1755, elle épouse un Mi’kmaq et ouvre une taverne et une pension. Elle se hisse ainsi au rang de commerçante. Elle fait partie des trois seules femmes esclaves qui seront affranchies à l’ile Royale.
Capturée en Afrique de l’Ouest, aujourd’hui la Guinée, Marie Marguerite Rose arrive à l’ile Royale en 1736, à 19 ans environ. Elle y est vendue à un officier à Louisbourg; elle est renommée et baptisée. Dans la résidence de la famille Loppinot, elle est la principale domestique et elle veille à la cuisine et à l’entretien ménager.
Entre 1713 et 1758, au moins 268 personnes auraient été esclaves à Louisbourg. Selon l’historien Ken Donovan, l’ile Royale en comptait 125 en 1757, ce qui représentait 3 % de la population. Sous le Régime français, 1 375 personnes noires auraient été esclaves.
Marie Marguerite Rose a été reconnue comme personnage historique national du Canada en 2008 puisqu’elle aurait été une des premières femmes d’affaires noires au Canada.
Dorimène Desjardins s’implique activement dans la mise sur pied des caisses populaires. Son mari Alphonse, inspiré par un débat à la Chambre des Communes où il travaille comme sténographe, s’intéresse au crédit coopératif et imagine – avec elle – un pacte social.

Dorimène, Alphonse et leur fille Albertine devant le Parlement à Ottawa en 1913.
En 1900, 132 personnes signent ce pacte. Une caisse d’épargne et de crédit voit ainsi le jour dans le domicile de la famille Desjardins, à Lévis, au Québec.
Dorimène Desjardins travaille concrètement à la fondation des caisses. À une époque où les femmes n’avaient pas le droit d’ouvrir un compte bancaire sans le consentement de leur mari, elle gère les activités quotidiennes de la caisse et prend part à l’orientation et à l’expansion du mouvement.
Avant 1920, elle participe à la fondation de 187 caisses d’économie au Québec, 24 en Ontario et 9 aux États-Unis. Le mouvement coopératif prend racine, partout au pays. L’historienne Maude-Emmanuelle Lambert écrit que plusieurs de ces comptoirs sont établis dans des foyers et tenus par des femmes.
Le décès de son mari, en 1920, révèle l’important rôle de Dorimène Desjardins. «Elle aura été assurément l’une des femmes les plus au courant de la question économique considérée au point de vue social», peut-on lire dans L’Action catholique à son décès, en 1932.
Sa contribution, peu documentée, est reconnue de son vivant. Tombée ensuite dans l’ombre, Dorimène Desjardins est depuis passée à l’histoire comme cofondatrice du mouvement.
À lire : Le Mouvement Desjardins en Ontario : 100 ans d’histoire (L’Express.ca)
La Franco-Manitobaine Gabrielle Roy écrit son premier roman à Montréal, Bonheur d’occasion. Inspirée par des promenades à pied dans un quartier défavorisé, la romancière décrit dans son livre la misère de la ville, une première. Son œuvre obtient un succès populaire et critique instantané.

Gabrielle Roy, en 1946.
Gabrielle Roy est née en 1909 à Saint-Boniface, au Manitoba. Enseignante de jour, elle consacre ses temps libres au théâtre, au Cercle Molière. Cette passion la mène à Paris et à Londres, où elle étudie l’art dramatique. Elle s’installe à Montréal au tournant des années 1940 et y travaille comme journaliste.
Bonheur d’occasion vaut maints prix à Gabrielle Roy. Elle sera la première personne à recevoir la médaille de l’Académie des lettres du Québec. Elle devient ensuite la première Canadienne à remporter le prestigieux Prix Femina, un prix littéraire établi en 1904. Le Prix littéraire du Gouverneur général sera décerné à la version anglaise du roman, intitulé The Tin Flute.
On dit que Bonheur d’occasion a contribué à renouveler le roman au Québec et au Canada en y introduisant le réalisme urbain. N’empêche, le Manitoba constitue pour Gabrielle Roy «un réservoir de souvenirs et d’images ineffaçables», écrit le spécialiste François Ricard.
Gabrielle Roy demeure une figure dominante de la littérature contemporaine et est reconnue comme une grande auteure sur la condition humaine.
À lire : Trois autrices qui ont marqué la littérature (Chronique)
Jeanne Sauvé est la première femme désignée présidente de la Chambre des Communes, en 1980. Devant la Chambre, elle se montre ferme – elle doit veiller au maintien de l’ordre et du décorum – et impartiale. Mais dans les coulisses, elle revoit des pratiques inefficaces et allège la bureaucratie.

Jeanne Sauvé, gouverneur général, et son mari Maurice Sauvé, à Ottawa, en 1984.
Jeanne Sauvé est née en Saskatchewan en 1922 et a grandi à Ottawa. De retour au Canada après un séjour en Europe, elle mène une carrière de journaliste et de commentatrice politique pendant 20 ans.
Elle fait le saut en politique fédérale en 1972 en se faisant élire dans une circonscription du Grand Montréal. Elle devient la première femme francophone à entrer dans le Cabinet du gouvernement fédéral, notamment à titre de ministre de l’Environnement et aussi des Communications.
En 1984, elle est assermentée comme gouverneur général du Canada et devient la première femme à représenter la couronne britannique au Canada. C’est aussi à Jeanne Sauvé que l’on doit la première garderie sur la colline du Parlement.
Soulignons qu’en 1980, la présidence de la Chambre n’est pas choisie par la Chambre, comme c’est le cas depuis 1986. C’est plutôt le premier ministre qui propose une nomination à la Chambre.
Le 6 mars 2025, Parcs Canada a désigné Jeanne Sauvé comme une personne d’importance historique nationale.
Pour lire les articles complets : https://francopresse.ca/
Université d’Ottawa : Des lettres dénoncent un «démantèlement» de la francophonie à la Faculté de médecine
Un «climat hostile» envers les francophones à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa
Rachel Bendayan : «Les langues officielles ont toute leur place»
Dépassement de la cible en immigration francophone : «On veut s’assurer des ressources»
Ces femmes francophones qui accouchent en anglais
Le retour de Damien et de Calamity Jane
La parité hommes-femmes en politique, encore loin du compte au Canada
Troubles physiques résultant d’agressions sexuelles, «douleurs physiques de longue durée», difficultés liées à la reproduction et aux menstruations : «Les problèmes spécifiques aux femmes sont invisibles», déclare une vétérane nommée Christine Wood dans un rapport d’étude du Comité permanent des anciens combattants.
«Il existe un énorme manque de connaissances sur la manière de soutenir les femmes, tant en matière de performance que de médecine et de soins de santé», appuie la chercheuse Chris Edwards, qui étudie les considérations sexospécifiques relatives à la performance et aux blessures chez les militaires et intervenants d’urgence, en entrevue avec Francopresse.
À lire aussi : Vétéranes de l’armée : un long chemin vers la reconnaissance
Malgré les lacunes qui persistent en santé féminine, Chris Edwards, qui a témoigné devant le Comité, remarque une évolution au sein des Forces armées canadiennes (FAC).

«L’“unisexe” est un mythe créé par la maitrise des couts, explique Rebecca Patterson. Dans le contexte militaire, si l’équipement te fait mal, tu es plus à risque d’être blessée.»
«Depuis le comité en fait, il y a eu une poussée d’efforts, observe-t-elle. Les [FAC] ont récemment fait leur premier entrainement avec un avatar féminin.» Avant cette année, les soins de santé étaient seulement pratiqués sur l’avatar d’un corps masculin.
«Si quelqu’un n’a pas été formé à retirer un soutien-gorge pour vérifier des blessures à la poitrine… dans ces moments [de haut stress], c’est la mémoire musculaire qui prend contrôle, explique Chris Edwards. Il faut donc répéter et répéter lors des entrainements. Comme ça, quand ça arrive pour de vrai, on le fait sans même y penser.»
Un autre exemple concerne les changements corporels liés à la périménopause et à la ménopause, pour lesquels il existe désormais des «guides très clairs». «C’est très important que nous regardions le sexe biologique quand on considère la santé», dit-elle.
«Du travail se fait», reconnait de son côté la vétérane et sénatrice Rebecca Patterson, notamment au niveau de l’accès aux culottes et produits menstruels. «Des appareils urinaires pour permettre aux femmes d’uriner debout lorsqu’elles sont sur le terrain ont aussi fait leur apparition dans les dernières années», ajoute-t-elle.
Le comité parlementaire a rapporté les témoignages de vétéranes ayant subi une ablation des seins afin de pouvoir porter l’uniforme militaire, conçu pour un corps typiquement masculin, confortablement.
La directrice de la branche «Santé des femmes et de la diversité» des FAC, Helen Wright, confie en entrevue avec Francopresse qu’elle et les collègues qu’elle a consultés n’avaient jamais entendu parler d’ablation des seins avant le rapport du comité.

Helen Wright estime que l’équité permet de considérer les spécificités des femmes. C’est le principe qui guide la branche qu’elle dirige, «Santé des femmes et de la diversité», au sein des FAC.
Selon elle, la décision d’effectuer cette modification corporelle résulte d’une réflexion plus «large» et «compliquée» qu’un uniforme mal adapté.
Pourtant, Le Droit rapportait il y a quelques semaines que certaines femmes qui travaillent actuellement au sein des FAC songent, encore aujourd’hui, à réduire la taille de leurs seins à cause de l’uniforme.
Helen Wright assure que de la recherche est présentement menée sur le remodelage d’uniformes, de la protection balistique, de sacs à dos spéciaux et sur la santé des femmes en général. Du personnel spécialisé en santé féminine a aussi été intégré aux FAC.
«Il demeure encore du travail à faire […] Mais je dirais qu’à partir du moment où on est assis devant un médecin ou autre professionnel de la santé, on reçoit le même niveau de qualité dans les soins, que l’on s’identifie comme une femme, un homme ou à une diversité de genre», assure Helen Wright.
À son avis, le problème n’est pas dans la qualité des soins, mais dans la manière dont le système est conçu. Par exemple, le dépistage du cancer du col de l’utérus peut s’avérer difficile quand on fait de longs séjours à l’étranger, car les rendez-vous de dépistage peuvent devoir attendre, illustre Helen Wright.
À lire ailleurs : DOULEURS AU SEIN DE L’ARMÉE | «Mon corps a dû être modifié» (Le Droit)
«La neutralité de genre exclut les femmes», a statué Rebecca Patterson devant le comité parlementaire. Pendant longtemps, cette neutralité résultait de la prédominance masculine au sein des FAC.
C’est ce qui faisait en sorte, par exemple, que les uniformes n’étaient pas adaptés au corps typiquement féminin, explique-t-elle en entrevue avec Francopresse. «Les femelles et les femmes ont des différences biologiques et sociales qui doivent être prises en compte.»
Aujourd’hui, la neutralité de genre a une tout autre signification.

Maya Eichler est professeure agrégée d’études politiques et d’études féminines. Elle est également directrice du Centre pour l’innovation sociale et l’engagement communautaire dans les affaires militaires à l’Université Mount Saint Vincent.
La chercheuse Maya Eichler a étudié le genre au sein des FAC. L’approche de neutralité de genre était au départ une manière d’éviter les politiques discriminatoires, explique-t-elle. «C’était plus comme une cécité au genre.»
Les enjeux spécifiques aux femmes étant ainsi ignorés, les choses ont changé, notamment par le financement de recherches sur la santé des femmes. Ce qui est encore plus nouveau, dit-elle, c’est l’ajout des questions de diversité de genre.
«Dans un sens, ça vient d’une bonne place parce qu’ils tentent d’être inclusifs, mais je crois aussi que c’est potentiellement problématique parce que c’est peut-être en train de réduire la visibilité des expériences distinctes des femmes.»
«Souvent, ils vont mettre les femmes, 2SLGBTQI+ et la diversité de genre, bref, tous ceux qui ne sont pas des hommes, dans un même panier. Je vois là une nouvelle façon par laquelle les femmes sont potentiellement invisibilisées, poursuit Maya Eichler. Il faut trouver un équilibre.»
Des vétéranes ont exprimé à Helen Wright une préoccupation similaire quant au titre de la branche «Santé des femmes et de la diversité» : «Certaines ne sont pas très contentes que l’on ait ajouté “diversité”, parce qu’elles pensent que ça retire de l’attention aux femmes.»
À son avis, il n’y a pas de risque d’invisibiliser les femmes, parce qu’il y a justement une emphase sur la diversité des besoins, y compris ceux des femmes. «Ce qu’est une femme au sein des FAC englobe en fait un large éventail d’individus. On ne peut pas séparer les autres éléments de l’identité de quelqu’un pour dire que c’est juste une femme.»
À lire aussi : Purge LGBT au Canada : en parler «pour ne pas que l’histoire se répète»

Steven MacKinnon a annoncé des financements additionnels pour 14 organismes à travers le pays, dont 13 francophones en situation minoritaire, pour aider à favoriser des marchés du travail bilingues.
Lundi, la députée francophone d’Ottawa–Vanier, Mona Fortier, a dévoilé que le gouvernement fédéral avait dépassé le seuil de 6 % d’immigrants francophones qu’il s’était fixé pour 2024, atteignant 7,21 %.
Marché du travail francophone
L’élue a également annoncé plusieurs financements pour la francophonie, prévus pour la plupart dans le Plan d’action pour les langues officielles 2023-2028.
Le programme «Nouvel élan», financé à hauteur de 836 000 $ sur deux ans, soutient le recrutement de talents francophones qualifiés, en mettant en relation des employeurs et candidats à Paris en France, Douala au Cameroun et en ligne.
Une enveloppe de 909 000 $ sur quatre ans doit répondre à la pénurie de main-d’œuvre dans le Nord de l’Ontario. L’Ontario accueillera 90 réfugiés et travailleurs qualifiés francophones ainsi que leurs familles.. Ce montant cible aussi les secteurs prioritaires dans les communautés francophones rurales.

Le président-directeur général du RDÉE Canada, Yan Plante, a affirmé vouloir voir plus de données liées à la francophonie économique, en plus du recensement.
Mercredi, le gouvernement du Canada a ajouté 20,5 millions de dollars sur cinq ans (2023-2028) au Fonds d’habilitation pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (FH-CLOSM), en plus du financement des 74,5 millions déjà prévus.
L’annonce a été faite par le ministre fédéral de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, Steven MacKinnon.
Ce fonds soutient 14 organismes à travers le pays pour renforcer le développement économique. Treize d’entre eux sont dédiés aux francophones hors Québec et un aux anglophones du Québec.
Yan Plante, le président-directeur général du Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE) Canada a confirmé en entrevue avec Francopresse que son organisme avait des «attentes» sur les données des francophones et l’emploi, en plus du recensement des ayants droit.
À lire aussi : Économie : des données sur les francophones minoritaires se font toujours attendre
Appui à la petite enfance francophone
Une étude faite par la Commission nationale des parents francophones (CNPF), avec 592 000 $ sur trois ans, vise par ailleurs à faciliter la reconnaissance des diplômes étrangers en petite enfance.
Cette enveloppe fait partie des 47,7 millions de dollars alloués à la CNPF pour mettre sur pied le Réseau d’intervenants en petite enfance, qui coordonnera la mise en place d’initiatives spécifiques pour les communautés francophones en situation minoritaire partout au Canada.
L’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) reçoit quant à elle 16,3 millions de dollars afin d’élargir et poursuivre le développement de programmes de formation initiale, continue et spécialisée de la petite enfance.
La députée Mona Fortier a souligné le recrutement de 100 éducateurs francophones formés à l’étranger en petite enfance par l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance en Ontario (AFÉSEO). L’appui fédéral s’élève à 525 000 $ sur quatre ans.
Des fonds pour la vie communautaire en français
Mercredi, le député d’Ottawa–Centre, Yasir Naqvi, a débloqué les 8,5 millions de dollars prévu dans le Plan d’action pour les langues officielles pour cinq organismes qui appuient l’enseignement et les études en français.
Enfin, Mona Fortier a annoncé le même jour que le programme Nouveaux Horizons pour les ainés reçoit un montant maximal de 342 805 $ pour financer 16 projets communautaires dans la région d’Ottawa–Vanier. Un appui qui aidera les ainés à vieillir avec une meilleure sécurité financière.
Lisez notre infolettre
les mercredis et samedis

À la veille de l’application des 25 % de taxes américaines désirées par Donald Trump sur les biens canadiens, Justin Trudeau a affiché un ton plus dur.
Mercredi, lors d’un appel entre Justin Trudeau et Donald Trump – que le premier ministre canadien a qualifié de «coloré» – et en pleine semaine d’application des tarifs douaniers américains de 25 % sur les biens canadiens, les premiers ministres des provinces et territoires et le fédéral ont décidé de lever tout obstacle interprovincial, en signe d’unité face aux États-Unis.
Jeudi, Donald Trump a signé un décret pour finalement exempter jusqu’au 2 avril les biens canadiens et mexicains inclus dans l’Accord Canada-États-Unis-Mexique. Ce qui se profile : Les premiers ministres ont ainsi décidé de réduire les barrières au commerce et à la mobilité de la main-d’œuvre afin de faciliter la libre circulation des biens, des services et des travailleurs au Canada. Le Québec conservera des mesures adaptées à ses spécificités linguistiques.

Pierre Poilievre s’est quant à lui porté à la «défense» des Canadiens, mardi, dans un message destiné à Donald Trump.
Ils ont aussi insisté sur la reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles entre provinces et territoires, avec l’objectif de réduire à 30 jours maximum le délai de validation des titres de compétences. Un plan pancanadien devrait voir le jour le 1er juin prochain.
Ils ont aussi encouragé la consommation de biens canadiens en réduisant les différences règlementaires entre provinces.
Jeudi, Justin Trudeau a rappelé que cette guerre commerciale était «injustifiée». Plus tôt dans la semaine, il avait déclaré que la décision du président Trump sur les tarifs était «stupide».
Le même ton dur a été employé par Pierre Poilievre mardi. «Le président Trump a trahi le meilleur ami des États-Unis», a fustigé le chef conservateur.
À lire aussi : «Donald, c’est vraiment stupide ce que tu fais» (Le Droit)
Justin Trudeau a annoncé jeudi un prolongement de cinq ans, de 2026 à 2031, du programme fédéral de garderies, avec des ententes totalisant près de 37 milliards de dollars signées pour l’instant avec 11 provinces et territoires.
Enjeu : L’objectif est de créer plus de places à 10 $ par jour et d’augmenter le financement de base de 3 % par an dès 2027-2028 pour couvrir les couts d’exploitation.

L’ancien député libéral d’Halifax Andy Fillmore a été élu maire de la ville l’automne dernier.
L’Ontario a confirmé sa participation, mais des négociations sont encore en cours avec l’Alberta et la Saskatchewan.
À lire aussi : Commerce interprovincial : le Canada avance, tarifs ou non
Une élection partielle fédérale se tiendra le 14 avril prochain dans la circonscription d’Halifax, en Nouvelle-Écosse. L’annonce a été faite par Justin Trudeau, dans la foulée de la démission du député Andy Fillmore, élu maire d’Halifax à l’automne dernier.
Si des élections fédérales sont déclenchées avant le 14 avril, l’élection partielle sera toutefois annulée, a précisé Élections Canada plus tôt cette semaine.
«Pendant un accouchement, le niveau de stress est déjà super haut. Alors quand ça n’est pas dans sa langue, c’est super difficile. On ne peut pas nécessairement dire ce que l’on veut et ce que l’on ressent […] On espère se faire comprendre», confie la Franco-Canadienne, Adeline Dubreuil-Mahé, qui habite aujourd’hui dans la région d’Halifax.

Vanessa April-Gauthier est une doula postnatale bilingue dans la région d’Halifax.
La mère de famille, arrivée au Canada il y a 18 ans, a donné la vie à son premier enfant en Colombie-Britannique. Son accouchement a duré 36 heures, et les médecins ont dû pratiquer une césarienne en urgence.
Adeline Dubreuil-Mahé n’a pas oublié l’anxiété ressentie par rapport aux termes médicaux inconnus, son «air ahuri» devant le personnel médical purement anglophone, les questions continuelles qu’elle posait sur les produits qu’il lui injectait.
«On n’a pas toujours la force de penser vite dans une langue qui n’est pas la sienne. J’ai réussi tant bien que mal à comprendre, car je m’étais préparée. J’avais lu des livres en anglais pour m’éduquer», témoigne-t-elle.
«Quand on accouche, on n’est pas nécessairement en contrôle de son cœur et de son cerveau. Si en plus ce n’est pas dans sa langue, on se sent encore plus vulnérable et sous pression», abonde dans le même sens la doula postnatale à Halifax, Vanessa April-Gauthier.
Le second bébé d’Adeline Dubreuil-Mahé est né à Halifax trois ans et demi plus tard, en pleine pandémie de COVID-19.
On ne nous a jamais proposé de services en français, car ils n’ont pas de staff bilingue. Ce n’est pas normal. Il y a un très grand manque.
Durant le premier trimestre de grossesse, des saignements l’obligent à se rendre aux urgences. Elle doit attendre sept heures à l’hôpital, «seule et complètement terrorisée», avant de voir un médecin : «Il a essayé de me rassurer avec quelques mots de français, mais c’était largement insuffisant.»
La sagefemme Elizabeth LeBlanc, originaire du Nouveau-Brunswick, a également «perdu» son anglais durant son deuxième accouchement en Ontario.

«La plupart des fournisseurs de soins sont surchargés et ont de moins en moins de temps à passer avec les patientes», regrette la sagefemme Elizabeth LeBlanc.
«Pour moi, c’est une langue apprise. Je n’étais plus capable d’exprimer mes besoins, mes émotions. Heureusement que mon mari était là pour me traduire», raconte l’Acadienne.
«Ça m’a vraiment marqué. J’ai réalisé l’importance d’avoir des soins dans sa langue maternelle. C’est tellement bénéfique pour la qualité des soins», poursuit-elle.
Des services de traduction sont disponibles dans la plupart des hôpitaux, mais les gens préfèrent souvent faire appel à des proches, rapporte la professeure au Département de médecine familiale de l’Université d’Ottawa et chercheuse à l’Institut du savoir Montfort à Ottawa, Marie-Hélène Chomienne.
Elle ne recommande cependant pas cette pratique : «La patiente ne voudra pas forcément tout dire à un ami. Si un résultat d’échographie est inquiétant, c’est très délicat de le dire d’abord à un tiers qui va ensuite le traduire. Il n’aura pas toujours les bons mots.»
À lire aussi : Soin des enfants, cuisine, ménage : le combat quotidien des femmes
Installée à l’Île-du-Prince-Édouard depuis juillet dernier après avoir exercé comme sagefemme plusieurs années en Ontario, Elizabeth LeBlanc est devenue pour sa part une «militante». Elle met un point d’honneur à proposer des services en français de façon proactive.
Quand il y a des complications pendant une naissance, on n’a souvent pas le temps d’expliquer et de traduire ce qui se passe. Chaque seconde compte. Ça peut être source de traumatisme.

«On en est rendu au point où les francophones doivent demander des soins en français. Ce n’est pas proposé, ce n’est pas normal», dénonce Adeline Dubreuil-Mahé en Nouvelle-Écosse.
«Il peut y avoir des bris de communication quand le professionnel de santé ne parle pas la même langue maternelle, même si la patiente est bilingue. Les conséquences peuvent être très graves», confirme Marie-Hélène Chomienne.
«Les femmes peuvent se sentir mal à l’aise et mises de côté. Les médecins ont tendance à ne pas tout leur expliquer en détail, car elles sont francophones», ajoute-t-elle.
À ses yeux, la «concordance de la langue» est d’autant plus importante pour détecter des problèmes de santé mentale, comme la dépression postpartum.
Elizabeth LeBlanc insiste à cet égard sur l’importance de partager en amont le plus d’informations possible sur les urgences et les ennuis pouvant survenir pendant et après une naissance.
À lire aussi : La santé des femmes noires francophones encore mal prise en charge
De nombreuses femmes enceintes n’ont néanmoins pas la chance d’être suivies par une sagefemme durant leur grossesse.
«Nous ne sommes pas assez nombreux et, en français, c’est pire. Il y a des listes d’attente partout, que ce soit ici à l’île[-du-Prince-Édouard] ou dans le reste du Canada», affirme Elizabeth LeBlanc.
La situation s’est fortement aggravée depuis la fermeture, en 2021, du programme de formation de sagefemmes de l’Université Laurentienne, en Ontario. Il s’agissait du seul et unique cursus en français à l’extérieur du Québec.

«L’accouchement est parfois le moment le plus douloureux de ta vie. Ce n’est pas un moment où tu as la force de parler dans une langue qui n’est pas la tienne», affirme la sagefemme Kim Cloutier Holtz.
Selon Kim Cloutier Holtz, sagefemme depuis quinze ans dans la région du Témiscamingue dans le Nord de l’Ontario, les universités d’Ottawa et de Lakehead montreraient de l’intérêt pour relancer le programme.
«Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça prendra quatre à cinq ans avant d’avoir la première vague de gradués capables d’exercer», prévient Kim Cloutier Holtz.
En attendant, la Franco-Ontarienne est seule pour servir une population de quelque 16 000 personnes. Elle accompagne environ 40 futures mamans chaque année et doit refuser de nombreuses clientes. «Je pourrais embaucher deux autres sagefemmes pour répondre à la demande», relève-t-elle.
Forte de son expérience, Adeline Dubreuil-Mahé a, elle, décidé de se reconvertir comme doula postpartum. Avec l’envie de soutenir les jeunes mamans dans la période qui suit la naissance.
À lire aussi : Services en français pour les femmes victimes de violence : la double peine
Rachel Bendayan : Je sais que c’est très attendu, par mes conversations avec les parties prenantes. J’ai pu rencontrer la ministre [Ginette] Petitpas-Taylor pour en parler. On travaille de concert là-dessus évidemment.
C’est le Conseil du Trésor qui est responsable, mais je suis le dossier de très près, étant donné que j’ai les deux autres règlements qui sont également attendus.
On veut s’assurer que tous nos règlements, les trois, soient vraiment à la hauteur. Évidemment, il y a énormément d’exigences en matière de consultations et pour bien les faire, ça prend du temps, mais nous serons prêts pour les déposer en temps et lieu en Chambre.
À lire aussi : «Le temps n’est pas notre ami» : la Loi sur les langues officielles suscite l’impatience au Parlement
Je pense qu’il faut commencer par trouver un nouveau chef et ensuite on verra. Effectivement, moi, mes instructions – et je pense que c’est le cas également pour la ministre Petitpas Taylor – c’est d’être prête [à aller en élections] si jamais.
On a eu notre première rencontre [avec les provinces et territoires, NDLR] le 20 février et c’était une très belle rencontre. Je vois une volonté incroyable de faire avancer le fait français partout à travers le pays.
Pour ce qui est des ententes bilatérales, la Colombie-Britannique a signé. J’ai vraiment hâte de voir la réaction de la communauté francophone dans la province parce que je sais qu’il y a des parents sur des listes d’attente pour envoyer leurs enfants dans des écoles bilingues ou de français et c’est très important de continuer à promouvoir et à encourager cette volonté de notre population pour l’éducation en français.
D’autres annonces sont prévues dans les prochains jours et semaines et, vraiment, la réaction de mes homologues à date était très positive.
Bien au contraire, quant à moi, elle a toute sa place. Renforcer notre identité est exactement de ce dont on parle en ce moment, renforcer notre identité canadienne, ce qui nous rend si spécial en tant que pays. C’est assurer nos valeurs et, pour moi, c’est très d’actualité.
C’est important de s’en rappeler dans ces moments où notre souveraineté est menacée. On se pose la question : «Qu’est-ce qu’on pourrait perdre?»
Et on peut perdre énormément. Nous avons nos propres forces, nos propres richesses en tant que Canadiens et de ce que je vois et ce que j’entends sur le terrain, c’est que les Canadiens veulent aller au front pour les défendre.
À lire aussi : L’économie franco-canadienne doit se tourner vers l’est et l’ouest
De un, moi je ne l’entends pas ici au Québec. De deux, je dirais que notre gouvernement a sorti un plan afin de financer Radio-Canada. Je ne vois pas comment les gens qui ont à cœur nos deux langues officielles peuvent même considérer de voter pour un parti qui veut fermer [CBC].
Nous avons davantage besoin de nos institutions publiques comme [CBC/Radio-Canada] pour non seulement s’assurer de la diffusion dans nos deux langues des informations, mais aussi comme enjeu de sécurité nationale et de souveraineté canadienne.
Je n’aime pas trop me fier aux sondages, mais on sent quand même un vent de changement. Puis c’est clairement ce que j’entends sur le terrain.
Les propos ont été réorganisés pour des raisons de longueur et de clarté.