L’un des trois règlements attendus par les communautés de langue officielle minoritaires (CLOSM) a été déposé le 26 novembre à la Chambre des Communes. Le ministre responsable des langues officielles, Steven Guilbeault, a déposé l’avant-projet de règlement.
Trois catégories de sanctions sont mises en place. Le Type A correspond à des violations liées aux services conventionnés et est associé à des amendes pouvant aller jusqu’à 25 000 $.
Le Type B vise d’autres les «manquements à la partie IV (communications et services au public)» de la Loi sur les langues officielles. Ils peuvent faire l’objet d’une pénalité jusqu’à 50 000 $.
Le Type C couvre des violations touchant la santé ou la sécurité du public. Ce dernier dispose d’une palette de sanction très large puisque les entités visées pourraient devoir débourser entre 5000 et 50 000 $.
– Mise à jour le jeudi 27 novembre à 15 h 21 –
La Loi mentionne que le plafond des sanctions administratives pécuniaires est de 25 000 $.
Dans ce nouveau règlement, si le gouvernement double la sanction pécuniaire à 50 000 $, par rapport à la limite de 25 000 $ évoqué dans la Loi sur les langues officielles, les sanctions imposées en vertu du règlement pourront être contestées en cour.
En entrevue avec Francopresse, le ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, Steven Guilbeault, ne commente pas directement cette disparité.
En revanche, il affirme que le règlement est modifiable pour aider le commissaire à encadrer ses nouveaux pouvoirs : «Comme gouvernement responsable, si jamais je vois qu’il y a une organisation dans le portefeuille où ça ne va pas, il y a trop de demandes, où il n’y a pas assez de ressources, on est capable de corriger le tir. […] Et si au besoin, on voit que ça ne fonctionne pas, qu’il faut faire des changements, on est prêt à le faire.»
– –
Le projet de règlement donne le pouvoir au commissaire aux langues officielles de déterminer le montant d’une sanction en fonction d’une liste de critères aggravants ou atténuants. Ils comprennent la fréquence ou la répétition de la violation, ses impacts réels ou potentiels sur les personnes concernées, les efforts déployés pour corriger la situation, ainsi que la taille et la capacité d’action de l’organisation.
La liste de ces critères vise à assurer une application des sanctions adaptée à chaque situation d’infraction de la Loi.
La période de consultation publique pour le projet de règlement est lancée. Il entrera officiellement en vigueur lorsqu’il pourra être adopté après cette période.
À lire aussi : Loi sur les langues officielles : Steven Guilbeault promet des règlements d’ici Noël

Le commissaire aux langues officielles aura de nouveaux pouvoirs de sanctions grâce à une nouvelle application de la Loi sur les langues officielles, publiée le 26 novembre.
Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, a réagi par écrit dans un courriel à Francopresse au dépôt. «Mon équipe et moi ferons une analyse approfondie de l’avant-projet de règlement afin d’en comprendre la nature et la portée sur les opérations du Commissariat, les communautés de langue officielle en situation minoritaire et la population canadienne.»
«Les attentes envers le régime linguistique modernisé sont élevées, et il est essentiel que le gouvernement se donne les moyens de les rencontrer. Les règlements sont fondamentaux à la mise en œuvre de mes pouvoirs, qui protègeront davantage les communautés de langue officielle en situation minoritaire et la population canadienne.»
«J’attends encore avec impatience le dépôt au Parlement des avant-projets de règlements sur la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale (LUFEP) ainsi que sur la partie VII de la Loi sur les langues officielles afin de pouvoir tirer pleinement parti de tous les pouvoirs que me confère la Loi sur les langues officielles modernisée.»
À travers ces amendes, ce sont davantage la confiance des voyageurs que le gouvernement tente de rétablir. Le projet de règlement mentionne qu’il a pour but de «réduire la fréquence des manquements à la Loi sur les langues officielles et renforcer la confiance du public envers les institutions fédérales».
Le commissaire aux langues officielles avait jusqu’à présent seulement le pouvoir de traiter les plaintes et d’émettre des recommandations avant que le les personnes qui portent plainte n’aient le choix de saisir la justice. Ces pouvoirs de sanctions monétaires sont donc tous nouveaux.
L’affaire qui avait déclenché la fureur des francophones et qui est en bonne partie à l’origine de ce règlement concerne le PDG d’Air Canada, Michael Rousseau, qui avait prononcé un discours à la Chambre de commerce de Montréal exclusivement en anglais. Il avait aussi affirmé qu’il ne rencontrait pas de problème à Montréal sans parler français.
Une semaine plus tard, le Commissariat aux langues officielles avait reçu plus de 2000 plaintes à propos du transporteur aérien.
À lire aussi : Affaire du PDG d’Air Canada, «le perpétuel recommencement»
L’annonce du budget du gouvernement de Mark Carney n’a pas changé grand-chose, amorce Emmanuelle Billaux, directrice générale chez Actions Femmes Île-du-Prince-Édouard.
Quelques jours avant le dépôt du budget, plus de 660 millions de dollars sur cinq ans ont été annoncés pour le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres (FEGC). «C’est plus gros que ce qui était annoncé avant les coupures – mais c’est plus petit que ce qu’on avait sur les dernières années», dit-elle.
Selon l’Union culturelle des Franco-Ontariennes (UCFO), cette enveloppe équivaut à 120 millions de dollars par année, contre 427 millions l’année précédente. Soit une réduction de 72 %.

Surtout, ce qui nous garde dans la crainte, c’est qu’il n’y a aucune mention des femmes francophones dans le budget, il n’y a aucune target spécifique pour la minorité linguistique.
La directrice générale de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC), Soukaina Boutiyeb, abonde dans le même sens : «Il y a eu un manque d’explication sur comment ce budget serait associé par rapport à la francophonie canadienne.»
L’AFFC discute actuellement avec Ottawa, «mais à l’heure où on parle, rien ne nous garantit que justement des financements seront accordés aux organisations de femmes de la francophonie canadienne», statue-t-elle.
L’UCFO craint une baisse des services et des programmes de soutien pour les femmes vivant de la violence et un affaiblissement du tissu associatif rural.

Pour Sylvie Gravelle de l’UCFO, le gouvernement fédéral ne prend pas en compte les besoins des minorités linguistiques.
«On a toujours des isolements linguistiques dans nos villages. Quand on est rural, on a déjà des services qui ne sont plus là, puis les dames sont inquiètes que les services soient encore coupés, rapporte la présidente de l’organisme, Sylvie Gravelle. Elles ont l’impression d’être des citoyennes de seconde zone.»
La responsable trouve que le fédéral oublie les femmes et les francophones. «S’ils veulent avoir un Canada fort, c’est un pays où les femmes francophones vivent en sécurité […] Ce sont nos subventions qui peuvent aider ça, on ne veut pas devenir invisibles. On ne veut pas perdre notre langue.»
«Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les femmes partout au pays, y compris dans les communautés francophones», assure le ministère FEGC dans un courriel à Francopresse.
Il rappelle que le gouvernement du Canada applique l’Analyse comparative entre les sexes plus pour s’assurer que ses programmes et initiatives tiennent compte de la diversité des identités et des contextes, y compris des communautés francophones.
À lire aussi : Quand la violence conjugale condamne les femmes en milieu rural à un double défi
«Malgré les discours sur la vitalité du français et les promesses en matière d’immigration francophone, aucune mesure concrète n’est prévue pour renforcer les services en français dans les régions où les besoins sont criants», dénonce encore l’UCFO dans un communiqué.
L’organisme demande une ventilation annuelle transparente des montants annoncés, le maintien des budgets opérationnels accordés aux programmes d’égalité et aux organismes communautaires et un fonds protégé pour les services en français en milieu minoritaire.
«On est inquiètes, mais en même temps, on est résilientes, témoigne de son côté Emmanuelle Billaux. Depuis le début de l’été, je cherche des fonds pour l’année prochaine ailleurs qu’à FEGC tant que je ne sais pas quel est le projet applicable.»
Car pour avoir accès aux subventions, encore faut-il rentrer dans les bonnes cases.
Les femmes francophones, ce n’est pas un groupe homogène; c’est une petite partie de femmes en situation de handicap, une petite partie racialisée, une partie immigrante. Déposer un projet pour recevoir peut-être 5, 7, 8000 dollars, finalement, ça ne prend pas en compte le reste de nos femmes. Ce n’est vraiment pas assez.
À lire aussi : Les finances des organismes francophones toujours dans le rouge
C’est pourquoi Actions Femmes I.P.É plaide pour un financement de base. «Le problème des projets, on le sait, c’est que c’est chronophage, c’est de nouvelles idées qu’on doit réinventer et qui ne peuvent pas être réutilisées», détaille Emmanuelle Billaux.
On ne sait pas si nos projets vont être renouvelés ou si les nouveaux vont être acceptés. Donc de la période de février à avril, je ne peux pas garantir un emploi à mon personnel comme à moi.
«On a l’impression que le gouvernement ne nous entend pas depuis des années quand on leur explique qu’on a besoin d’un financement de base qui garantit un minimum vital», soupire la responsable.
Cela fait deux ans que l’organisme travaille sur une diversification financière, notamment pour ne pas être à la merci des changements politiques.
«On sait très bien qu’au moment des élections, il faudra probablement aller chercher des sous ailleurs et on ne peut pas, dans un avenir proche et éloigné, être financé que par le gouvernement. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Pour un mouvement féministe minoritaire, c’est trop de chance de ne pas avoir de financement d’une année sur l’autre.»

«Quand on ne donne pas des ressources aux femmes, concrètement sur terrain, ça veut dire qu’on enlève la voix aux femmes», prévient Soukaina Boutiyeb.
«La réalité sur le terrain, c’est que certaines organisations de femmes francophones canadiennes sont en mode de survie, confirme Soukaina Boutiyeb. Elles travaillent sur un essoufflement des bénévoles.»
Pour elle, l’idéal est d’avoir deux types de financement : un à projet pour répondre à des besoins particuliers et un de base, afin d’apporter des changements systémiques.
Créer des partenariats avec d’autres organismes fait également partie de la solution. Emmanuelle Billaux cite en ce sens le rôle de l’AFFC. «Je n’ai pas l’impression de me battre toute seule contre Ottawa.» Actions Femmes I.P.É et les autres associations féministes de la province se serrent aussi les coudes.
La pétition lancée par l’AFFC à la veille du budget pour mobiliser la population canadienne a récolté plus de 900 signatures. «On a été très contentes de voir l’appui qu’on a reçu», signale Soukaina Boutiyeb.
Le rapport du Commissariat aux langues officielles (CLO) rappelle que l’actuel Plan d’action pour les langues officielles a consacré 4,1 milliards de dollars dans divers programmes et secteurs relatifs aux deux langues officielles du Canada.
Malgré cela, son constat reste le même, rapport après rapport : le gouvernement a du pain sur la planche dans plusieurs dossiers.
Là où le bât blesse, ce sont les montants attribués aux communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) note le rapport : des sommes, comme pour l’éducation, ne correspondent pas aux besoins rapportés par les organismes sur le terrain.
Certains fonds n’ont pas été indexés depuis plus de 10 ans, comme a expliqué au commissaire la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, «qui a revendiqué pendant plusieurs années une majoration des fonds fédéraux, car plusieurs conseils scolaires de langue française se trouvent en difficulté», rapporte le document.
Pour corriger cette situation – en éducation et dans d’autres secteurs –, le commissaire demande que les fonds fédéraux soient versés directement aux communautés et non aux provinces ou territoires, «à défaut de clauses et d’ententes contraignantes».
Cette demande est notamment faite par le milieu de l’éducation francophone en situation minoritaire depuis des années, comme l’a rapporté Francopresse.
À l’instar du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, certains intervenants craignent que les provinces et territoires gardent une part d’une augmentation du financement pour les langues officielles et l’assignent d’autres postes budgétaires.
Selon le CLO, le financement fédéral devrait, dans la mesure du possible, être versé directement aux communautés, sauf si des clauses contraignantes dans des ententes offrent plus d’assurances que les fonds serviront bien aux CLOSM.
La Loi sur les langues officielles modernisée en 2023 demande au gouvernement d’adopter des politiques qui rétabliront le poids démographique des communautés francophones hors Québec à 6,1 %, rappelle le rapport. Il déplore du même souffle qu’aucune échéance n’ait été établie par le gouvernement pour atteindre cet objectif.
Une cible accrue de 12 % de nouveaux résidents permanents d’expression française par année d’ici 2029 constitue toutefois un «progrès», salue le commissaire.
Ce dernier affirme que la réussite dépend d’une bonne intégration et de la rétention des nouveaux arrivants.
Enfin, il manifeste son inquiétude quant au décalage entre l’information fournie à l’étranger par Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC) et la réalité des défis de vivre dans les communautés francophones minoritaires.
Plusieurs intervenants ont avoué leur embarras de voir le personnel d’IRCC offrir aux nouveaux arrivants potentiels une vision du “vivre en français” qui minimise les difficultés auxquelles ils feront face en milieu linguistique minoritaire. Je crains que cette situation décourage plusieurs nouveaux arrivants et influence leur décision de quitter leur région d’accueil, ou même le Canada
En conférence de presse mardi, il précise qu’IRCC doit «être clair à propos des réalités sur le terrain dans nos communautés minoritaires. Il y a des défis au niveau de l’employabilité, d’être en mesure de travailler en français dans certaines communautés. Trop souvent, on crée l’impression qu’on peut […] tout de suite commencer à travailler en français.»
Une telle attitude de la part du gouvernement pourrait nuire à l’attraction et à la durabilité de l’immigration francophone, ajoute-t-il.
Dans son rapport, le commissaire aux langues officielles est très clair sur un autre enjeu : les retards dans l’attribution des fonds ne font qu’exacerber l’instabilité des organismes communautaires. En découlent parfois des mises à pied et des services réduits. Des demandes de subventions sont parfois confirmées à quelques mois ou semaine de l’échéance pour faire les dépenser.
Ce problème rejoint l’une des critiques principales du commissaire dans son bilan : «Il n’y a pas d’approche commune au sein du Plan d’action» dans la manière d’attribuer les fonds.
Il reproche également la rigidité et la complexité de la reddition de compte opérée par les institutions fédérales. Le commissaire a d’ailleurs récemment réprimandé le Conseil du Trésor lors d’un passage devant le comité sénatorial des langues officielles, le 6 octobre, pour le manque d’engagement de ce ministère.
Le Conseil du Trésor «continue d’émettre des directives qui n’en sont pas», avait-il déploré. «Il y a trop de flexibilité des institutions fédérales pour faire la mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles», avait-il poursuivi.
Dans le rapport, Raymond Théberge cite l’exemple du Programme pour les langues officielles en santé (PLOS), qui émane du plan d’action.
Ce programme dispose de 206,7 millions de dollars entre 2023 et 2028, mais les conditions de reddition de compte affectent négativement la capacité des organismes à servir les communautés. Sans compter que la bonification de 10 % de son financement ne suffit pas à contrer l’augmentation du cout de la vie, fait valoir Raymond Théberge.
Ainsi, le commissaire invite le gouvernement à intégrer une plus grande souplesse dans la mise en œuvre du Plan d’action d’ici son échéance. Il recommande aussi de prendre en compte les incidences de chaque initiative prise par les différentes institutions.
Pour cela, le document interpelle le gouvernement sur l’un des trois règlements les plus attendus : la partie VII de la Loi sur les langues officielles, celui qui concerne la promotion du français et de l’anglais. Il devra être au cœur de l’action gouvernementale pour la deuxième partie du plan d’action, prévient Raymond Théberge.
À lire aussi : Loi sur les langues officielles : des règlements toujours dans le flou
Selon les informations de Francopresse, la nomination de Kelly Burke aurait été recommandée pour le poste, mais sa nomination officielle n’a pas encore été confirmée.
Raymond Théberge est en poste depuis 2017 et a vu son mandat prolongé deux fois cette année. La première fois en raison du changement de direction du Parti libéral du Canada et la deuxième fois parce que le gouvernement venait d’être élu.
Kelly Burke est une Franco-Ontarienne originaire de Cornwall. Elle est surtout connue comme ex-commissaire aux services en français de l’Ontario, de 2020 à 2023. Elle relevait à ce titre du Bureau de l’Ombudsman en tant qu’ombudsman adjointe. Elle a été la première à occuper ce poste puisque le premier ministre ontarien, Doug Ford, avait aboli le Commissariat aux services en français en 2019 pour le placer sous la responsabilité de l’Ombudsman.
Durant son mandat, Kelly Burke a résolu plus d’un millier de plaintes et enquêté sur les coupes dans les programmes en français de l’Université Laurentienne, à Sudbury.
Elle avait soudainement quitté son poste en mars 2023. Ni elle ni l’Ombudsman n’avait fourni d’explications sur la raison de son départ.
La nouvelle commissaire aux langues officielles avait ensuite occupé le poste de directrice générale du bureau de la vice-rectrice de l’Université Western.
L’avocate de formation possède une solide connaissance des droits linguistiques en Ontario, puisqu’elle a également été sous-ministre adjointe au ministère des Affaires francophones de 2014 à 2019 et sous-ministre adjointe au ministère des Collèges et Universités.
Un règlement concernant les pouvoirs du commissaire est attendu d’ici Noël.
Depuis 2022, l’introduction des outils d’intelligence artificielle (IA) générative a provoqué «une panique totale» au sein des établissements postsecondaires canadiens, estime Martine Pellerin, professeure titulaire au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta et spécialiste en technologie éducative et de l’IA en éducation.
La professeure à temps partiel au département de français à l’Université d’Ottawa, Agathe Rhéaume, dit recevoir des textes qui ne semblent pas écrits par les étudiants, mais plutôt par «un critique littéraire qui a fait plusieurs doctorats en littérature».
Elle leur recommande de ne pas sous-estimer le jugement du corps professoral, qui est tout à fait capable de détecter si les travaux ont été rédigés par une IA générative ou non.
À lire aussi : Intégrer l’IA à l’université est une responsabilité partagée

Geneviève Tellier note que l’IA économise du temps et augmente l’efficacité, comme pour faire des calculs rapides dans un tableau de données.
«On n’a pas le choix de s’adapter parce que les étudiants utilisent très largement l’intelligence artificielle. Trop, je vous dirais», confie de son côté la professeure en administration publique à l’Université d’Ottawa, Geneviève Tellier.
Néanmoins, Christian Blouin, le chef de la stratégie pour l’IA à l’Université Dalhousie, en Nouvelle-Écosse, met en garde contre l’argument que «ce texte-là semble trop bien pour cet étudiant».
Selon lui, ce critère peut entrainer le corps professoral à se méfier de façon disproportionnée des étudiants dont le français est la langue seconde, puisque l’on a tendance à croire qu’ils s’expriment moins bien que ceux qui ont le français comme langue maternelle. Il faut éviter d’être trop «agressif» lorsqu’on tente de démontrer si une IA a effectué le travail, souligne l’expert.
Il est d’avis que cette technologie ne remplace pas la capacité d’analyse et de jugement. Le rôle du personnel enseignant, selon Geneviève Tellier, est d’amener les élèves à être capables de dire : «Oui, ça a de l’allure. Non, ça n’a pas d’allure» dans ce contexte.
En octobre, la firme KPMG publiait les résultats d’un sondage pancanadien réalisé en ligne. Sur les 684 étudiants sondés, 73 % ont répondu utiliser des outils d’IA pour effectuer leurs travaux scolaires. De plus, 48 % ont l’impression que leur pensée critique s’est détériorée.
L’IA générative serait également vue positivement par des étudiants et des étudiantes de l’Université d’Ottawa. Selon les réponses à un questionnaire distribué par Francopresse*, environ 61 % des répondants et des répondantes se disent en faveur de son intégration dans l’enseignement et l’apprentissage à l’université. Une majorité, soit presque 70 %, croit apprendre «mieux» ou «plus» avec l’IA générative.
L’étudiant en première année en comptabilité à l’Université d’Ottawa, Kouakou Carl Othniel, explique qu’il utilise l’IA générative à la maison après ses cours. Il la compare à un «petit professeur» qui connait un peu tout et qui l’aide à consolider ses connaissances.
Néanmoins, 13 % des répondants croient que l’IA générative pourrait nuire à leur apprentissage : certaines personnes soutiennent que cette technologie incite à la surdépendance, la paresse et peut diminuer la créativité de ceux qui s’en servent.
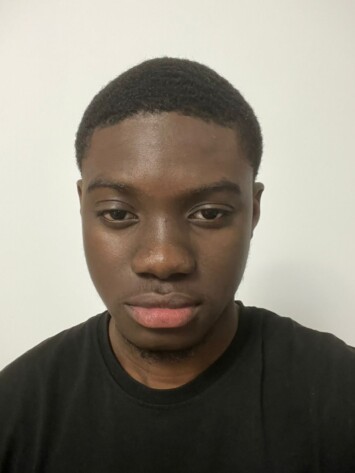
Pour Kouakou Carl Othniel, l’IA générative est utile pour évaluer les étudiants, mais on doit s’en servir avec prudence pour éviter tout abus.
L’étudiant en comptabilité Kouakou Carl Othniel explique qu’il utilise l’IA pour vérifier ses devoirs et, lorsqu’il commet des erreurs, pour recevoir des explications détaillées sur celles-ci, ce qui lui permet d’améliorer ses compétences.
Selon d’autres personnes qui ont répondu au questionnaire de Francopresse, l’IA générative est capable de créer des questions pratiques à partir de leurs notes de cours pour les examens. Ils l’utilisent comme une ressource de recherche efficace permettant d’obtenir rapidement une réponse ou pour créer des cartes mémoire et des jeux-questionnaires afin de tester leurs connaissances.
Lisez notre infolettre
les mercredis et samedis

Christian Blouin croit qu’il y a un risque à continuer d’éduquer les étudiants pour un monde qui n’existe plus. Pour lui, le corps enseignant doit donc trouver le juste milieu.
La professeure Agathe Rhéaume encourage l’utilisation du papier et du crayon et la présence en personne pour ses examens. Elle est convaincue que c’est la seule manière de vérifier quelles sont les «vraies» compétences de rédaction des étudiants.
Geneviève Tellier estime constater que les enseignants en littérature et en histoire proposent plus d’examens oraux à leurs étudiants afin d’éviter des travaux écrits par l’IA générative.
D’après la professeure en administration publique, un des principaux défis pour les professeurs est l’absence d’outils de détection fiables. Elle indique que les logiciels existants pour détecter l’IA générative «ne sont pas fiables à 100 %», contrairement à ceux utilisés pour repérer du plagiat.
Christian Blouin affirme qu’il faut éviter de rendre les évaluations «AI proof». À son avis, cela «stigmatise les étudiants en les exposant au fait qu’on pourrait les percevoir comme susceptibles de tricher». Il met l’accent sur l’importance de centrer l’évaluation sur la compréhension, plutôt que de se concentrer sur leur travail ou sa qualité.
Le spécialiste rappelle qu’on a «toujours imaginé qu’il y a des choses que seuls les humains étaient capables de faire. Maintenant, on a des logiciels capables de faire ce qu’on croyait être unique aux humains. Donc, la question est : […] “Comment est-ce qu’on s’adapte aux changements sans perdre notre humanité?”»
À lire aussi : Intelligence artificielle : les véritables enjeux au-delà des craintes

Martine Pellerin constate que les informations sur la francophonie en contexte minoritaire sont insuffisantes dans la base de données de l’IA générative, ce qui entraine des biais dans les résultats.
«Beaucoup d’enseignants n’ont pas vraiment les outils ou le temps pour explorer quelles sont les implications de l’IA dans leur domaine», souligne Christian Blouin.
Martine Pellerin ajoute que les formations en IA pour les professeurs et étudiants sont rares, ainsi que les cadres de référence pour son utilisation dans l’enseignement supérieur. Chaque enseignant peut décider d’autoriser ou d’interdire l’IA dans la plupart des établissements.
D’autres entrent les travaux des étudiants dans ChatGPT pour en faire la révision, puis donnent des commentaires inadaptés au profil de leurs étudiants, raconte la professeure. Elle explique que les enseignants ne devraient pas utiliser ChatGPT de cette façon sans autorisation des étudiants, car ces données peuvent servir à entrainer l’IA, ce qui amène des enjeux de sécurité et d’éthique.
Christian Blouin et Martine Pellerin recommandent aux professeurs de discuter avec leurs étudiants et étudiantes pour comprendre leurs motivations et identifier les stratégies à mettre en place.
Geneviève Tellier raconte qu’elle propose, depuis deux ans, des travaux optionnels sur l’IA générative. Ses étudiants et étudiantes voient d’abord la réponse de l’IA, puis cherchent dans des textes scientifiques ce que les chercheurs disent sur le sujet pour faire une comparaison. En général, l’IA ne va pas assez loin, révèle la professeure.
À lire aussi : Quelle place pour la francophonie canadienne dans l’intelligence artificielle?
Le rêve d’organiser cet évènement, Livia l’avait depuis longtemps. «L’idée m’est venue il y a deux ans. Je voulais faire découvrir aux jeunes de La Tuque ce qu’est un pow-wow, parce qu’il n’y en avait jamais eu ici».
Avant l’initiative de Livia, les pow-wow les plus proches se déroulaient dans la communauté Atikamekw de Wemotaci, à environ 1 h 30 de La Tuque, en Mauricie. La jeune fille souhaitait que les jeunes qui ne pouvaient pas se déplacer aussi loin puissent vivre, eux aussi, cette expérience.
Mais organiser un pow-wow, ce n’est pas si simple! Livia a dû relever certains défis, comme trouver des danseurs, des joueurs de tambours, et assez d’argent pour réaliser son projet. «Au début, je n’avais pas beaucoup de contacts, c’était difficile», confie-t-elle.
Puis, grâce à ses efforts, Livia a réussi à contacter plusieurs groupes pour l’aider à organiser l’évènement.
Par exemple, la ville de La Tuque a fourni de l’argent à travers son budget jeunesse, et la Maison des jeunes de La Tuque et le Centre d’amitié autochtone Capetciwotakanik ont aidé à préparer les activités. L’école secondaire de Livia a même offert le terrain pour accueillir tous les participants!

Livia et Lucie Geneviève, l’animatrice de la journée.
Le 28 aout dernier, la grande journée est enfin arrivée. Plus de 500 jeunes se sont rassemblés pour le pow-wow jeunesse organisé par Livia.
«Au début, j’étais un peu stressée parce que l’autobus qui amenait les danseurs est parti en retard. Mais finalement, tout s’est bien passé», raconte-t-elle.
Au programme : danses, tambours et partage! «Mon moment préféré, c’est quand tout le monde s’est mis à danser ensemble, dans un cercle. C’était très respectueux et vraiment magique», se souvient Livia.
Pour Livia, cette journée est une vraie fierté : «J’aimerais que les jeunes retiennent qu’il faut être fiers d’être qui on est et assumer qui on est». La suite? Livia aimerait faire une deuxième édition du pow-wow jeunesse, avec encore plus de danseurs et de participants!
Et toi, si tu organisais un évènement, que ferais-tu?
Cette histoire commence en 1985. Un plongeur du nom d’Henri Cosquer explore la mer près des Calanques, un endroit plein de falaises et de plages. En descendant profondément sous l’eau (à plus de 36 mètres!), il aperçoit un tunnel dans la roche.
Ce tunnel pique la curiosité de notre plongeur. Il décide donc d’y entrer, mais le passage est étroit et sombre. Il ne faudrait pas que ses bonbonnes d’air se vident pendant son exploration!
C’est ainsi que pendant plusieurs années, Henri Cosquer y retourne, en se rendant un peu plus loin à chaque fois. Il veut savoir où mène ce long couloir sous-marin.
Celui-ci débouche sur une grande grotte. Le plongeur pose sa lampe sur le sol, et la lumière éclaire quelque chose d’incroyable: le dessin d’une main sur la paroi!
Henri vient de découvrir un véritable trésor. Sur les murs, on peut voir des peintures et des gravures faites par des humains, il y a plus de 30 000 ans!
Mais il y a aujourd’hui un problème : la grotte est en train d’être engloutie peu à peu par la mer, puisque le niveau de l’eau augmente chaque année, à cause des changements climatiques. Si rien n’est fait, ces dessins risquent de disparaitre à jamais.
Une solution a été trouvée : recréer la grotte dans un musée, pour permettre à tout le monde de visiter cet endroit unique, sans plonger sous la mer!
Pour ça, des spécialistes (architectes, photographes, géologues, historiens) sont descendus dans la vraie grotte pour prendre toutes ses mesures. Avec ces données, ils ont construit une grotte absolument identique… dans un musée!
Ensuite, des artistes ont recopié les peintures anciennes, en utilisant les mêmes matériaux que les humains de la préhistoire : du charbon, de l’ocre, de la pierre.
Ainsi, chaque mur, chaque relief, chaque dessin a été enregistré avec une précision incroyable.

La grotte Cosquer se trouve dans le sud-est de la France, près de Marseille.
La visite du musée était très impressionnante. On embarque à bord de petits véhicules qui avancent dans l’obscurité de la grotte. Dans des écouteurs, une voix raconte l’histoire d’Henri Cosquer et nous guide en décrivant les empreintes de mains, les dessins d’animaux et de chasse.
Moi, j’ai eu l’impression d’être dans la véritable grotte Cosquer d’il y a 30 000 ans!
Toi, si tu découvrais une grotte secrète, qu’aimerais-tu y trouver ?
Tout commence en 1918, vers la fin de la Première Guerre mondiale. L’empereur Charles Ier d’Autriche-Hongrie et sa femme Zita sentent que leur empire est en train de s’écrouler.
Pour protéger leur famille, appelée les Habsbourg, ils déménagent en Suisse, loin de la guerre. Ils emportent avec eux leurs trésors. On sait qu’ils possédaient le diamant florentin, une pierre jaune géante de 137 carats. Mais après le départ des Habsbourg, le diamant n’a plus jamais été revu.
Les gens se sont demandé où est passé le précieux diamant des Habsbourg. Avec le temps, les rumeurs se multiplient. Certains disent qu’il a été volé, d’autres qu’il a été vendu ou même coupé en morceaux!
En 1922, Charles 1er meurt. Plusieurs années plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, sa femme Zita, toujours inquiète pour la sécurité de sa famille, quitte l’Europe avec ses huit enfants.
L’impératrice Zita avait emporté avec elle les bijoux de la famille dans une valise en carton.
Avec l’aide du gouvernement canadien, sa famille et elle ont trouvé refuge dans la ville de Québec. Le diamant florentin a alors été caché dans un coffre de banque pour rester à l’abri. L’impératrice Zita avait demandé que l’emplacement du diamant reste secret pour protéger le trésor de sa famille. Alors, pendant presque un siècle, personne ne savait qu’il était là!

Pendant les grandes guerres qui ont dévasté l’Europe, il n’était pas rare que des objets précieux, des bijoux et même des œuvres d’art soient envoyés au Canada ou dans d’autres pays surs. C’était pour éviter qu’ils soient volés, détruits ou endommagés.
Aujourd’hui, les descendants des Habsbourg ont décidé de révéler le secret du diamant florentin. Le précieux bijou restera ici. Après presque un siècle de mystère, ils veulent remercier le Canada d’avoir protégé ce trésor d’une valeur inestimable et d’avoir accueilli leur famille en fuite. Ils souhaitent un jour pouvoir permettre à tout le monde d’admirer le diamant dans un musée.
Et toi, quel est ton trésor le plus précieux? Si tu devais le protéger, où le cacherais‑tu et pourquoi?
«À l’âge de 19 ans, j’ai eu comme un moment où j’ai réalisé que je connaissais très bien c’est quoi être Franco-Ontarienne, mais très peu ce que ça veut dire être Abénakis», témoigne l’autrice-compositrice-interprète Mimi O’Bonsawin, membre de la Nation Waban-Aki, aujourd’hui âgée de 31 ans.
Celle qui a grandi à Sudbury a commencé à suivre des cours de langue abénakise il y a un peu plus d’un an, via Zoom, grâce au Conseil des Abénakis d’Odanak, au Québec.

«En Ontario, je rencontre plein de gens qui veulent reprendre des langues ou des traditions qui ont été perdues dans leur communauté. Mais je vois aussi que dans certaines, la langue a été gardée […] C’est vraiment beau, puis encourageant aussi», partage Mimi O’Bonsawin.
C’est en participant au pow-wow de la communauté, il y a deux ans, que l’artiste a franchi le pas. Le cercle des femmes l’a invitée à se joindre à elles. «Je ne connais pas trop les chansons», les a-t-elle prévenues. «Eh bien, c’est comme ça qu’on apprend», lui ont-elles répondu.
Quelques mois plus tard, lors d’un festival en Australie, Mimi O’Bonsawin confie à un duo de musiciennes autochtones : «Je pense que je vais jamais être capable de chanter dans ma langue. Ça serait tellement beau un jour.»
Là encore, les artistes l’ont encouragée : «T’es une chanteuse, c’est comme ça que tu vas l’apprendre, puis c’est comme ça que tu vas la partager.»
«J’avais besoin d’un petit push», admet Mimi O’Bonsawin. Avec l’aide de sa professeure, elle a depuis traduit et composé son premier morceau en langue abénakise, P8gwas, sorti fin octobre.
À lire aussi : «Forte et fière», la jeunesse autochtone fait entendre sa voix
Pascale O’Bomsawin enseigne l’abénakis depuis 2022 avec le Conseil des Abénakis d’Odanak. Cette avocate de formation n’a pas grandi à Odanak, mais elle a toujours gardé des liens avec la communauté. «Le fait d’apprendre la langue me réconcilie avec qui je suis et c’est très important.»
Elle aussi a été interpelée un jour par un ainé qui lui a dit, lors d’un cercle de paroles : «Va apprendre ta langue.»
C’est devenu viscéral pour moi. C’est comme m’entrainer pour l’ultime Ironman ou l’ultime épreuve olympique. Je ne dois pas manquer un cours. J’en fais plusieurs heures par semaine depuis 2018 parce que je me retrouve, je me reconnais là-dedans.
Quand, en 2020, le Conseil lui demande d’enseigner la langue, elle accepte : «Si je disais non, ça allait s’arrêtait là, il allait manquer un professeur.»
«Je le fais avec beaucoup d’humilité parce que moi, je ne suis pas une locutrice. Je n’ai pas grandi dans un milieu où il y avait des locuteurs.»
En 2021, environ 237 420 Autochtones au Canada disaient pouvoir parler une langue autochtone assez bien pour tenir une conversation, soit une diminution de 4,3 % par rapport à 2016.
Il s’agit de la première baisse enregistrée depuis 1991, année où Statistique Canada a commencé à recueillir des données comparables.
«Il y a des gens qui veulent connaitre la langue, mais il y en a peu qui ont la formation pour l’enseigner. Parfois, il est difficile pour les locutrices et locuteurs fluent en tłı̨chǫ de demander de l’aide parce qu’ils peuvent se sentir gênés de ne pas être capables de lire et d’écrire la langue», remarque pour sa part côté Cecilia Wood, interprète et enseignante de la langue tłı̨chǫ au Collège Nordique à Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest.
«De plus, beaucoup de personnes de la jeune génération peuvent la comprendre, mais ne la parlent pas», ajoute-t-elle.
«L’insécurité linguistique est souvent un enjeu réel», complète la directrice de la formation et de l’enseignement au Collège, Rosie Benning.
L’établissement postsecondaire francophone s’attache à créer un environnement propice à l’apprentissage. «On fait des efforts de rigoler ensemble, de jouer à des jeux, pour faciliter l’apprentissage et le rendre plus ludique», détaille-t-elle.

Des étudiantes et des étudiants du Collège Nordique en train de faire du bannock lors d’un cours de tłı̨chǫ yatıı̀ en pleine nature.
Un des défis des organismes qui offrent des cours de langues autochtones demeure de trouver des personnes pour les enseigner.
«Quand des organismes veulent offrir des cours de langues, ils nous envoient des personnes qui parlent couramment la langue et on travaille ensemble pour les former en didactique des langues», soulève Rosie Benning, directrice de la formation et de l’enseignement au Collège Nordique.
«Elles apportent la connaissance profonde et vivante de la langue en tant que locutrices et locuteurs, et j’offre des stratégies et des outils pédagogiques pour soutenir l’apprentissage», explique-t-elle.
La pandémie a marqué un véritable tournant en démocratisant l’accès à l’enseignement grâce à la visioconférence.
«L’offre de cours est plus importante, indique le directeur général du Conseil des Abénakis d’Odanak, Daniel G. Nolett. On est rendu à quatre, alors qu’avant la pandémie, on donnait un cours de langue par semaine, en présentiel.»
Au Collège Nordique, la participation aux cours de tłı̨chǫ ne faiblit pas, au contraire. «Lorsque nous avons commencé le programme, nous avions 16 étudiants la première année», rapporte Rosie Benning. Grâce à son partenariat avec le Gouvernement Tłı̨chǫ, l’établissement a rejoint plus de 600 personnes étudiantes depuis 2016.
Grâce à l’enseignement à distance, Cecilia Wood échange même avec un couple basé… au Michigan et à Washington. «C’est tellement unique que nous puissions faire ça», se réjouit-elle.
À l’époque, on n’avait pas ce genre de choses, les gens devaient parcourir de longues distances en traineau à chiens pour se rendre dans la communauté voisine afin de discuter et faire des rencontres.
Les cours sont donnés en anglais, en français et en tłı̨chǫ, parfois en pleine nature. «Au lieu d’attendre la leçon 7 pour apprendre la météo, on apprend dans un contexte réel. Quand il fait froid, on dit edza dìì», illustre Rosie Benning.
Alyson McMullen coordonne depuis Toronto l’apprentissage des langues autochtones pour l’organisme à but non lucratif The Outdoor Learning School and Store, basé en Colombie-Britannique. Sa famille a grandi à Ottawa, mais ses ancêtres viennent d’une communauté crie du Nord de l’Ontario.
«Dans les cours de langue crie que je suivais, il y avait peut-être 25 personnes. Je ne savais donc pas à quoi m’attendre en organisant tout ça, mais nous avons eu 800 inscriptions pour le premier cours. C’était énorme, excitant et bouleversant.»
Cela fait deux ans que l’organisme propose ces séances. «Nous avons des parents qui se joignent avec des enfants très jeunes, pour que leurs enfants puissent être exposés à la langue. C’est magnifique.»
Pour la plupart des apprenants et apprenantes, il s’agit aussi de réparer quelque chose qui s’est brisé dans leur famille. «Ma grand-mère du côté de mon père, dans sa jeunesse, vivait avec ses parents en parlant le cri. Puis, elle a été retirée de son foyer et elle a perdu sa langue et, avec elle, les savoirs et les traditions cries», révèle Alyson McMullen.
Le grand-père de Pascale O’Bomsawin connaissait aussi la langue abénakise, mais elle ne l’a jamais entendue la parler. Son père ne lui a pas transmis, mais il s’est ensuite inscrit à un cours. Il n’a jamais manqué une séance, jusque sur son lit d’hôpital.
C’est notre façon de décoloniser.
«Je me dis qu’il ne faut pas lâcher, parce que chaque inscription qu’on a, c’est déjà un Abénakis de plus qui suit la langue, qui apprend la langue et qui se retrouve dans un processus de guérison […] C’est un moyen de se réapproprier ce qui nous a été enlevé.»
«Je pense que je vais être étudiante de cette langue pour ma vie entière, parce que c’est tellement une langue compliquée, confie de son côté Mimi O’Bonsawin, qui ressent aussi un certain «syndrome de l’imposteur».
Mais comme le lui rappelle son enseignante : «Ce n’est pas de notre faute si notre langue a été perdue dans une ou deux générations. Donc d’avoir ce partage-là de guérison, je trouve que c’est vraiment puissant.»
Les personnes allochtones peuvent aussi suivre certains cours, en payant. «C’est un beau mélange. Les peuples dénés du Nord-Ouest ont l’expression “Sois fort comme deux personnes” […] On a aussi des personnes qui habitent ici et voient cela comme un acte de vérité, de réconciliation, par respect pour la langue, pour les peuples et la terre sur laquelle ils habitent», souligne Rosie Benning au Collège Nordique.
À lire aussi : Langues autochtones et réconciliation : «Qui fait le travail?»

«Des ainés m’ont dit que “Si vous voulez savoir qui vous êtes en tant que Cri, vous devez apprendre votre langue», confie Alyson McMullen.
Car, comme le rappelle Alyson McMullen, les langues autochtones portent bien plus que des mots : «Elles viennent de la terre, et il y a tellement d’informations sur le territoire dans ces langues, des informations que l’anglais ne peut pas transmettre.»
«Je ne veux vraiment pas dire que c’est une langue morte parce qu’on est encore là et il y a plein de monde qui fait du travail incroyable à garder notre langue», appuie Mimi O’Bonsawin.
Elle cite notamment Sigwanis Lachapelle, membre de la communauté d’Odanak, qui publie sur TikTok des capsules vidéos autour de l’abénakis.
Pascale O’Bomsawin abonde dans le même sens : «Il faut prêcher par l’exemple d’être un modèle. Ça donne de l’énergie.» Et de la vie.
À lire aussi : Commission de vérité et réconciliation : dix ans après, où en est le Canada?