Le professeur basé à Montréal a publié sa proposition sur le site Options politiques. Il y présente l’idée que puisque la loi 101 a pu protéger le français à moyen terme au Québec, une mesure tout aussi drastique est nécessaire pour la survie du français dans d’autres régions du Canada.
En entrevue avec Francopresse, il explique avoir voulu «essayer de trouver une solution à ce que l’on constate depuis maintenant je ne sais plus combien de décennies : que les gens qui utilisent le français à la maison dans la francophonie hors Québec continue à baisser».
Pour Mario Polèse, la tâche est de taille et des mesures draconiennes doivent être envisagées. «L’anglais est devenu tellement omniprésent, c’est vraiment de se battre contre une langue dont le pouvoir d’attraction est presque illimité.»
À lire aussi : La francophonie minoritaire en perte de vitesse
La Charte de la langue française – souvent nommé loi 101 en référence au projet de loi qui l’a créé – a été introduite par le gouvernement du Québec en 1977. Elle faisait du français la langue officielle de l’État et des tribunaux.
Dans son texte, Mario Polèse rappelle qu’elle a été adoptée alors que les démographes prédisaient le déclin du français dans la province. La baisse de la natalité et les familles immigrantes qui inscrivaient leurs enfants à l’école anglaise étant identifiés comme principaux facteurs.
La loi limitait l’accès à l’éducation en anglais aux enfants de parents qui avaient fréquenté l’école en anglais au Québec. Un jugement de la Cour suprême changera cette limite au Canada en 1982. Les immigrants et les francophones ont alors perdu le droit d’inscrire leurs enfants dans les écoles de langue anglaise.
Mario Polèse pose la question : «Si c’est légal au Québec, pourquoi ce ne serait pas légal à Hearst ou à Moncton?»
Dans son exposé, Marie Polèse reconnait que l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés – qui garantit le droit à l’éducation dans la langue de la minorité – était une mesure essentielle, mais limitée par son époque.

«Ce serait tellement, tellement plus facile au Canada si l’autre langue n’était pas l’anglais. Si l’autre langue était l’allemand, l’italien ou le portugais, nous n’en serions pas là. C’est encore plus vrai serait encore plus vrai qu’il y a 30 ans. Avec Internet et tout ça, l’anglais est devenu tellement omniprésent», illustre Mario Polèse.
Il considère cependant que cet article est devenu, «par un cruel paradoxe que ses auteurs ne pouvaient prévoir, un instrument d’assimilation linguistique» en n’obligeant pas les francophones, incluant les familles immigrantes, à inscrire leurs enfants dans les écoles de langue française.
Selon Statistique Canada, environ un tiers des francophones du Canada inscrivent leurs enfants dans les écoles de langue anglaise. «Ce qui n’est pas négligeable. Ça me semble assez clair, c’est mathématique, ce n’est pas mystérieux», lance Mario Polèse.
Ce qui manque principalement, à ses yeux, c’est une volonté politique, aussi bien au niveau fédéral que dans les provinces et territoires.
Le professeur émérite de l’école d’études politiques de l’Université d’Ottawa, François Rocher, voit plusieurs autres obstacles à la mise en application d’une telle mesure. «D’abord, une modification à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés exigerait l’approbation de sept provinces représentant cinquante pour cent de la population canadienne. Cela est plus qu’improbable», dit-il.
Ensuite, cerner qui exactement doit obligatoirement inscrire ses enfants à l’école française serait complexe. Particulièrement dans les unions mixtes.
À lire aussi : Le commissaire aux langues officielles cible l’éducation et l’immigration
En théorie, l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés donne seulement le droit aux «individu[s] ayant la citoyenneté canadienne» d’inscrire leurs enfants à l’éducation en français. Les enfants de familles immigrantes nouvellement arrivées sont explicitement exclus, mais l’article ouvre également la porte à l’autorisation de leur admission par les provinces et les territoires.
Mario Polèse reconnait les bonnes intentions derrière les modifications à la Loi sur les langues officielles adoptées en 2023. Il craint en revanche qu’elles n’aillent pas assez loin.
Il ne croit pas que l’augmentation de l’immigration francophone sera à elle seule suffisante pour augmenter le poids démographique des francophones, et ce, même si on atteint bel et bien les cibles les plus ambitieuses.
De son point de vue, l’attrait de l’anglais est tout aussi fort pour les jeunes issus de l’immigration. Si un tiers des familles francophones inscrivent leurs enfants dans les écoles anglaises et si les jeunes sont si attirés par l’anglais, «pourquoi les immigrants se comporteraient différemment? Pourquoi seraient-ils plus résistants à l’anglicisation?».
Il est trop tôt pour affirmer que la nouvelle Loi sur les langues officielles n’atteindra pas ses objectifs, avance de son côté le professeur de droit de l’Université d’Ottawa, François Larocque.
«Commençons par atteindre les cibles super ambitieuses. Appliquons la Loi et allons chercher les ayants droit qui ne sont présentement pas dans les écoles de langue française […] par l’incitation, la construction d’écoles alléchantes où un parent va vouloir inscrire son enfant.»
À lire aussi : Immigration francophone et poids démographique, une «approche simpliste»
Lisez notre infolettre
les mercredis et samedis
Dans sa réflexion, Mario Polèse met de l’avant un autre élément de la loi 101 : le français comme langue commune dans les régions où les francophones sont assez nombreux.
Le concept des régions à forte présence francophone (RFPF) introduit dans la Loi sur les langues officielles de 2023 est une occasion manquée selon lui. Le commissaire aux langues officielles aura de nouveaux pouvoirs pour faire respecter le droit des fonctionnaires fédéraux de travailler dans la langue de leur choix. Mais ce droit place le français et l’anglais sur un pied d’égalité, il ne donne pas un avantage à la langue plus «faible».
Dans son texte, le professeur émérite de l’INRS avance que le français devrait être imposé «sur le lieu de travail, dans l’affichage, dans des RFPF choisies» pour que la langue devienne la langue d’usage.
«Une forte présence française ne suffit pas pour assurer la survie de la langue. Il faut une forte majorité française», écrit-il.
Notons que le concept des RFPF n’a pas encore été encadré ou défini dans un règlement par le gouvernement fédéral. Aucune région n’a encore été désignée comme ayant une forte présence francophone.
François Rocher apporte aussi une nuance : la portée d’une telle mesure serait limitée, puisque la Loi s’applique seulement aux fonctionnaires fédéraux et à certaines entreprises de compétence fédérale. «Cela ne contribuerait que très marginalement à contrer les tendances lourdes notées par le professeur Polèse.»

Le français fait partie de l’identité de Divine Lobè Manga.
Divine Lobè Manga confie que sa résolution pour la nouvelle année est de renforcer sa capacité à s’exprimer en français, particulièrement à l’écrit et à l’oral. «Continuer à utiliser le français est une façon de préserver la diversité culturelle du Canada. C’est un défi, mais aussi une fierté», affirme la résidente des Territoires du Nord-Ouest d’origine camerounaise.
Sara Lipo, résidente de l’Ontario, a aussi le but d’apprendre davantage le français comme résolution de 2026. À ses yeux, le français est un véritable moyen de se comprendre et de se connecter à autrui.
Elle soutient que l’apprentissage du français lui a permis de trouver sa voix et de proposer aux autres une occasion de s’ouvrir à ses idées. Pour elle, cette résolution est une quête de soi : «Continuer à apprendre le français, c’est continuer à trouver et à affirmer ma voix».
À lire aussi : Le français : langue économique ou culturelle?

Diannika Barker souhaite plus de programmes de français pour les immigrants et les immigrantes, proposés par les bibliothèques par exemple.
Pour d’autres, la motivation est ancrée dans des réalités académiques ou professionnelles. Tran Du Ngoc Nguyen, une récente diplômée vietnamienne en éducation au Manitoba, révèle son intention d’accroitre ses compétences en français pour l’année à venir.
Elle veut continuer d’apprendre le français afin de pouvoir enseigner dans un programme d’immersion française. Ayant appris un peu de français durant son enfance au Vietnam, elle ressent aujourd’hui le besoin de se rapprocher des langues officielles de son pays d’adoption. «Je veux en apprendre davantage sur le Canada, la culture, les gens et la langue.»
Cette soif de compréhension culturelle est également présente chez Diannika Barker, originaire de la Barbade et installée en Alberta depuis 2021. Sa principale motivation est de pouvoir s’exprimer oralement et de comprendre les autres francophones.
Sara Lipo observe que vivre dans une région majoritairement anglophone rend les occasions de parler français plus rares, mais elle soutient que «c’est justement ce qui le rend [parler cette langue] précieux».

Sara Lipo relate que ce qui n’était au départ qu’un cours obligatoire de français en cinquième année s’est transformé en une passion dévorante pour cette langue.
La faible exposition quotidienne à la langue demeure quand même un des principaux obstacles à l’apprentissage, dit-elle. Il faut rechercher activement les occasions de parler en français pour y remédier.
Diannika Barker est d’accord avec Sara Lipo sur ce besoin : il peut être difficile de découvrir et d’accéder aux espaces francophones, surtout quand on est seul. Elle précise : «L’un des plus grands défis est de pouvoir pratiquer l’expression et la compréhension orale, surtout parce que je vis en Alberta et que je ne suis pas vraiment entourée de francophones».
Tran Du Ngoc Nguyen partage aussi ce sentiment. Elle explique que sa famille et ses amis parlent principalement le vietnamien ou l’anglais. «Je n’ai pas de partenaire ou d’amis avec qui pratiquer.»
À lire aussi : L’identité francophone est-elle plus qu’une langue parlée?
Diannika Barker suggère de trouver de l’aide professionnelle et de ne pas s’autoformer en français.
À l’opposé, Tran Du Ngoc Nguyen encourage une méthode plus informelle, compte tenu du manque de temps. Elle apprend le français par le biais d’une application, en écoutant des vidéos sur YouTube ou en captant la radio pendant ses trajets en voiture, explique-t-elle. Ces méthodes lui permettent d’habituer son oreille à l’accent français et au vocabulaire.
Elle encourage aussi la persévérance : «Ils m’ont dit de simplement continuer à essayer de parler plus en français… la pratique rend meilleur», et de ne pas craindre de commettre des erreurs ou des fautes de grammaire.
Diannika Barker suggère aux apprenants et aux apprenantes d’intégrer la langue dans leur routine quotidienne : elle dit que 20 minutes par jour suffisent pour progresser. Selon elle, étudier le français plusieurs fois par semaine est plus efficace qu’étudier de manière sporadique.
À lire aussi : L’anglais comme langue première : où s’arrête la francophonie? (Chronique)
La tradition de choisir une présidence du jury issue des personnes nommées l’année précédente se poursuit. Pour le Palmarès de 2025, la professeure et chercheuse de la Saskatchewan Anne Leis a accepté cet honneur.
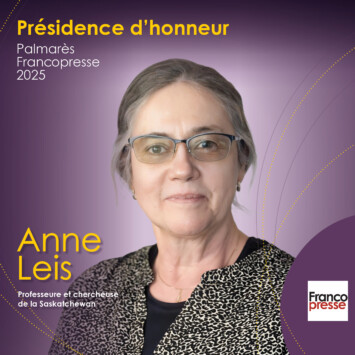
Anne Leis a accepté d’être la présidente du jury pour l’édition 2025 du Palmarès.
«Les candidatures étaient impressionnantes et ont vraiment marqué le jury. C’est beau de voir autant de personnes dévouées qui font avancer la francophonie partout au Canada! C’était la première fois que le jury recevait des candidatures provenant de la Colombie-Britannique et elles ont fait une entrée remarquée au Palmarès. Nous espérons qu’il y aura encore plus de candidatures l’an prochain de toutes les régions du pays pour pouvoir célébrer les talents, les réalisations et le leadeurship d’un bout à l’autre du pays», déclare Anne Leis.
Les candidatures ont été soumises par les journaux francophones en milieu minoritaire des quatre coins du pays. Un jury composé de quatre personnalités des éditions antérieures a eu la tâche de sélectionner les dix personnalités remarquables de 2025 qui ont brillé pour leur contribution à la francophonie canadienne.
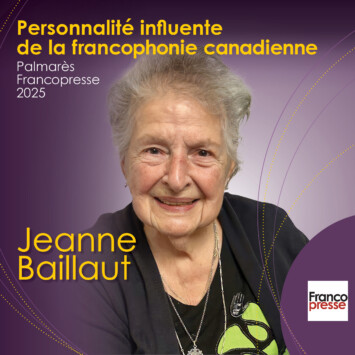
À 90 ans, Jeanne Baillaut a lancé son troisième recueil de poésie, en décembre 2024. Cette pionnière de la francophonie de la Colombie-Britannique prévoit lancer un autre livre en 2026. Dès son arrivée à Vancouver, avec son mari, en 1958, Jeanne Baillaut s’est consacrée à l’enseignement du français. Elle a créé un programme d’apprentissage par les œuvres d’art du Musée des beaux-arts de Vancouver. De 1975 à 1985, elle a été directrice de ce qui deviendra plus tard le Centre culturel francophone de Vancouver. Dans ce poste, elle a entre autres créé le premier festival francophone de Vancouver. Elle n’a pas arrêté par la suite de faire ce qu’elle aime : éduquer, écrire et jardiner, toujours en français.

Une bonne partie du succès du Programme spécialisé en arts de Toronto de l’École secondaire catholique Saint-Frère-André est attribuable à Billy Boulet-Gagnon, qui en est le directeur artistique depuis 2018. Il encourage les jeunes à développer leur propre talent de façon quasi professionnelle. Il a allié formation des élèves et création d’évènements culturels ouverts au grand public. L’auditorium de l’école, partagé avec l’École secondaire Toronto Ouest, est devenu un lieu de rassemblement pour la francophonie torontoise. Le Programme a aussi été un catalyseur pour augmenter les inscriptions à l’École Saint-Frère-André. En parallèle, Billy Boulet-Gagnon met à profit ses talents musicaux lors d’évènements artistiques francophones communautaires.
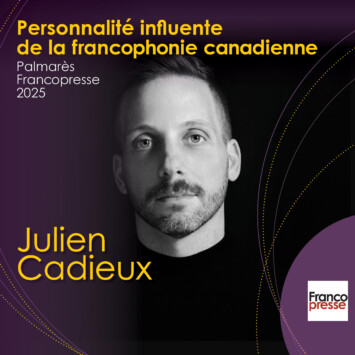
Le réalisateur Julien Cadieux a remporté en novembre le prix de la Meilleure œuvre acadienne et le Prix du public lors du Festival international du cinéma francophone en Acadie pour son documentaire Amir mon petit prince. Ce n’est que le plus récent honneur pour le cinéaste du Nouveau-Brunswick. Avec ses films, comme Y’a une étoile, Une rivière métissée et Les mains du monde, il montre l’importance qu’il accorde à la représentativité et au mieux-vivre ensemble. La diffusion de ses documentaires dans des festivals partout dans le monde fait également rayonner l’Acadie et la langue française.
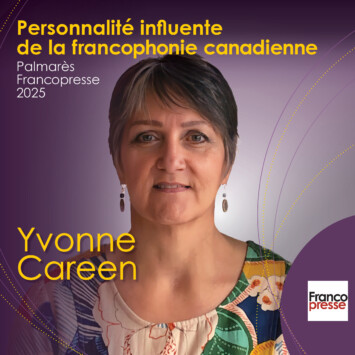
Photo : Courtoisie
Après 35 années à se battre pour améliorer l’expérience et la vie des élèves francophones dans les Territoires du Nord-Ouest, Yvonne Careen a annoncé sa retraite de la direction de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest. Sa carrière a été saluée en grand par les élèves de l’École Allain St-Cyr en mai. Cette école qu’elle a aidé à fonder fêtait justement ses 35 ans. Sa longue bataille judiciaire pour un gymnase dans cette école lui avait valu une première apparition au Palmarès de Francopresse en 2018. La Fédération franco-ténoise et le Regroupement national des directions générales de l’éducation l’ont aussi honoré au cours de sa carrière.

Chantal Fadous est une francophone passionnée originaire du Liban. En 2025, elle a été l’une des 50 coautrices d’un livre sur des femmes inspirantes du grand Vancouver, dans lequel elle met de l’avant l’importance du bénévolat et de la langue française. Après son installation au Canada il y a 16 ans, elle a choisi de s’engager dans la vie francophone. Elle a commencé par faire de la suppléance dans un programme de prématernelle, mais ne s’est pas arrêtée là. En plus d’être restée en éducation, allant jusqu’à occuper la vice-présidence du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, elle a notamment appuyé des familles immigrantes et a été présidente de la Société francophone de Maillardville en Colombie-Britannique.
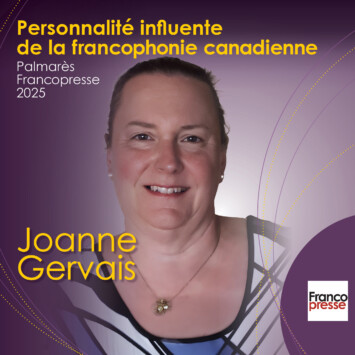
Joanne Gervais est la force tranquille derrière de nombreuses avancées pour la francophonie du Grand Sudbury, en Ontario. La directrice générale de l’Association canadienne-française de l’Ontario du grand Sudbury a rassemblé la francophonie locale et provinciale pour organiser les célébrations du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien le 25 septembre 2025 à l’Université de Sudbury, où a eu lieu le premier lever de ce puissant symbole franco-ontarien. Dès 2021, elle a milité aux côtés de cette même université pour la réouverture de cet établissement postsecondaire «par et pour» les francophones, ce qui s’est concrétisé en septembre 2025.
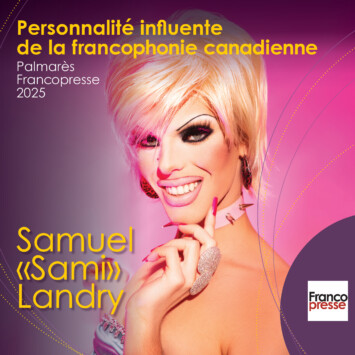
Samuel Landry dans la peau de son personnage Sami Landri.
Samuel Landry profitait déjà d’une popularité impressionnante sur les réseaux sociaux grâce à son alter ego : la dragqueen Sami Landri. Sa notoriété a explosé en fin d’année quand il est devenu le premier Acadien à participer à la populaire émission Canada’s Drag Race. Sur TikTok, ses vidéos – en français – ont été vues des millions de fois. Ses vidéos, ses spectacles, sa série Web Helpez-moi et l’émission DRAG! d’la tête aux pieds qu’il coanime contribuent à rendre la culture queer visible et accessible en français, en plus de faire connaitre le chiac, la culture acadienne et les luttes pour la diversité et l’identité.

Monique Levesque, éducatrice originaire du clan yändia’wich de la nation wendate au Québec, s’est engagée activement dans le rapprochement et la réconciliation entre les Premières Nations et les Franco-Yukonais. En 2025, elle a offert des ateliers de perlage qui ont été l’occasion de parler des traumatismes du passé et de guérison et elle a livré un exposé public qui invitait à réfléchir aux gestes que peut poser la communauté francophone pour soutenir la vérité et jeter des ponts. Dans son parcours personnel, elle apprend le wendat. Elle mène tous ces efforts de front avec son travail de directrice adjointe d’une école d’immersion et ses heures de bénévolat pour les activités francophones.
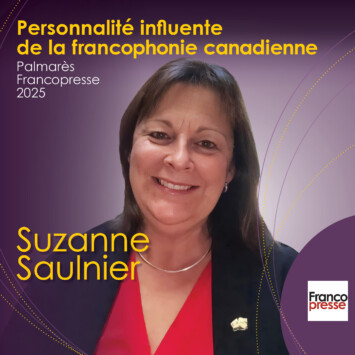
L’ouverture d’une nouvelle garderie à Pomquet, dans l’est de la Nouvelle-Écosse, en juin 2025 témoigne du travail acharné mené par Suzanne Saulnier en faveur du développement de la petite enfance en français en Nouvelle-Écosse. Directrice générale du Centre d’appui à la petite enfance de la Nouvelle-Écosse depuis sa création en 1992, elle ne cesse de travailler pour l’unité, l’excellence et la durabilité de ce secteur dans la province. Elle a mis l’accent sur les partenariats et la création de garderies pour veiller à ce que les enfants aient le meilleur départ possible pour leur éducation en français.
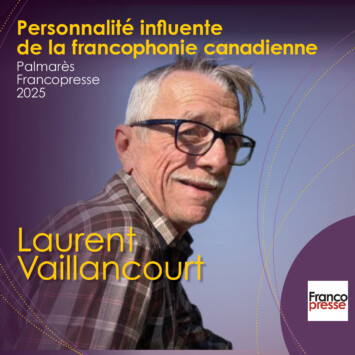
La médaille du couronnement du Roi Charles III décerné à Laurent L. Vaillancourt en aout 2025 atteste du demi-siècle – et plus – d’engagement et de création de ce sculpteur autodidacte, qui a également touché au dessin et à la scénographie. Ses expositions, souvent ancrées dans le territoire nord-ontarien, ont parcouru les provinces canadiennes de l’Est ainsi que la Colombie. Laurent L. Vaillancourt a aussi aidé à structurer son domaine; il est entre autres membre fondateur du Bureau des regroupements des artistes visuels de l’Ontario (BRAVO) et de la Galerie du Nouvel-Ontario, à Sudbury. Il est également fier instigateur et actuel vice-président de l’Écomusée de Hearst, en Ontario.
Méthodologie
Les candidatures au Palmarès des personnalités influentes de la francophonie canadienne de 2025 ont été soumises par les médias écrits de langue française en milieu minoritaire de partout au Canada.
Un jury composé de quatre personnes nommées au Palmarès entre 2021 et 2024, dont la présidente de l’édition de 2025, a évalué les candidatures et fait une sélection par consensus à la mi-décembre.
Le jury a tenu compte de l’influence des candidats et candidates sur la francophonie de leur région dans leur domaine respectif et s’est aussi laissé guidé par un souci de représentativité des régions du pays et de la diversité de la francophonie.
Ce sont des chercheurs de l’Université de l’Arkansas, aux États-Unis, qui ont fait cette découverte. Pour en arriver à cette conclusion, ils ont analysé plus de 20 000 photos de ratons laveurs prises dans les villes américaines.
Les scientifiques ont remarqué que le museau des ratons des villes était plus court que celui des ratons sauvages. Et ça, pour la science, c’est un signe qu’un animal s’adoucit et devient moins agressif envers les humains. Qu’il devient plus domestique. C’est un phénomène connu qui porte même un nom : le syndrome de domestication. Ce syndrome modifie la couleur du pelage, la grosseur des dents, la forme des oreilles, de queue et du visage.
Les chercheurs ont été surpris de voir que la domestication des ratons laveurs était assez rapide et qu’elle se faisait sans l’aide des humains. Ce ne sont pas les gens qui les apprivoisent. Ce sont les ratons eux-mêmes qui s’approchent des poubelles et des dépotoirs. C’est la nourriture qui les attire. Pas notre charmante compagnie!
Il se produit alors ce qu’on appelle une sélection naturelle. Les ratons qui ont le plus de succès sont ceux qui sont à la fois téméraires (ils osent s’approcher des humains) et doux. Comme ils vivent plus longtemps que les autres, ils peuvent faire plus de bébés. Donc de plus en plus de bébés héritent des traits doux, vont vivre plus longtemps, etc.
En résumé : Papa raton doux = accès aux poubelles des humains = survie = plein de bébés ratons doux!
Ce ne sont pas les premiers animaux sauvages à être attirés par nos poubelles! Il y a des milliers d’années, les ancêtres des chiens et des chats ont eux aussi quitté leur habitat pour s’approcher de nos restes de nourriture.
Source : Springer Nature, The Guardian
La Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) a lancé un projet pancanadien, «Culture d’entreprise», pour favoriser l’intégration et la rétention des personnes issues de l’immigration francophone. Comment? Grâce à la médiation culturelle.

«On ouvre des voies de collaboration entre les arts et la culture, le monde économique, les milieux de travail qui participent à un projet, et les personnes issues de l’immigration», résume Nancy Juneau de la FCCF.
Autrement dit, la mise en relation entre les membres d’une entreprise et un ou une artiste pour mener à terme un projet artistique et «solidifier des liens entre les gens qui y participent», explique la présidente de la FCCF, Nancy Juneau.
«Ça peut être un projet en théâtre, en danse, en art visuel», précise-t-elle.
«L’objectif, ce n’est pas tant la production finale que la démarche qui amène les participants à nouer des relations et les échanges que cela engendre. On espère que ce projet va contribuer à faire en sorte que ces nouveaux arrivants se sentent mieux accueillis; qu’ils sentent qu’ils font partie d’une communauté.»
À lire aussi : Musique et identité francophones : «On coche les cases»
L’initiative «Culture d’entreprise» s’étale sur trois ans. La FCCF compte implanter ce projet dans toutes les provinces et tous les territoires hors Québec.
«On a un financement pour faire 16 expériences en milieu de travail», rapporte Nancy Juneau.
«C’est un projet clé en main», insiste-t-elle. L’entreprise doit se charger de recruter des participants et participantes, mais ensuite, «Culture d’entreprise» s’occupe de trouver des ressources artistiques et culturelles dans la région et de mettre en relation les personnes concernées.
«Nous sommes en pourparlers avec des partenaires pour identifier un milieu d’emploi dans le Nord de l’Ontario, en Saskatchewan et au Manitoba», détaille la FCCF dans un courriel.
Un appel d’intérêt sera lancé au début de l’année 2026 pour identifier les six milieux d’emploi qui seront accompagnés en 2026-2027.
La première entreprise à se joindre à l’initiative est la Coop IGA de Dieppe, au Nouveau-Brunswick.
Le gérant, Denis Rioux, a proposé aux membres intéressés de son personnel de former un groupe qui, une fois par semaine, aura l’occasion de travailler ensemble sur un projet artistique de son choix. Quatre employés issus de l’immigration et deux Acadiens ont embarqué.

Une bonne proportion de mes employés sont issus de l’immigration des pays francophones. Il me semble qu’il fallait que je joigne ça pour essayer de mieux les comprendre, puis eux aussi mieux comprendre justement la culture d’entreprise canadienne, qui est un peu différente probablement de ce qu’ils vivent dans leur pays.
D’un pays à l’autre, les politiques, mais aussi les lois liées au travail, changent. Denis Rioux estime qu’il peut lui aussi apprendre des personnes immigrantes, sur le plan culturel, notamment grâce à leurs coutumes et leurs valeurs.
«Pour une entreprise comme la nôtre, on a toujours valorisé le respect entre les personnes, peu importe leur nationalité, leur religion ou leur genre. Ça fait partie de notre ADN.»
Le directeur de la Coop espère qu’à terme, cette expérience soudera son équipe. «Peut-être que ce sera encore plus agréable pour eux de venir travailler, par exemple.»
Si je peux permettre à quelqu’un de s’intégrer au marché du travail au Canada, puis qu’après un an, deux ans, la personne est devenue bilingue et qu’elle peut accéder à des emplois supérieurs – que ce soit dans la fonction publique ou dans des échelons d’entreprise supérieurs – j’aurais accompli ce que j’avais à accomplir.
Car beaucoup d’entreprises dans les secteurs francophones «ont un peu de misère à faire du recrutement» et à retenir les nouveaux arrivants, remarque Denis Rioux.
«Souvent, ils découvrent des milieux où ils ont de la difficulté à s’adapter. Puis plusieurs d’entre eux auront tendance à s’en aller vers des grands centres où ils peuvent trouver plus de membres de leur communauté d’origine», complète Nancy Juneau.
L’intégration et la rétention ne sont pas des enjeux propres aux francophones, rappelle la professeure agrégée en géographie à l’Université d’Ottawa et spécialiste en immigration canadienne, Luisa Veronis. Ils concernent l’ensemble de l’immigration au Canada.

«Dans une économie fondée sur le savoir, les approches artistiques peuvent stimuler la créativité, la collaboration et l’innovation au sein des entreprises», dit Luisa Veronis.
Le pays mise avant tout sur une immigration dite économique, en sélectionnant des personnes hautement qualifiées, avec l’attente qu’elles contribuent rapidement à l’économie.
Mais une fois arrivées, celles-ci se heurtent à de nombreux obstacles, comme la reconnaissance des diplômes, les professions règlementées ou encore le fonctionnement très réseauté du marché du travail canadien.
«En contexte minoritaire, les défis augmentent : il y a moins d’emplois en français et les communautés sont plus petites», ajoute la chercheuse.
Néanmoins, «l’intégration sociale et l’intégration économique vont main dans la main», rappelle-t-elle.
Luisa Veronis voit ainsi d’un très bon œil l’initiative de la FCCF, très originale et très pertinente à ses yeux. La médiation culturelle permet de développer un milieu de travail plus ouvert et inclusif, au-delà des différences culturelles ou linguistiques.
«Il s’agit de créer un esprit d’équipe avec des valeurs communes où on travaille ensemble vers un objectif ou un projet; mettre en valeur justement l’apport, la créativité des différents membres.»
«Un projet artistique, c’est une façon de valoriser les talents, poursuit-elle. Les activités artistiques ont aussi ce pouvoir de permettre aux gens de se connecter à un autre niveau.»
Seul bémol selon elle : «Culture d’entreprise» s’adresse à des personnes déjà en emploi et ne répond donc pas directement au défi de l’embauche des personnes immigrantes.
«Mais je pense que les entreprises qui vont participer à ce projet peuvent avoir une répercussion sur d’autres employeurs pour que ceux-ci s’ouvrent à engager des nouveaux arrivants.»
À lire aussi : Le français : langue économique ou culturelle?
«Les travailleurs n’ont pas nécessairement l’habitude de participer à des projets culturels et artistiques, donc ils sont en train de vivre ensemble une nouvelle expérience qui est nouvelle pour tout le monde. Ça crée comme un terrain de rencontres fertiles», observe Nancy Juneau.

«La recherche d’emploi continue d’être extrêmement difficile, surtout pour les nouveaux arrivants qui ne parlent pas anglais, parce qu’on a beau avoir une belle communauté francophone, mais il y a quand même une exigence d’être bilingue pour plusieurs postes», témoigne Marie-Pierre Proulx.
«Tout passe par la culture, lance Denis Rioux. Que ce soit la lecture, la musique, la nourriture.»
À Sudbury, le Théâtre du Nouvel-Ontario (TNO) organise déjà depuis plusieurs années le concours Par ici le talent! pour tisser des liens entre les organismes culturels francophones de la ville et les nouveaux arrivants.
«Cette initiative communautaire a vraiment comme but de permettre aux gens de se rassembler, de vivre ensemble des expériences positives par le biais des arts et de la culture», explique la directrice artistique et codirectrice générale du TNO, Marie-Pierre Proulx.
Le concours en est à sa troisième édition. «C’était vraiment pour nous un premier contact avec des immigrants qu’on ne voyait pas à l’époque dans nos salles. Et pour eux, c’est une façon de découvrir la communauté, des nouvelles personnes, de faire des liens, ce qui peut aider à la rétention.»
«C’est un premier pas dans la bonne direction»
Marie-Pierre Proulx fait une mise en garde : c’est un travail de longue haleine. «C’est un premier pas dans la bonne direction. Il y a des gens qu’on a découverts à travers ce projet-là et avec qui on collabore maintenant de façon plus régulière ou qui font du bénévolat pour nous.»
«Il y a des gens qu’on voit plus régulièrement dans nos salles et qui ont découvert comment on fait du théâtre au Canada français.»
Cette expérience a aussi permis au TNO d’être plus sensible dans ses choix de programmation, notamment en faisant venir des spectacles d’ailleurs ou en créant des pièces «pour que les gens qui viennent par exemple de pays d’Afrique francophone puissent aussi se reconnaitre sur scène dans les spectacles professionnels», détaille la directrice artistique.
«C’est une chose qu’on s’est fait dire : “Oui, c’est bien qu’il y ait un théâtre francophone à Sudbury, mais on ne se reconnait pas nécessairement dans ce que vous présentez.”»
À lire aussi : Départ des immigrants francophones : une réalité toujours d’actualité?
Entre valorisation de leur culture, engagement civique et leadeurship, les jeunes Autochtones redéfinissent leur identité et mettent en avant leurs talents. Un engagement remarqué tant par les décideurs politiques que par le milieu universitaire.

Connor Lafortune et Page Chartrand sont deux voix fortes franco-anichinabées du Nord de l’Ontario.
Grâce à des évènements et initiatives locales d’un bout à l’autre du Canada, des leadeurs et leadeuses travaillent à favoriser l’inclusion, briser les stéréotypes et inspirer les jeunes à s’affirmer dans la société canadienne. Ils et elles plaident aussi pour une plus grande place de l’histoire des Noirs dans les programmes scolaires.

Regina célèbre le Mois de l’histoire des Noirs : un moment d’échange et de réflexion sur l’héritage et l’avenir des communautés noires.
Cinq ans après la COVID‑19, le bingo radio continue de rassembler et de dynamiser les communautés francophones à travers le pays. Le jeu reste une tradition bien ancrée dans plusieurs régions au pays, générant des fonds essentiels pour des radios communautaires francophones et créant des moments intergénérationnels.

Partout au pays, le bingo permet de recueillir des fonds pour différentes causes. Quelques radios communautaires en dépendent.
Si la crise du logement persiste au Canada, des idées prometteuses émergent, et elles ne passent pas forcément par la construction de nouveaux logements. Des villes comme Edmonton révisent leurs règles d’urbanisme pour favoriser la densification douce et améliorer l’abordabilité.
À l’étranger, des modèles comme celui de Vienne montrent qu’une intervention publique forte peut rendre le logement accessible sans dépendre du profit.

Un voyage dans l’Ouest canadien, dans l’histoire du pays, en Europe et en Asie, montre que des solutions potentielles existent juste sous notre nez. Photo prise à Toronto.
Grâce à des résidences, du mentorat, des ateliers et des coproductions interrégionales, le programme Reel Change offre des ressources, des opportunités professionnelles et un espace de création plus équitable pour les cinéastes noires, trans et non binaires. Le projet vise à lever les obstacles systémiques et à ouvrir davantage de postes décisionnels aux créatrices sous‑représentées.

Le programme pancanadien Reel Change accompagne les créatrices et productrices noires, trans et non binaires dans le milieu du cinéma et de la télévision.
Des initiatives communautaires francophones partout au pays s’organisent pour que les personnes âgées 2ELGBTQI+ vivent avec fierté et sans isolement. Des organismes comme Réseau Vivre+ Fierté à Toronto rassemblent déjà des dizaines de membres autour d’activités sociales, tandis que des collaborations intergénérationnelles renforcent le soutien mutuel.

Après s’être battues pour leurs droits, les personnes âgées francophones 2ELGBTQI+ font aujourd’hui face à deux combats majeurs : l’isolement et l’accès aux services en français.
De nombreux programmes et organismes proposent du mentorat, des formations et des financements pour aider les jeunes francophones à lancer et faire croitre leurs entreprises, tout en contribuant à la vitalité du français et de l’économie locale.

La Franco-Ontarienne Mira Barrette participe au programme C’est moi l’boss! du Conseil scolaire du Grand Nord. Grâce au programme, la jeune fille a pu développer son entreprise de création de bijoux en perle.
Francophonie minoritaire : les mèmes comme arme culturelle et identitaire
Les mèmes – ces images, vidéos et textes remixés – permettent d’illustrer avec humour des réalités culturelles et linguistiques propres aux communautés francophones, de célébrer leurs accents, expressions et histoires ainsi que de créer des liens de solidarité en ligne.

Les mèmes peuvent réunir les communautés et les faire rire ensemble face à une expérience commune.
Après une expérience concluante, le Forum des politiques publiques recommande la création d’un fonds philanthropique non partisan permanent pour soutenir la couverture des élections au Canada.
Accessible aux médias de langue minoritaire, le fonds prévoirait aussi un volet dédié aux médias autochtones, avec un comité d’évaluation distinct; un pas de plus pour renforcer l’information locale et la démocratie.

Le Forum des politiques publiques rappelle qu’au Canada, 2,7 millions de personnes n’ont accès à aucun ou qu’un seul média local, selon une étude du Centre canadien de politiques alternatives.
Le commissaire aux langues officielles a donné raison à l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) face au ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) sur le plafond d’étudiants étrangers. Une décision saluée comme une victoire pour les universités francophones et pour la prise en compte des enjeux linguistiques dans les politiques d’immigration.
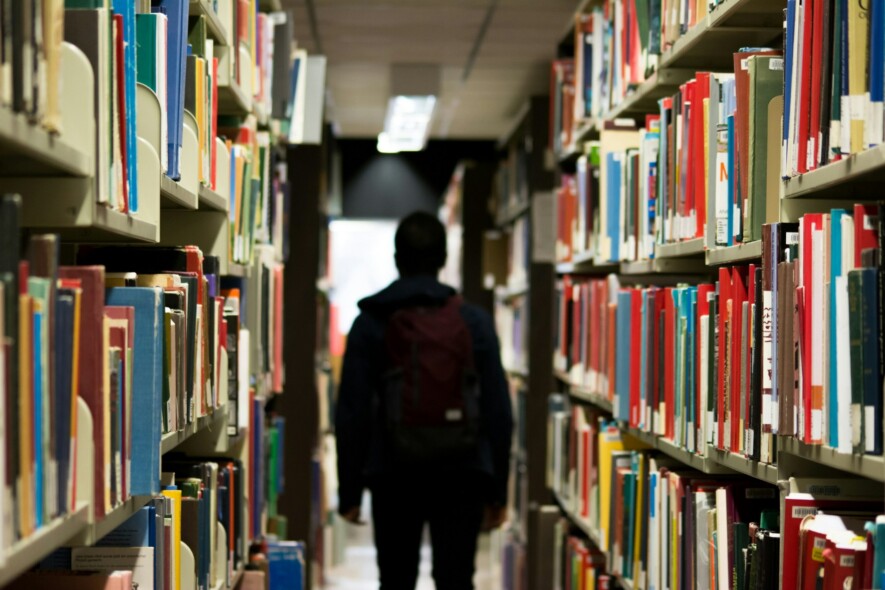
La plainte de l’ACUFC auprès du Commissariat aux langues officielles porte sur la décision du ministère de l’Immigration d’imposer une limite de permis pour des étudiants étrangers en janvier 2024.
Ils et elles n’ont pas dit leur dernier mot. Partout au Canada, des Autochtones (ré)apprennent la langue de leurs ancêtres pour préserver et se réapproprier une culture dont ils et elles ont été privés. Cours en ligne et en personne, chansons, espaces intergénérationnels : ces initiatives nourrissent une véritable reconquête culturelle et témoignent de la résilience vibrante des langues autochtones.

Partout au Canada, différents organismes mettent en place des outils ou proposent des initiatives pour revitaliser les langues autochtones.
Selon un sondage, 82 % des Canadiennes et des Canadiens estiment que leur gouvernement devrait en faire davantage pour lutter contre le réchauffement climatique. Si beaucoup ont l’impression qu’une majorité de la population reste sceptique face à l’action climatique, c’est notamment parce que la désinformation freine encore largement la mobilisation.

Une large majorité de la population mondiale aimerait voir leur gouvernement mettre en place plus de mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs effets.

Justin Trudeau est contraint de démissionner le 6 janvier 2025, après de nombreux mois de querelles internes au Parti libéral du Canada.
Le 6 janvier, Justin Trudeau tire sa révérence, après presque dix ans au pouvoir et le Parlement est prorogé. Il jette l’éponge après plusieurs mois très compliqués au sein du Parti libéral, avec des divisions sur son leadeurship. L’annonce n’est pas une surprise, mais ses larmes confirment qu’il aurait préféré se battre.
«Je ne suis pas quelqu’un qui recule facilement devant un combat, surtout un combat si important pour le parti et pour le pays, déclare-t-il devant les journalistes. Je fais ce job parce que l’intérêt des Canadiens et le bienêtre de notre pays, de notre démocratie, me tient à cœur. Et c’est devenu clair que je ne peux pas être le chef aux prochaines élections, à cause des batailles internes [au Parti libéral].»
À lire aussi : Francophonie et langues officielles : l’héritage de Justin Trudeau en question
C’est l’ancien conseiller économique de Justin Trudeau qui remporte la victoire comme chef du Parti libéral du Canada, le 9 mars. Sur 151 899 votes, il en récolte plus de 131 600.
Il bat l’ex-ministre et son amie Chrystia Freeland de loin, cette dernière arrachant avec peine plus de 11 000 voix seulement. Elle était pourtant une figure politique et ministre d’envergure depuis l’entrée de Justin Trudeau à la Chambre des communes, en 2015.
Mark Carney est ensuite assermenté comme premier ministre le 12 mars.

Pierre Poilievre a perdu son siège dans la circonscription de Carleton, en banlieue d’Ottawa, pour la première fois en 20 ans, mais a réintégré le Parlement avec le siège que lui a cédé son député Damien Kurek, dans Battle river – Crowfoot.
Le 28 avril, Mark Carney remporte les élections, avec 169 députés sur 343, défaisant ainsi le Parti conservateur du Canada (PCC), donné pourtant favori dans les sondages quelques mois avant les élections. Le Nouveau Parti démocratique (NPD) n’est plus un parti officiel; il ne compte plus que 7 députés comparativement à 22 avant les élections. Leur chef, Jagmeet Singh, démissionne.
Les conservateurs gagnent 24 sièges de plus qu’en 2021, mais doivent s’incliner devant la victoire des libéraux. Pierre Poilievre perd son siège, mais sera réélu en aout après que le député conservateur Damien Kurek de la circonscription de Battle River–Crowfoot, en Alberta, démissionne.
À lire : Malgré la défaite, Pierre Poilievre tient toujours son parti
Adopté le 19 juin 2025 en accéléré par le Sénat, le projet de loi controversé C-5 a été approuvé par la Chambre des communes par 306 voix contre 31 grâce à un appui bipartisan des libéraux et des conservateurs. Le NPD, le Bloc québécois et le Parti vert s’y sont opposés.
Le texte vise à accélérer les projets d’infrastructure d’intérêt national et à lever les barrières au commerce interprovincial en accordant davantage de pouvoirs au fédéral.
Ses critiques dénoncent un processus accéléré avec un affaiblissement des protections environnementales et un non-respect du consentement des peuples autochtones.
Le 21 septembre 2025, le Canada a officiellement reconnu l’État de Palestine en marge de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, au moment où un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas se dessinait.
Cette reconnaissance, jugée surtout symbolique par certains, s’inscrit dans une volonté de relancer une paix durable, tout en maintenant le soutien d’Ottawa à Israël.
Au Canada, des voix appellent depuis deux ans aussi à revoir les liens diplomatiques et militaires avec Israël et à légiférer pour empêcher l’exportation d’armes vers des zones en conflit, notamment avec le projet de loi C-232, proposé par la députée du NPD Jenny Kwan et appuyé par le libéral Fares Al Soud. Les négociations sur ce projet de loi se poursuivaient en coulisses à la fin de l’année.
Des rapports accablants contre le Canada pour l’exportation d’armes et l’inaction pour les évacuations médicales, notamment d’enfants palestiniens, ont écorché l’ancienne ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, puis l’actuelle ministre, Anita Anand.

Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, s’est vu attribuer de nouveaux pouvoirs de sanction questionnés par la suite sur leur portée et leur efficacité, notamment par le parti conservateur, lors des comités de langues officielles qui ont suivi.
Le 26 novembre 2025, le gouvernement fédéral a présenté un avant-projet de règlement après deux ans et demi d’attente des francophones.
Il vise à accorder au commissaire aux langues officielles de nouveaux pouvoirs de sanctions administratives pécuniaires.
Si le règlement est adopté tel quel, ces sanctions lui permettraient d’imposer des amendes pouvant atteindre 50 000 $ à certaines entreprises de transport et autorités aéroportuaires qui ne respectent pas leurs obligations en matière de services en français et en anglais.
Les pénalités seraient modulées en fonction de la gravité, la fréquence et les conséquences des infractions, dans le but de renforcer l’application de la Loi sur les langues officielles.

Le député acadien qui représente la circonscription d’Acadie—Annapolis, en Nouvelle-Écosse, a traversé la Chambre des Communes pour passer du Parti conservateur du Canada au Parti libéral. Critiqué par une partie de ses commettants, il a été imité par Michael Ma plus d’un mois après, et son collègue albertain Matt Jeneroux a démissionné.
Début novembre, le député acadien Chris d’Entremont traverse la Chambre des communes pour passer du Parti conservateur au Parti libéral.
Son collègue albertain, Matt Jeneroux, ne traverse pas, mais démissionne, sans qu’il ait pour autant de date fixe de départ.
Derrière ces deux départs : le style de leadeurship de Pierre Poilievre, qui contrôle son caucus d’une main de fer.
En décembre, quelques heures après avoir assisté à la Fête de Noël du Parti conservateur, le député ontarien de Markham–Unionville, Michael Ma, traverse aussi la Chambre. Les libéraux ne sont plus qu’à un siège de la majorité.
Pierre Poilievre remet en question la démocratie, lorsque des députés élus sous une bannière passent sous une autre.

L’ex-ministre de l’Immigration sous Justin Trudeau a fait son retour au Cabinet Carney comme ministre de l’Identité, de la Culture et ministre responsable des Langues officielles.
Le 9 décembre, un règlement lié à la partie VII de la Loi sur les langues officielles, visant à favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire, a été déposé à la Chambre des communes. Comme celui sur le commissaire aux langues officielles, le texte est attendu depuis juin 2023.
Mais le document soulève des inquiétudes. Le commissaire déplore l’absence de clauses linguistiques obligatoires dans les ententes fédérales-provinciales-territoriales, ce qui nuirait à la transparence et à l’utilisation des fonds destinés aux communautés, notamment en éducation.
Il considère aussi que le processus de consultations est insuffisant et celui d’analyses d’impact incomplet, ce qui pourrait limiter l’efficacité réelle du règlement.
Autre règlementation, même loi : 733 nouveaux bureaux sont désignés bilingues sur 8 750.
Le 1ᵉʳ décembre 2025, Marc Miller a fait son retour au cabinet fédéral comme ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et responsable des Langues officielles, suscitant un accueil plutôt positif chez plusieurs organisations francophones, qui se disent rassurées par son expérience et son écoute, notamment acquises lorsqu’il était ministre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sous Justin Trudeau, de 2023 à 2025.
Ces organismes espèrent qu’il poursuivra les efforts pour renforcer les institutions francophones, la culture et l’application de la Loi sur les langues officielles.
Le 12 décembre, la Cour fédérale a partiellement donné raison au Conseil scolaire francophone de Terre-Neuve-et-Labrador en statuant que Patrimoine canadien doit consulter adéquatement les conseils scolaires francophones avant de conclure toute entente avec une province.
Cette décision reconnait pour la première fois une obligation fédérale de consultation en éducation, notamment au regard de la Loi sur les langues officielles et de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui protège l’éducation dans la langue de la minorité.
Toutefois, la Cour a jugé que les mécanismes de transparence du financement étaient suffisants et n’a pas accordé de dommages et intérêts.
Du 1er au 5 décembre dernier, les habitants de Hamilton ont pu participer au programme Toys for Tickets, ou «des jouets contre des contraventions».
Le principe est simple : à la place de payer leur contravention de stationnement avec de l’argent, les citoyens pouvaient donner des jouets neufs!
Les jouets étaient déposés à un endroit précis, au centre-ville de Hamilton, pendant les cinq jours de l’initiative. Ensuite, ils ont été remis à United Way Halton and Hamilton. Il s’agit d’un organisme qui aide les gens dans la communauté. Il s’assure que les jouets soient rendus à des familles et à des enfants qui en ont besoin.
Les jouets devaient être nouveaux, non utilisés et valoir au moins le même prix que la contravention. Les participants devaient aussi garder le reçu du magasin, pour montrer la valeur du jouet.
Mais attention! Seules les contraventions de stationnement étaient acceptées. Les billets pour excès de vitesse ou pour avoir roulé sur un feu rouge ne faisaient pas partie du programme.
«En transformant une contravention en occasion de donner, Toys for Tickets est une façon simple et innovante de soutenir notre communauté», a confié la mairesse de Hamilton, Andrea Horwath, au journal l’Express-ca.
Elle rappelle aussi que les habitants de Hamilton aiment s’entraider. «Les gens d’ici sont connus pour se soutenir les uns les autres, et cette initiative offre une belle façon de redonner pendant le temps des Fêtes», a-t-elle ajouté.
L’an dernier, lors de la première édition, 65 contraventions avaient été échangées contre des jouets, pour une valeur d’environ 4800 $.
Cette année, encore plus de personnes ont participé. En 2025, 99 contraventions de stationnement ont été transformées en dons. Les amendes valaient un peu plus de 5000 $, mais les jouets donnés ont dépassé cette valeur : plus de 6100 $ au total!
Et toi, quelle bonne action pourrais-tu faire pendant le temps des Fêtes?
Étant arrivé au Manitoba à l’automne 2024, Kouamé Benjamin Boateng s’est senti isolé et «vraiment triste» lors de sa première période des Fêtes de fin d’année au Canada. Il vit dans un endroit où il dit ne rencontre pratiquement personne. «L’hiver était à un niveau impensable», confie-t-il.

Kouamé Benjamin Boateng est originaire d’Abidjan, une ville en Côte d’Ivoire.
Kouamé Benjamin Boateng est originaire de Côte d’Ivoire, spécifiquement d’une ville où les Fêtes, à ses yeux, ressemblent à celles des grandes métropoles européennes avec des artères illuminées et une foule en mouvement constant. En arrivant dans sa nouvelle localité, il n’a pas retrouvé la même effervescence. Sa première année au Canada a été une question de survie émotionnelle, raconte-t-il.
Cependant, l’Ivoirien a choisi de rester positif. Sa stratégie : créer son propre petit monde. Avec des amis, il a organisé un réveillon à leur manière : préparer un repas pour retrouver les saveurs de leur pays d’origine, écouter de la musique et bavarder pour combler la distance avec les proches restés au pays.
Cette année, après 12 mois au pays, Kouamé Benjamin Boateng prévoit quelque chose de plus festif. Il compte entre autres décorer sa demeure, passer à l’église pour la messe de Noël pour retrouver le sentiment nostalgique de la Côte d’Ivoire.
De son côté, Hamed Rachid Sidibe, étudiant à l’Université Laurentienne à Sudbury dans le Nord de l’Ontario depuis plus de deux ans, ne célèbre pas Noël pour des raisons religieuses. Il observe l’état d’esprit ambiant avec respect et tolérance, même s’il se sent parfois loin de tout cela.
L’étudiant raconte que son expérience en Côte d’Ivoire, un pays laïc où se côtoient plusieurs religions, l’avait déjà préparé à cette cohabitation des traditions.
Pour lui, ce temps de l’année est synonyme de repos, de prières, de gestes d’entraide envers les personnes dans le besoin et de renforcement des liens familiaux. «Nous en profitons pour passer plus de temps ensemble… et faire le bilan de l’année», explique-t-il.
À lire aussi : La cuisine, ciment social des communautés francophones
Conscients des différentes expériences vécues par les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, les organismes comme la Communauté francophone accueillante de Hamilton et celle de London se mobilisent pour bâtir des ponts entre différentes communautés.

Selon Loan Nguyen, les communautés francophones accueillantes de Hamilton et de London ont organisé le Diner des Fêtes le 20 décembre, avec un spectacle humoristique et musical des Chiclettes, intitulé En attendant Noël.
Loan Nguyen, agente de projet responsable du volet sensibilisation et promotion pour les communautés francophones accueillantes Hamilton et London, explique que leur mission est de soutenir l’intégration socioculturelle des nouveaux arrivants; ce qui inclut le temps des Fêtes.
Dans sa ville, elle a organisé, avec le Centre francophone Hamilton, un diner des Fêtes pour proposer un moment convivial aux personnes nouvelles arrivantes.
Selon Loan Nguyen, l’objectif est double : briser l’isolement et faire découvrir la culture franco-ontarienne durant la période des Fêtes. Entre 100 et 120 personnes s’y sont inscrites, dit-elle.
D’autres initiatives fleurissent également dans sa région : elle énumère des exemples, comme des sessions sur la façon de bien s’habiller en hiver, des friperies ou des distributions de chocolat chaud organisées par le Centre de santé communautaire Hamilton Niagara.
L’agente de promotion attachée au Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario indique aussi que les associations ethnoculturelles, comme l’Association des Camerounais de Hamilton, organisent aussi leurs propres diners pour célébrer ensemble.
Loan Nguyen rappelle que l’objectif des organismes d’accueil est que les nouveaux arrivants se sentent non seulement accueillis, peu importe leur culture, mais qu’ils sentent qu’ils peuvent, par la suite, contribuer à la communauté.
À lire aussi : L’aide à l’intégration des nouveaux arrivants au cœur du processus d’immigration
Lisez notre infolettre
les mercredis et samedis

Hamed Rachid Sidibe étudie en service social à l’Université Laurentienne de Sudbury et travaille comme livreur à temps partiel.
Pour Kouamé Benjamin Boateng, la question de l’inclusion est un véritable défi de société. Il observe que, pour les autorités et les organismes locaux, rendre cette période réellement inclusive est complexe, car les nouveaux arrivants demeurent en minorité. Il est conscient que de s’adapter à toutes ces traditions est compliqué, mais trouve tout de même que cela est «un peu dommage».
Imposer une culture étrangère n’est pas l’objectif, rappelle-t-il. Il s’agit plutôt de créer un mélange où les immigrants adoptent la culture d’accueil tout en préservant la leur. La diversité doit pouvoir être valorisée sans que la culture dominante ignore les traditions minoritaires.
Hamed Rachid Sidibe, de son côté, constate que l’ambiance des Fêtes au Canada reste centrée sur une seule tradition. Il propose ainsi de reconnaitre les grandes fêtes des autres religions, comme l’Aïd el-Fitr ou la Tabaski (Aïd-el-Adha), avec la même importance que les fêtes chrétiennes. Pour que cette diversité soit une force, il plaide pour une inclusion de toutes les religions afin que chacun puisse célébrer sa propre culture dans un cadre reconnu par tous.
À lire aussi : L’identité francophone est-elle plus qu’une langue parlée?
Pour le comprendre, il faut reculer de presque 100 ans. En 1931, les États-Unis traversaient une période très difficile qu’on appelle la Grande Dépression.
Des millions de personnes avaient perdu leur emploi et la population était plongée dans une grande pauvreté.
Mais sur le chantier du Rockefeller Center, alors en pleine construction, les ouvriers voulaient quand même garder un peu d’espoir pour Noël.
Ils ont donc installé un petit sapin et l’ont décoré avec ce qu’ils avaient: des guirlandes en papier et des fruits. C’est ainsi qu’est née la tradition.
Depuis, chaque hiver, les New-Yorkais et des visiteurs du monde entier viennent voir le sapin s’illuminer. Le moment est même diffusé à la télévision. C’est devenu un symbole du début du temps des Fêtes.

Le sapin dans la cour de la famille Ross, avant qu’il soit coupé et transporté à New York.
Chaque année, c’est un nouveau sapin. L’arbre n’est jamais choisi au hasard. C’est le jardinier du Rockefeller Center qui s’occupe de le trouver… et ce n’est pas une tâche facile! Tous les ans, il parcourt les États-Unis pour trouver LE sapin parfait.
Cette année, il l’a trouvé à East Greenbush, une petite ville dans l’État de New York. Il appartenait à la famille Russ, qui l’avait dans son jardin depuis plusieurs générations. Imagine: le sapin mesure 23 mètres!
Avec le temps, il était devenu tellement grand qu’il commençait à être dangereux. Il était temps de le couper.
Judy Ross, qui est maman d’un petit garçon, a donc offert le sapin au Rockefeller Center. Le moment où l’arbre a été coupé était très émouvant. C’est parce que le mari de Judy, Dan, est décédé en 2020.. Ensemble, ils avaient rêvé que leur sapin devienne celui de New York… et cette année, leur rêve est devenu réalité!
Ce que tu vois dans la vidéo en haut de l’article, c’est le grand décompte, c’est-à-dire le moment où le sapin s’est illuminé pour la première fois de l’année. L’événement a eu lieu le 3 décembre dernier. Judy et son petit garçon, Liam, ont fait le voyage pour assister à ce spectacle.
Le sapin restera jusqu’à la mi-janvier. Ensuite, son bois servira à la construction de maisons pour des familles dans le besoin.
Et toi, as-tu un sapin à la maison? Comment le décores-tu?