L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) craint que la Loi sur la laïcité de l’État du Québec – également connue sous le nom de «loi 21» – actuellement devant la Cour suprême, ne crée une brèche dans les droits à l’éducation de la minorité francophone au Canada.
Un droit déjà acquis : Dans un mémoire déposé à la Cour, l’ACÉPO affirme que si la décision de la Cour d’appel du Québec – qui a validé l’application de la loi 21 aux écoles de la minorité anglophone – est maintenue, cela pourrait affaiblir le droit de gestion des écoles francophones hors Québec.
L’ACÉPO ne prend pas position sur la loi elle-même, mais elle redoute que cette interprétation permette aux provinces d’imposer un curriculum aux écoles de langue minoritaire qui ne tiendrait pas compte de leur autonomie de gestion et de leur particularité culturelle.
Cela irait à l’encontre des protections garanties par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et de précédents jugements de la Cour suprême. L’ACÉPO a obtenu le statut d’intervenant pour faire valoir ses arguments devant la Cour suprême.
À lire : Difficile pour les conseils scolaires francophones d’exercer leurs pleins pouvoirs
L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés
L’article 23 de la Charte canadienne garantit le droit à l’instruction dans la langue officielle de la minorité (français ou anglais), là où le nombre d’élèves le justifie.
Il accorde aussi aux communautés linguistiques minoritaires le droit de gérer leurs propres écoles.
Le ministre de l’Identité et Culture canadiennes, Steven Guilbeault, a débloqué 12 millions de dollars pour prolonger, jusqu’en 2025-2026, le volet Mesures spéciales pour appuyer le journalisme du Fonds du Canada pour les périodiques.
Cette aide était prévue dans le budget 2024 et vise à soutenir les journaux communautaires et les magazines, notamment ceux à distribution gratuite ou à faible tirage payant, y compris ceux de langue officielle en situation minoritaire.
Les éditeurs admissibles peuvent soumettre leur demande jusqu’au 17 novembre 2025.
À lire : Un sentiment d’urgence palpable pour les médias de langues minoritaires
Le député conservateur Joël Godin demande au Comité permanent sur les langues officielles de se pencher sur l’usage du français par le premier ministre pendant ses apparitions publiques. Radio-Canada a calculé que 17 % du contenu de 59 discours de Mark Carney était en français. Le député croit que l’utilisation du français et de l’anglais devrait être plus proche du 50 %.
Le premier ministre a dévoilé de nouvelles mesures jeudi pour renforcer la sécurité au Canada et lutter contre la criminalité.
Une réforme sur la table : Le gouvernement entend réformer le Code criminel afin de durcir les règles pour les délinquants violents et récidivistes, avec des peines plus sévères et des conditions de libération plus strictes.
Le gouvernement investira également 1,8 milliard $ sur quatre ans pour embaucher 1000 agents de la GRC, améliorer la lutte contre la criminalité financière et augmenter l’indemnité des cadets.
Des efforts seront aussi demandés aux provinces et territoires, aux municipalités et à la police locale pour lutter contre la criminalité, mais aussi sécuriser la population à travers la construction de logements, le soutien en santé mentale et des programmes pour les jeunes dits «à risque».

Garnett Genuis, ministre de l’Emploi du Cabinet fantôme conservateur, a présenté quatre points pour lutter contre le chômage chez les jeunes au Canada, qui est monté à 14,7 % en septembre, selon Statistique Canada.
En conférence de presse mercredi, le ministre du Cabinet fantôme responsable de l’Emploi, Garnett Genuis, a présenté le plan conservateur fédéral pour lutter contre le chômage chez les jeunes.
Quatre mesures : Le parti de Pierre Poilievre souhaite «libérer l’économie» en abrogeant notamment «les lois anti-ressources» et en réduisant les impôts et «la paperasse».
Il souhaite en outre réformer l’immigration (en abolissant, entre autres, le Programme des travailleurs étrangers temporaires), encourager les employeurs à construire des logements et réformer l’aide financière aux études.
Pour cette dernière mesure, ils les conservateurs ciblent les domaines d’études en demande plutôt que seulement les revenus. Les détails sur les secteurs prioritaires n’ont pas été précisés.
Cette annonce intervient alors que Statistique Canada rapporte que le taux de chômage des jeunes entre 15 et 24 ans a atteint 14,7 %, son plus haut niveau depuis septembre 2010 (hors pandémie).
À lire aussi : Les travailleurs étrangers temporaires «ne volent pas les jobs»

Jean-Denis Garon, porte-parole du Bloc québécois en matière de finances, affirme que son parti a dû «prioriser» ses attentes budgétaires, résumées cette semaine en 18 points.
Mardi, le porte-parole du Bloc québécois en matière de finances, Jean-Denis Garon, a affirmé aux journalistes que les attentes de son parti tenaient en 18 points, dont six «incontournables», en vue du prochain budget qui sera dévoilé le 4 novembre :
En conférence de presse, Jean-Denis Garon a ri nerveusement lorsqu’une journaliste lui a demandé si le Bloc allait appuyer le budget fédéral. «Il faudra notamment que [nos] demandes soient rencontrées et que ces mesures n’aggravent pas les crises [climatiques et du cout de la vie].»
La présidente de la Tribune de la presse parlementaire canadienne, Mia Rabson, a signalé cette semaine que les journalistes n’ont pas été informés à l’avance du voyage du premier ministre en Égypte. Il a participé au Sommet pour la paix au Moyen-Orient, le 13 octobre.
Exclusion alarmante : Dans sa déclaration, la Tribune affirme qu’«une exclusion complète des médias canadiens d’un tel voyage d’un premier ministre à l’étranger est sans précédent».
«Chaque gouvernement à la tête d’une démocratie en santé doit montrer un engagement envers la liberté de la presse. Au Canada, cela inclut le respect du rôle vital que jouent la Tribune et ses membres. Chaque incident qui vient réduire l’accès, la transparence, et l’imputabilité constitue un pas dans la mauvaise direction.»
Dans un contexte de renouvèlement du contrat des interprètes du Parlement, le ministère de Joël Lightbound, Services publics et Approvisionnements Canada (SPAC), a proposé au Bureau de la traduction, qui emploie les interprètes, d’adopter une politique du «plus bas soumissionnaire» pour les embauches.
Cela implique une modification de la nature même du contrat actuel, qui expirera en janvier 2026.
Le ministère et le Bureau de la traduction veulent mettre de côté le contrat actuel, appelé «contrat ouvert», pour le remplacer par une «offre à commande», où les interprètes-pigistes seraient accrédité·e·s sur les missions parlementaires selon l’offre la plus basse.
Les plus chevronnés – qui enseignent la qualité et l’expérience aux nouveaux – sont les plus à risque de partir si les possibilités de rémunération baissent, ont affirmé les deux témoins membres de l’Association internationale des interprètes de conférence Canada (AIIC), au Comité permanent des langues officielles, le 7 octobre.
À lire : Le Bureau de la traduction compte supprimer près de 340 postes en cinq ans
Le Bureau de la traduction, qui emploie les interprètes du Parlement, a fait valoir également au Comité que c’est le processus de renouvèlement normal du contrat.
Ses représentants ont toutefois omis de répondre aux questions du député conservateur Joël Godin à propos de l’offre du plus bas soumissionnaire.
Il s’agit bien d’une modification de la nature même du contrat, contredit l’AIIC. «Cela contraindra les interprètes pigistes à rogner sur les couts. […] Il y a un risque de perdre de la qualité d’interprétation et de perdre les pigistes les plus chevronnés», affirme Nicole Gagnon, membre de l’AIIC.
Sondées sur la question par l’AIIC, 50 % des 90 des interprètes qui ont répondu qu’il est «improbable» qu’ils et elles offrent leurs services au Parlement, contre 3 %, qui offriraient «probablement» leurs services quand même.
| Attribution des missions uniquement selon l’offre la plus basse. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Probable | Peu probable | Neutre | Plutôt improbable | Improbable | |
| Toutes les répondantes (90) | 9 % | 9 % | 10 % | 28 % | 50 % |
| Répondantes acceptant des missions parlementaires, et celles acceptant des missions parlementaires et des missions ministérielles. | 3 % | 10 % | 12 % | 27 % | 47 % |
Une autre proposition du ministère SPAC consisterait, selon les interprètes, à augmenter leurs heures de travail au micro, soit faire 6 heures contre les 4 heures actuelles. Ce serait seulement possible si le parlement se remettait à fonctionner entièrement en personne, disent ces derniers, ce qui n’est pas dans les plans des élus.

Nicole Gagnon, porte-parole de l’AIIC, déplore les propositions du ministère de Services publics et Approvisionnements Canada, qui pourrait modifier les conditions de travail des interprètes et la qualité de leurs services au Parlement.
SPAC propose de ne plus payer à la journée comme actuellement, mais à l’heure. Le sondage de l’AIIC révèle que 79 % de leurs membres qui ont répondu ne comptent pas revenir au Parlement si cette rémunération est appliquée. Selon les règles, les interprètes doivent être présents pour que le Parlement siège.
La rémunération à l’heure est une manière d’exclure de la paie les temps de préparation et de pauses, critique l’AIIC à Francopresse, après la rencontre du comité.
En comité, le Bureau de la traduction a affirmé de son côté que les interprètes étaient payés pour une heure de préparation. Il en faut généralement deux, dit l’AIIC, surtout dans les cas où les interprètes reçoivent de la documentation pour les aider à préparer leur tâche.
Dans une logique de réduction des couts promis par le gouvernement, notamment au sein de la fonction publique, les députés libéraux ont largement insisté sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies pour aider les interprètes dans leur travail de préparation. La plateforme libérale le mentionnait clairement, de même que le gouvernement Carney depuis sa victoire électorale.
L’IA n’est pas une tête pensante […], a rétorqué Nicole Gagnon. On n’empêche pas le progrès, on n’est pas contre. C’est un outil utile à la préparation, si les interprètes reçoivent les textes à l’avance […] Mais [l’IA] n’interprète pas les concepts comme l’humour, les émotions, la culture.»
À lire : Traductions externes : les fonctionnaires francophones paient le prix
Les deux interprètes de l’AIIC ont déploré mardi que les règles de santé et de sécurité auditives ne figurent plus dans le prochain contrat proposé.
Ces dernières années, des blessures sérieuses ont été rapportées par plusieurs interprètes du Parlement du fait du changement de leurs conditions de travail.
Annie Plouffe, vice-présidente des Services au Parlement et Interprétation du bureau de la traduction, a insisté en comité sur le fait que ces règles étaient acquises et intégrées et, qu’à cet égard, le Bureau ne sentait «pas le besoin de les écrire».
«Ça leur lie les mains» de les avoir écrites, observe un membre de l’AIIC.
Au moment de publier, SPAC n’avait pas encore répondu aux questions de Francopresse.
À lire : La santé des interprètes de la Colline un peu mieux protégée
Le Bureau de l’ombud de l’approvisionnement (BOA) a publié un rapport où il a jugé recevables 37 plaintes faites par des interprètes dirigés vers SPAC. Elles avaient été déposées entre juin et juillet 2024 et concernaient la gestion de contrats.
Une modification proposée par SPAC pour prolonger les contrats et redéfinir certaines heures comme du temps de non-interprétation était l’enjeu principal des plaintes.
Le rapport donne raison aux plaintes concernant les changements demandés, notant que «la modification proposée par SPAC aurait entrainé un changement substantiel aux modalités du contrat».
En 15 ans, la communauté africaine et caraïbéenne est passée de 5 à 500 personnes à Iqaluit, au Nunavut. Ce documentaire suit le quotidien de cinq nouveaux arrivants et arrivantes qui ont fait le choix, comme nombre de leurs compatriotes, de s’établir dans le Nord.
Pourquoi? «C’est calme», «il y a moins de pression» – et moins d’impôts – et des emplois, répondent les différents intervenants. L’un d’entre eux assure même que si l’«on arrive le matin, on trouve un travail l’après-midi».
Ces personnes occupent une panoplie de fonctions : du pompier à l’infirmière, en passant par le chauffeur de taxi et l’enseignante.
Mais si les offres d’emploi ne manquent pas, les logements oui. La crise n’épargne pas le territoire, alors que de nouvelles personnes immigrantes arrivent chaque semaine. Un intervenant évoque un salaire à 80 000 $ l’année, un autre, un loyer à 3 500 $.
À lire aussi : Francophonie au Nunavut : croissance record de l’AFN et dissolution du Théâtre Uiviit

Au total, plus d’une vingtaine de pays sont représentés à Iqaluit, au Nunavut.
Le documentaire s’attache également à mettre en lumière les similitudes entre les valeurs des Inuit et celles des communautés africaines, comme le respect des ainés, le sens du partage, le lien avec la nature, mais aussi une expérience commune de la confrontation au racisme.
Les nouveaux arrivants et arrivantes s’attachent à apprendre l’inuktitut pour s’intégrer et pouvoir échanger avec les Autochtones et par signe de respect. Car comme le rappelle un des jeunes interrogés : «C’est leur terre.»
Deux Inuit s’expriment d’ailleurs face à la caméra et disent voir d’un bon œil l’arrivée de ces populations. Même si, à travers un autre témoignage, on perçoit que ces relations peuvent aussi être ambivalentes et complexes.
C’est peut-être là l’écueil du film : il tend à occulter les tensions et les défis qui peuvent exister au sein de la société nunavutoise. Comme si parfois, tout semblait trop beau pour être vrai.
L’ensemble permet néanmoins de découvrir une réalité sans doute méconnue de nombreux Canadiens et Canadiennes, et d’en apprendre davantage sur les dynamiques qui animent la communauté francophone du Nunavut, vibrante et vivante.
À lire ailleurs : Des cours de conduite offerts aux Inuit d’Iqaluit (Le Nunavoix)
À voir sur TV5Unis.
Réparer des objets destinés à la poubelle, se déplacer à vélo, construire à partir de matériaux récupérés, organiser une fête zéro déchet… Ici, pas de rendez-vous galants, de survie sur une ile ou de concours culinaire : chaque semaine, les participants et participantes s’affrontent au nom de l’environnement. Plutôt original.
Les juges, Alex Perron (humoriste, animateur et acteur) et Louise Hénault-Ethier (docteure en sciences de l’environnement), évaluent ensuite les performances et attribuent des points. Seuls les écogestes les plus créatifs seront récompensés, avec à la clé un prix d’une valeur de 50 000 $.
Animée par l’humoriste Korine Côté, cette nouvelle téléréalité espère encourager les auditeurs et auditrices à réduire leur empreinte carbone. La production de l’émission se veut elle-même verte.
C’est ludique, et inspirant. Entre les boutades de Korine Côté et Alex Perron, les explications scientifiques de Louise Hénault-Ethier et la compétition, le tout forme un bel équilibre. Dommage que les juges ne soient pas sur place, aux côtés des candidats et candidates, lors de certaines épreuves.
Cela fait plaisir de voir à l’écran des personnes allumées par l’écologie plutôt que par leur apparence ou leur sens du drame.
À voir sur TV5Unis à partir du 16 octobre, puis tous les jeudis à 20 h sur Unis TV et sur TV5Unis.
Cette série d’animation en sept épisodes redonne voix à des femmes canadiennes trop souvent oubliées par l’histoire officielle. Parmi elles : Diane et Béatrice Desloges, deux enseignantes franco-ontariennes qui ont résisté à l’assimilation pour défendre le droit à l’éducation en français.
À travers un savant mélange d’archives et d’animations numériques, la série revisite avec humour et intelligence des pans entiers de la grande et de la petite histoire des Canadiens français et des Canadiennes françaises. Le résultat? Une œuvre à la fois belle, drôle, touchante et d’une grande finesse.
Au-delà de l’esthétique, Rebelles contribue aussi à transmettre la mémoire collective à une nouvelle génération de francophones. Un hommage vibrant et captivant à des femmes qui ont façonné l’histoire, parfois dans l’ombre.
À lire aussi : Cinq anniversaires, cinq femmes francophones qui ont marqué l’histoire
À voir sur TFO. Les prochains épisodes seront diffusés au mois d’octobre 2025 puis mars 2026.
La demande a été formulée dans une lettre que le SEPF a adressée au conseil d’administration du Conseil scolaire francophone (CSF) le 4 juillet.
Lors de la réunion du conseil d’administration, le 27 septembre, la présidente du CSF, Marie-Pierre Lavoie, a confirmé que la lettre avait été reçue et qu’une réponse officielle suivrait dans les prochaines semaines.
Dans sa lettre, le SEPF demande la démission de Marie-Pierre Lavoie, Gaëtan Desrochers, Armelle Moran, Jacques Dufresne et Marie-Christine Claveau. Le syndicat exclut Chantal Fadous et Sacha Médiné parce que ceux-ci ont «exprimé leur désaccord face aux orientations budgétaires actuelles».
Si les membres visés ne démissionnent pas, le SEPF consultera ses membres pour décider de la prochaine étape. «Je peux vous dire qu’à la publication de cette lettre-là, sur notre site et un partage avec nos membres, nous avons eu plusieurs retours très satisfaits que le syndicat ait pris cette démarche-là», affirme la présidente, Maria Stinchcombe, en entrevue avec Francopresse.
La principale préoccupation du SEPF concerne l’impact financier de la bataille juridique du CSF contre le gouvernement de la Colombie-Britannique et la Commission scolaire de Vancouver.
Malgré une victoire partielle en Cour suprême, le CSF s’est dit déçu de certains aspects du jugement. Le Conseil a donc décidé de faire appel.
Malgré l’arrêt de la Cour suprême du Canada de juin 2020 – qui ordonnait à la Colombie-Britannique de financer au moins une dizaine d’écoles entièrement francophones dans un «délai utile» –, le Conseil scolaire francophone de Colombie-Britannique (CSF) n’a pas pu acquérir de terrains permanents pour les construire.
En aout 2024, le CSF a demandé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique d’ordonner la mise en œuvre de l’arrêt de la Cour suprême du Canada et le respect de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et des libertés.
Cet article garantit notamment le droit des parents francophones en milieu minoritaire à une éducation dans leur langue pour leurs enfants, partout où un nombre suffisant d’élèves le justifie.
Dans son jugement, rendu en mai 2025, le juge ordonne à la province de donner des pouvoirs d’expropriation au CSF. Il ne garantissait cependant pas la propriété des terrains et des édifices et laisse entendre que le Conseil n’a pas bien géré le dossier.

«Un de nos grands reproches, c’est que le conseil d’administration dit : “On fait ça pour le futur”, mais on néglige les personnes qui sont dans le réseau actuellement», dit Maria Stinchcombe du SEPF.
Le syndicat s’inquiète de l’effet du fardeau financier de la cause sur l’éducation des jeunes francophones de la province. «Il y a une baisse constante de ressources et une augmentation des besoins. Il y a un épuisement qui se sent et on demande d’année en année d’en faire plus avec moins», explique Maria Stinchcombe.
La présidente du SEPF indique que même si aucune mise à pied n’a eu lieu, des départs à la retraite n’ont pas été remplacés. De plus, des budgets réduits il y a quelques années pour financer la poursuite n’auraient pas été réinstaurés, précise-t-elle en entrevue avec Francopresse.
La présidente du Syndicat des employés et employées de soutien du CSF (SCFP), Véronique Fleury, fait le même constat : «Avec les dépenses budgétaires pour la poursuite juridique, [les services aux élèves ont] été réduits au strict minimum.» Sans demander lui-même la démission de membres du conseil, le SCFP est en accord avec la lettre du SEFP.
Si les deux présidentes syndicales disent ne pas être contre la revendication des droits des francophones, elles déplorent avant tout le manque de transparence du CSF.
Elles racontent la même histoire : le conseil scolaire n’a consulté aucun partenaire avant de poursuivre le gouvernement et le conseil scolaire anglophone. Pendant que le CSF réfléchissait à la possibilité de porter en appel le jugement rendu en mai 2025, ils ont finalement obtenu une rencontre de consultation.

«Je sais que pendant une des rencontres qu’on avait eues, on nous avait dit qu’il fallait donner un exemple au reste du Canada. En fait, je me demande, est-ce que c’est le devoir [d’un petit conseil comme le] CSF de représenter à l’échelle nationale ce que l’on peut faire?», s’interroge Véronique Fleury du SCFP.
«Lorsqu’on nous a consultés à la fin de l’année scolaire, cinq des six partenaires avaient dit non», relate Véronique Fleury. À la fin juin, le CSF confirmait qu’il faisait appel.
Selon Maria Stinchcombe, les organisations qui ont participé à la discussion sont les deux syndicats, le Regroupement des directions d’écoles francophone, la Fédération des parents francophones (FPFCB) de la Colombie-Britannique, le Conseil jeunesse de la Colombie-Britannique et la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB).
Dans un article de Radio-Canada publié en juin, les porte-paroles de la FPFCB et de la FFCB affirmaient que le CSF n’avait pas d’autres choix que de faire appel. Les deux organismes ont refusé les demandes d’entrevues de Francopresse.
Le SCFP aimerait également voir le contrat avec la firme d’avocats qui a défendu la position du conseil ou au moins savoir combien la poursuite a couté jusqu’à présent. Malgré des demandes d’accès à l’information et des conversations avec le CSF, Véronique Fleury dit attendre encore la réponse.
Lors de la réunion du conseil d’administration du 27 septembre, le secrétaire-trésorier par intérim, Bertrand Dupain, a annoncé que les états financiers 2024-2025 «font état d’un déficit [final] de 3,4 millions», plus bas que les 4,7 millions de dollars de déficit initialement envisagés. Il n’a pas précisé la source du déficit.
Il a ajouté que des discussions sont en cours avec la province pour rembourser 1,4 million par année pendant trois ans.
Au moment de publier ces lignes, Francopresse était en contact avec le CSF. Leurs réponses ont été incluses dans cet article de suivi.
À lire aussi : Difficile pour les conseils scolaires francophones d’exercer leurs pleins pouvoirs
Pierre Calvé : D’abord, «grandeur nature», c’est bien important. Ce mot, ce titre n’a pas été choisi au hasard. Le français est une langue naturelle, c’est-à-dire le fruit naturel d’une évolution de milliers, de dizaines de milliers d’années.
La langue parlée, c’est la langue naturelle. C’est dans la langue de tous les jours, dans la langue spontanée, dans la langue qu’on emploie avec ses amis.
Elle évolue dans le temps, par une évolution naturelle. Elle évolue dans l’espace, selon les lieux géographiques où elle est parlée. Et elle évolue dans la société, selon les classes socioéconomiques, selon l’éducation des gens, selon les niveaux de langue et selon la capacité des individus à être mobiles linguistiquement, c’est-à-dire à ajuster leur niveau de langue aux situations d’usage.
Le français peut aussi bien – et il le fait souvent – se promener en jeans et t-shirt qu’en veston cravate ou en robe de gala.
L’évolution du français au contact d’autres langues, notamment de l’anglais, est-elle un phénomène naturel?
C’est tout à fait naturel.
Une étude de l’Université Laval a montré que, des 60 000 mots du français dans Le Petit Robert, 40 % à peu près ont été empruntés à d’autres langues au cours de l’histoire du français.
L’anglais a emprunté plus de 60 % de son vocabulaire au français pendant les 300 ans de présence du français en Angleterre, sous l’aristocratie. Alors, le français emprunte aujourd’hui et a emprunté à d’autres langues.
Ce n’est pas le fait d’emprunter beaucoup de mots qui fait qu’on s’assimile à l’anglais. C’est le fait de changer de langue, carrément. Alors, le danger, c’est qu’on perde sa langue maternelle parce qu’on adopte l’autre langue. Bien sûr, il y a des emprunts qu’il faut corriger, mais cette espèce d’attitude qu’on parle mal parce qu’on emprunte, non!
Un bon exemple d’emprunt corrigé, c’est qu’en technologie, on dit «on va tester le bogue». «Bug», c’est un mot anglais qui a été francisé par «bogue» et c’est parfaitement acceptable.
Cette insécurité linguistique, elle existe chez tous les francophones, mais beaucoup chez ceux qui vivent en situation minoritaire.
La norme prescriptive considère qu’il n’y a qu’un seul bon usage, que les mots n’ont qu’un seul sens, et elle a écrasé le français et les francophones depuis très longtemps. On a tous été élevés avec l’impression que notre langue n’est pas le bon modèle.
J’ai beaucoup voyagé au Canada, à donner des cours un peu partout, des stages, des conférences, et souvent des enseignants de français à l’extérieur du Québec s’excusaient de la qualité de leur français. Je trouvais ça absolument incroyable qu’ils s’excusent. Chacun a la langue qui vient de son milieu.
C’est certain qu’il faut mettre des mots régionaux.
Le gros problème qu’on a avec la tradition, par exemple le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française, c’est qu’il se limite au français standard, c’est-à-dire un français qui est dénaturalisé.
Quand [un dictionnaire] nomme qu’un mot appartient au français québécois régional, c’est souvent pour le condamner plutôt que simplement dire que ça appartient au langage familier.
Il y a aussi le français populaire qui est stigmatisé en tant que mauvais français. Si je dis «toi, mon chum, t’es t’après t’amancher pour te ramasser au cimetière», c’est du français folklorique qu’on trouve dans Les Belles-Sœurs, par exemple.
Quelqu’un qui immigre au Sénégal ou dans n’importe quel pays francophone en Afrique, que ce soit en Martinique ou ailleurs, il doit pouvoir s’ajuster aux mots régionaux.
Une langue vit dans son milieu. Par exemple, ici, on dit des tuques et des mitaines. En France, ils disent des bonnets et des moufles. C’est le genre de nuance qu’il faut faire quand on parle de mots régionaux.
Alors est-ce qu’on doit changer de langue? Absolument pas. Chacun son parler.
Il faut plutôt hiérarchiser et montrer l’acceptabilité de la langue selon la situation d’usage, selon les règles de la grammaire parlée, pas seulement écrite, et aussi selon les niveaux de langue soignés lorsque c’est nécessaire et qu’on accepte des niveaux très familiers dans des situations familières. C’est le genre de discernement que je fais beaucoup dans mon livre.
Les propos ont été réorganisés pour des raisons de longueur et de clarté.
«J’ai une voiture depuis toujours. En campagne, on n’a pas vraiment le choix», lâche Marianne Vancaemelbeke. Elle habite à environ 5 km du centre d’Alfred, une localité ontarienne située à quelque 80 km à l’est d’Ottawa.

«Si un jour je deviens incapable de conduire une voiture, on est obligé de déménager soit dans le village, à côté de la pharmacie puis du magasin général, ou aller en ville, ce que je ne voudrais vraiment pas faire.»
À l’époque où elle était directrice de l’Union culturelle des Franco-Ontariennes, certains candidats ne pouvaient pas accepter d’emploi au sein de l’organisme, faute de moyen de transport.
«S’il y avait eu un autobus plus fréquent entre Ottawa et Alfred, puis entre les villages, ça aurait aidé beaucoup pour la mobilité des employés», dit-elle.
«On assume qu’en milieu rural, tout le monde a sa voiture et qu’il peut se déplacer autant qu’il veut. Mais les réalités économiques font qu’il y a plein de gens qui n’ont pas de voiture ou qui n’ont pas de l’argent pour mettre de l’essence dans la leur. Et donc ils souhaiteraient avoir d’autres options de mobilité pour se déplacer», observe Jérôme Laviolette, chercheur postdoctoral à l’Université McGill en planification des transports.

«Il y a aussi généralement beaucoup moins d’investissements et de recherche qui se font sur la mobilité en milieu rural, parce que les universités ne sont pas en milieu rural. Les chercheurs vont souvent regarder ce qui se fait dans leur propre ville, sans nécessairement aller voir comment on pourrait améliorer la mobilité en ruralité», remarque Jérôme Laviolette.
«Généralement, dans des petites villes, le transport collectif va bien fonctionner quand on a un centre urbain un peu plus gros, puis on va tenter d’organiser du transport intermunicipalités», ajoute-t-il.
La Colombie-Britannique propose son propre service d’autobus via une société d’État, BC Transit, à l’échelle de toute la province, en dehors de la région de Vancouver. Un modèle de réseau à suivre selon le chercheur, car il permet de subventionner les lignes moins utilisées par celles qui le sont plus.
Mais d’après lui, ce type d’option s’adresse avant tout aux personnes extrêmement convaincues ou à celles qui n’ont pas nécessairement les ressources financières pour posséder une voiture : «C’est un service minimum.» Il note par exemple que souvent, les horaires se limitent aux heures de pointe.
Les gens qui le font, ils le font rarement par choix. Parce que si t’as le choix, tu vas l’avoir la voiture.
Agathe Breton-Plouffe est agente de liaison communautaire pour l’Association francophone de Red Lake, dans le Nord-Ouest de l’Ontario. Dans ce village où l’activité minière est importante, «il y a beaucoup de va-et-vient», remarque-t-elle.
Les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes qui viennent s’y installer sont souvent déstabilisés. Ces personnes arrivent «dans un milieu éloigné, au bout de l’autoroute 105, au milieu du bois», sans posséder une voiture.

«C’est quand même isolant quand t’essaies de t’intégrer dans la communauté pis tu peux pas participer à plein de choses à cause que t’es pris et que tu peux pas te déplacer», déplore Agathe Breton-Plouffe.
L’année dernière, certaines ne pouvaient pas se rendre à Thunder Bay pour passer des tests de reconnaissance d’acquis nécessaires pour enseigner en français en Ontario. C’est précisément cette situation enclavée qui fait que la communauté francophone est tissée serrée et s’entraide, raconte-t-elle, notamment pour les déplacements.
Car ici, point d’autobus, de train ou même de service Uber : «Ça prend deux heures conduire jusqu’à l’autoroute 17, qui se rend jusqu’à Winnipeg ou Thunder Bay.» Deux villes qui se situent respectivement à plus de 5 h et 6 h de route de Red Lake.
Il y a certes un service de taxi, mais il n’est pas «100 % fiable», est souvent surchargé et est cher, précise-t-elle.
La municipalité de Red Lake vient de présenter les résultats d’une étude de faisabilité pour mettre sur pied un projet de transport en commun adapté à la réalité et aux besoins de la communauté. Elle a notamment rapporté des initiatives à l’œuvre dans d’autres communautés rurales ontariennes, comme à Wawa, située à la pointe nord-est du lac Supérieur.
Pour lutter contre une pénurie de chauffeurs d’autobus, cette localité a conclu un arrangement avec le conducteur de l’autobus scolaire, qui, une fois son service terminé, prenait le volant de l’autobus communautaire.
«Il y avait juste certaines heures qui étaient disponibles, mais au moins, ça donnait l’option aux résidents pour aller à des rendez-vous médicaux par exemple», raconte Agathe Breton-Plouffe.
À Red Lake, les navettes qui transportent le personnel à la mine pourraient peut-être faire de même, suggère-t-elle.

Présente dans plusieurs villes canadiennes, la plateforme Communauto offre un service d’autopartage permettant aux usagers de réserver et d’utiliser des voitures en libre-service pour de courtes ou longues périodes.
Elle est depuis peu présente dans les localités québécoises de Chelsea et La Pêche, en périphérie de Gatineau, au nord d’Ottawa. Huit véhicules hybrides rechargeables y sont actuellement stationnés et leur nombre devrait à terme passer à 16.
Porté par le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO), cette initiative, lancée en septembre 2024, vise à réduire la dépendance à l’automobile individuelle, les émissions de gaz à effet de serre et les besoins en stationnement dans les nouveaux logements résidentiels.
«L’idée n’est pas de remplacer la première voiture, mais la deuxième», explique Benoit Delage, le directeur général du CREDDO. Et aussi de réduire les couts liés au stationnement, pour les utilisateurs, mais aussi les municipalités.
Car la demande est bien là, assure Agathe Breton-Plouffe. Personnes âgées, jeunes, nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, travailleurs et travailleuses : «Ça touche tout le monde.»
Le manque d’options de transport nuit particulièrement aux communautés autochtones, racisées et à faible revenu dans les zones rurales, rappelle l’Association canadienne du droit de l’environnement.
Koonis Joyal a grandi dans une communauté autochtone en Saskatchewan. Chez lui, le covoiturage s’organise surtout par le bouche-à-oreille : «Quelqu’un que tu connais, tu peux juste demander : “Tu vas-tu en ville ou veux-tu aller en ville?”»
Il parle carrément de «question de santé mentale» : «Quand on passe beaucoup de temps dans des espaces ruraux, on s’isole. Quand on s’isole, on augmente nos chances de maladies mentales. Ça peut devenir lourd.»
Quand j’ai vécu autour de plusieurs personnes isolées, je me considère chanceux d’avoir eu un char pour aller rejoindre du monde plus heureux socialement. Même si c’était seulement pour un petit montant de temps, ça valait la peine de faire une heure de route pour pas virer fou.
Le transport demeure principalement une compétence provinciale. «Il faut que les provinces se dotent de stratégies, de plans de mobilité, hors des grands centres urbains, pour être capables d’avoir des initiatives cohérentes à travers l’ensemble de chaque province», plaide Jérôme Laviolette.
Les municipalités ou régions peuvent aussi mettre en place des programmes de subventions pour l’achat d’un vélo à assistance électrique.
Au fédéral, un fonds de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada vise à améliorer les services de transports en commun en milieu rural.
Grâce à ce programme, plusieurs collectivités du Manitoba ont par exemple fait l’acquisition de minifourgonnettes électriques et hybrides accessibles, ont installé des bornes et des plateformes de recharge ou encore ont modernisé des garages municipaux.
Ce fonds connait un grand succès. Le ministère fait d’ailleurs état d’un «nombre croissant de demandeurs».
Les municipalités peuvent aussi encourager les gens qui ont une auto à se déplacer à pied ou à vélo. Mais encore faut-il rendre l’expérience attractive.
«Marcher sur des trottoirs minuscules tout tassés où il n’y a pas d’arbres, où il n’y a pas d’ombre, où on est sur le bord d’une route passante à 70 kilomètres à l’heure, il n’y a personne qui aime ça», relève Jérôme Laviolette.
Et, c’est bien connu, l’être humain change difficilement ses habitudes. Ce n’est pas parce que les municipalités mettent en place de nouveaux modes de transport que la population va les adopter d’emblée.
«Même si on veut mettre en place des alternatives à l’automobile, comment est-ce qu’on arrive non seulement à ce que les gens soient informés et après ça qu’ils considèrent ça dans leur choix pour se déplacer?», interroge le spécialiste.
À lire : Ruralité et politique : des programmes conçus pour les villes?
Selon La Presse, le Bloc québécois a porté plainte contre le gouvernement fédéral auprès du commissaire aux langues officielles pour avoir annoncé uniquement en anglais la création de la nouvelle Agence de l’investissement pour la défense.
Celle-ci devrait moderniser l’approvisionnement militaire et les relations entre les Forces armées canadiennes et l’industrie de la défense au Canada.
Pas de français : En outre, le secrétaire d’État à l’Approvisionnement en matière de Défense, Stephen Fuhr, n’a pas parlé en français ou n’était pas accompagné d’un ou d’une collègue francophone lors de son point de presse, ce qui contrevient à la Loi sur les langues officielles. Un communiqué bilingue a toutefois suivi.
Le Commissariat aux langues officielles rapporte que le bureau de Stephen Fuhr n’a pas commenté la situation.
Le ministère Service publics et Approvisionnement propose de modifier le contrat des interprètes parlementaires, en optant pour une formule d’«offre à commandes» basée sur le plus bas soumissionnaire.
Craintes : Cette approche inquiète les interprètes, qui craignent une baisse de la qualité et la perte de conditions de travail essentielles.
L’Association internationale des interprètes de conférence Canada souligne que ce nouveau modèle pourrait exclure le temps de préparation et de pause du calcul de la rémunération, tout en allongeant les heures de travail, notamment en contexte hybride, ce qui pose des risques pour la santé auditive.
Les règles de santé et sécurité ne seraient plus inscrites explicitement dans le nouveau contrat. Le Bureau de la traduction assure qu’elles restent en vigueur, mais les interprètes s’inquiètent de leur absence formelle dans le futur contrat.

Raymond Théberge a étendu son mandat par deux fois et devrait quitter son poste de commissaire aux langues officielles d’ici janvier 2026.
En comité sénatorial lundi soir, le commissaire aux langues officielles sur le départ, Raymond Théberge, a affirmé que le secrétariat du Conseil du Trésor «continue d’émettre des directives qui n’en sont pas» : «Il y a trop de flexibilité des institutions fédérales pour faire la mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles», a-t-il lâché.
Réductions budgétaires : Concernant les réductions qui s’en viennent au sein des ministères fédéraux, le commissaire a affirmé que «si on doit réduire la taille du personnel, il faut conserver la capacité d’opérer dans les deux langues officielles».
Il a souligné que dans les Forces armées, «on ne vise pas de réduction, mais le contraire».
«Dans certaines organisations, il est difficile d’intégrer le bilinguisme. Les langues officielles n’ont pas été pleinement intégrées dans les opérations de l’appareil de l’État.
De retour de Washington mercredi, le premier ministre Mark Carney a subi le feu des questions de l’opposition sur ce qu’il était censé ramener au Canada : un accord avec les États-Unis, pour faire retirer ou amoindrir les tarifs imposés depuis mars par l’administration Trump. Il est cependant revenu sans bonnes nouvelles pour l’économie canadienne.
Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, a ainsi ironisé : «Wow, la barre était là : ne pas se faire chicaner par le président Trump. Le premier ministre devait obtenir plus et parler moins, nous avons obtenu le contraire».
Marc Carney a répondu qu’un accord pour les secteurs de l’acier, de l’aluminium et de l’énergie, une nouveauté, était en cours de négociation.
Le gouvernement fédéral changera son cycle budgétaire en présentant désormais le budget à l’automne, à partir de cette année.
L’objectif est d’offrir plus de prévisibilité aux provinces, aux entreprises et aux investisseurs, notamment pour le lancement des projets dès le printemps.
Nouveauté : Le prochain budget, attendu le 4 novembre, introduira une nouvelle méthode comptable distinguant les dépenses de fonctionnement des investissements en capital, sans toutefois changer le calcul du déficit. Cette méthode vise à mieux orienter les décisions d’investissements à long terme.
Ce changement suit une promesse électorale de Mark Carney : équilibrer les dépenses de fonctionnement d’ici trois ans.
Les partis d’opposition, notamment les conservateurs et le Bloc québécois, critiquent un manque de transparence et une tentative d’embellir les finances publiques.

Israël et le Hamas ont conclu un accord pour un cessez-le-feu permanent en Palestine, la libération des otages des deux côtés et la reconstruction de Gaza. Des zones d’ombres sur le futur de la Palestine persistent, alors que la joie a éclaté des deux bords.
Un accord a été signé jeudi matin entre Israël et le Hamas, lançant la première phase du plan de paix en 20 points de Donald Trump. Ce texte marque officiellement la fin des attaques d’Israël sur la Palestine, avec un cessez-le-feu prévu dans les 24 heures et la libération réciproque de tous les otages.
Liesse et doutes : Le plan promu par Donald Trump – qui cherche à obtenir un prix Nobel de la paix – suscite de vives critiques.
L’un des points controversés concerne la reconstruction de Gaza, impliquant plusieurs acteurs, dont Donald Trump lui-même et l’ancien premier ministre du Royaume-Uni, Tony Blair.
L’accord prévoit qu’Israël libère 1700 prisonniers palestiniens, dont 450 mineurs, ainsi que 250 détenus purgeant des peines de prison à vie. De son côté, le Hamas s’engage à remettre une quarantaine d’otages israéliens, dont plus de la moitié ont été tués.
Des zones d’ombre subsistent sur l’avenir de la Palestine, sa gouvernance et l’aide humanitaire dans une bande de Gaza dont 92 % des résidences ont été détruites. Selon le Croissant-Rouge égyptien, plus de 150 camions d’aide humanitaire ont déjà franchi la frontière égyptienne en direction de l’enclave, rapporte Le Monde.
Depuis le 8 octobre 2023, près de 69 000 Palestiniens ont été tués, dont plus de 18 500 enfants. Le 7 octobre, 1200 Israéliens sont morts après l’attaque du Hamas.
Félicitations au président Trump pour son leadership essentiel et merci au Qatar, à l’Égypte et à la Türkiye d’avoir travaillé sans relâche pour faire avancer les négociations.
— Mark Carney (@MarkJCarney) October 9, 2025
Je suis soulagé d’apprendre que les otages seront bientôt réunis avec leurs familles.
Après des…
«La reconnaissance pousse les pays autour de nous», estime le député libéral de Mississauga-Centre, Fares Al Soud, premier Canadien d’origine palestinienne élu au Parlement.
«Israël reste un allié des États-Unis, de la même manière qu’il reste un allié pour nous. Les États-Unis regardent leurs alliés reconnaitre l’État de Palestine, indiquer qu’il y a une crise humanitaire et ce que j’appelle un génocide. Allons-nous continuer de la même manière que nous l’avons fait depuis des générations? Où allons-nous changer de cap?»
«Il est indéniable que la reconnaissance d’un État palestinien souverain et indépendant revêt à bien des égards un caractère symbolique, admet le député. Mais le symbole en soi n’est pas insignifiant. C’est un symbole que, pendant des générations et des décennies, les politiciens canadiens ont refusé de mettre de l’avant.»
Selon lui, la reconnaissance contribue à instaurer une «relation entre les Palestiniens et les Israéliens dans la région».
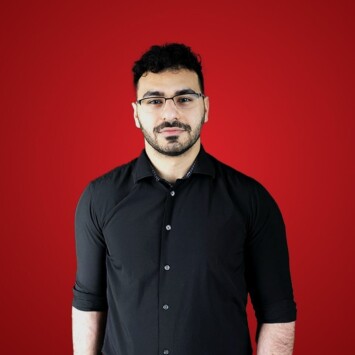
Le premier député canadien d’origine palestinienne à être élu au Parlement canadien, Fares Al Soud, affirme qu’«aucune bonne politique n’est issue d’extrêmes», pour répondre à la demande faite par de nombreux Canadiens de rompre les liens avec Israël.
Le professeur de sociologie à l’Université du Québec à Montréal, Rachad Antonius, contrecarre : pour lui, malgré la reconnaissance, «nos politiciens continuent à appuyer indéfectiblement Israël, car ils voient la guerre comme Israël la voit».
Le professeur Antonius souligne que sur le site Internet du gouvernement, on peut lire que le gouvernement canadien mentionne les «territoires occupés» par Israël.
«Si ce sont des territoires occupés militairement par Israël, et le Canada dit que les colonies sont illégales, logiquement Israël ne peut pas être en situation de légitime défense, elle est une puissance occupante. Or, quand tous nos politiciens disent qu’Israël a le droit de se défendre, ils violent les principes du Canada.»
Au cours des deux dernières années, la pression civile au Canada s’est accentuée pour que le pays coupe ses liens avec Israël, diplomatiques et économiques, en cessant d’exporter des armes dont la destination n’est pas connue et en révisant l’accord de libre-échange entre les deux pays.
«Ce pourrait être un moyen de gérer la situation. Mais cela isolerait encore davantage Israël. Et je ne suis pas certain que ce soit en faveur des personnes sur le terrain», estime le député Al Soud.
D’après lui, cela enverrait le message selon lequel le Canada est anti-israélien. «Or, ce n’est pas le cas. […] Le problème n’est pas quand on n’est pas d’accord. Le problème c’est quand on arrête d’avoir des conversations.»
Le Canada se trouverait ainsi exclu de discussions importantes sur la Palestine et sur la scène internationale en général: «Je ne veux pas punir les Israéliens pour les actions du gouvernement de Nétanyahou. […] Qu’est-ce qui va le plus directement affecter le gouvernement Nétanyahou en ce qui concerne ce génocide? Et qu’est-ce qui va sauver plus de vies?», interroge le député Al Soud.
Il concède toutefois : «Peu importe à quel point ce gouvernement agit rapidement, ce sera toujours trop lent, parce que les gens mourront chaque minute de chaque jour. C’est absolument vrai en même temps que les pressions externes, comme le débat avec Trump aux États-Unis, ont probablement un rôle à jouer dans la vitesse à laquelle nous sommes capables de nous mobiliser et d’être sur le sol.»
Dans la même veine, l’élu soutient que le gouvernement canadien veut pouvoir condamner aussi bien les attaques du Hamas le 7 octobre 2023 que le génocide d’Israël en cours à Gaza.
À lire aussi : Du Canada à Gaza : des médecins dénoncent la violence coloniale
Le professeur Rachad Antonius rappelle que plus de 7300 Palestiniens sont morts aux mains du gouvernement Nétanyahou entre le 1er janvier 2008 et le 29 septembre 2023, selon Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’Organisation des Nations unies. «En toute indifférence», ajoute-t-il.

Le professeur en sociologie de l’UQAM désormais à la retraite, Rachad Antonius, accuse le Canada de tenir un double discours, car le gouvernement affirme que les territoires sont occupés en Palestine, mais il réitère son soutien «indéfectible» à Israël, «qui commet un génocide», ajoute-t-il.
Rachad Antonius rejoint le député sur le fait qu’il n’est pas nécessaire de couper toutes les relations diplomatiques : «Il y a des mesures intermédiaires», avance-t-il.
«On peut maintenir les ambassadeurs [israéliens, NDLR], mais mettre fin à tous les traités de coopération. On a un traité d’amitié avec Israël jusqu’à aujourd’hui. Nos politiciens continuent à dire que c’est une guerre contre le Hamas, ce qui est faux, c’est une guerre contre les Palestiniens. Ils continuent de dire que notre appui indéfectible va à Israël. Tout ça peut changer sans couper les liens.»
Selon le professeur, le Canada continue d’envoyer des composants militaires à Israël et qui transitent par les États-Unis. Arrêter de vendre ces composantes entraine «une perte financière que le Canada était prêt à faire pour la Russie, mais pas pour Israël», selon lui.
Il rappelle aussi que le Canada a continué à appeler au désarmement du Hamas, après la reconnaissance de la Palestine.
«Soit. Mais pourquoi on ne dit pas la même chose des personnes au gouvernement israélien?», déplore-t-il, faisant référence notamment au mandat d’arrêt international dont fait l’objet Benjamin Nétanyahou.
«Je suis en faveur de tout ce qui arrête de faire mourir les gens», commente Fares Al Soud, à propos du plan de paix proposé par Donald Trump pour Gaza.
La première phase de ce plan de 20 points a fait l’objet d’un accord entre Israël et le Hamas signé le 9 octobre, qui met en œuvre une première phase du plan. Il signale la fin de la guerre. Un cessez-le-feu entrerait en vigueur dans les 24 heures et tous les otages devraient être libérés des deux côtés.
Israël doit maintenant relâcher 1700 prisonniers palestiniens, dont 450 enfants, ainsi que 250 autres condamnés de prison à vie.
Le Hamas va libérer une quarantaine d’otages : dont plus de la moitié ont été assassinés.
Le plan de Donald Trump est controversé, entre autres en ce qui concerne la gouvernance de transition de Gaza, qui serait supervisée par Donald Trump et l’ancien premier ministre du Royaume-Uni, Tony Blair.
À l’heure d’écrire ces lignes, le flou persiste sur les détails de la délivrance de l’aide humanitaire, comme la nourriture et les besoins médicaux urgents et vitaux entreront dans l’enclave palestinienne où 92 % auraient été détruites.
Plus de 150 camions ont traversé le jour de la signature la frontière égyptienne en direction de Gaza, selon le Croissant rouge égyptien, relate le quotidien français Le Monde.
Et maintenant au Canada?
Concrètement, la prochaine action politique du Canada qui pourrait avoir un poids se présente sous la forme du projet de loi privé (émanant d’un ou d’une députée, NDLR) déposé par la députée néodémocrate Jenny Kwan en septembre, soutenu par son collègue libéral Fares Al Soud.
La pièce législative vise à combler les failles des lois canadiennes qui permettent notamment à des armes et leurs composants fabriqués au Canada de se retrouver dans des pays responsables de crimes de guerre et de violations des droits de la personne.
Peut-on purger une peine équitable quand on ne comprend pas la langue de son geôlier? Cette question est revenue sur le devant de la scène en juillet dernier, lorsque Le Devoir a révélé que la majorité des 483 détenus francophones de l’Ontario n’ont pas systématiquement accès à des services en français dans les établissements carcéraux de la province.
Au niveau fédéral, les droits linguistiques des détenus sont protégés par la Loi sur les langues officielles (LLO) : « Les établissements correctionnels fédéraux doivent offrir des services et communications dans la langue officielle de leur choix là où il existe une demande importante », rappelle le Commissariat aux langues officielles par courriel.
Difficile de confirmer si ces droits se concrétisent derrière les barreaux. Depuis 2019, le Commissariat aux langues officielles a reçu 28 plaintes concernant l’accès aux services en français dans les établissements correctionnels fédéraux.
De son côté, Service correctionnel du Canada (SCC) n’a pas fourni de données à Francopresse sur la situation des détenus francophones. Dans une déclaration transmise par écrit, il rappelle que les prisonniers peuvent porter plainte auprès du Commissariat s’ils estiment que leurs droits linguistiques ne sont pas respectés.
L’agence fédérale souligne également offrir des programmes de formation linguistique à ses employés. Elle ne précise cependant pas combien de postes bilingues sont réellement pourvus ni combien de programmes correctionnels sont disponibles en français.
La situation n’est pas plus claire par province. En Ontario, 58 personnes incarcérées dans la province dans les prisons qui relèvent du fédéral ont désigné le français comme langue officielle préférée en 2023-2024.
Seuls quelques-uns des 25 centres correctionnels fédéraux de cette province offriraient réellement des services en français, rapporte Le Devoir.

L’accès aux services en français est déjà difficile dans plusieurs secteurs au pays. La situation est encore plus compliquée en milieu carcéral de par sa nature.
Cette problématique reste très peu explorée, mais «elle commence déjà à apparaitre dans les recherches», souligne-t-il. Selon lui, le manque de transparence quant aux données dans le milieu carcéral contribue à cette opacité.
«Bien avant de participer au Prison Transparence Project (PTP), nous avions constaté qu’il était impossible de lancer une initiative dans le domaine de la linguistique parce que les données n’existent pas», explique-t-il. Le PTP est une étude menée au Canada, en Argentine et en Espagne, sur la transparence de l’information entourant les prisons.
Le spécialiste affirme que le processus de réhabilitation des prisonniers perd en efficacité sur les détenus n’ont pas accès à un service dans leur langue.
Au Canada, la prison a surtout une dimension correctionnelle et de réhabilitation, avec des programmes qui l’accompagnent. Si ces initiatives ne sont pas mises en œuvre dans les deux langues officielles, on peut se poser des questions sur leur efficacité et, donc, sur la fonction même de la prison.
Au Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue, offre une réponse similaire.
Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique assure respecter ses obligations linguistiques et cite plusieurs initiatives, notamment l’identification de la langue de préférence dès l’admission, la présence de personnel bilingue, l’accès à des documents en français et à des professionnels francophones sur demande.
Le ministère et le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick affirment aussi qu’aucune plainte récente n’a été signalée concernant les services linguistiques. Mais il ne fournit aucune donnée sur le nombre de détenus francophones dans ses établissements.
Les solutions technologiques
Pour Joao Velloso, la solution – principalement dans les provinces avec de fortes communautés francophones – passe par le recrutement et la formation de personnels bilingues.
«La technologie [qu’il s’agisse d’ordinateurs, de tablettes ou de services de visioconférence], peut également faciliter l’accès aux services en français, même si on observe une certaine résistance, notamment dans les établissements où l’on utilise encore le téléphone à pièces pour la communication avec l’extérieur», ajoute-t-il.
«Dans certaines juridictions, exclure la technologie du milieu carcéral revient à aller à l’encontre du principe même de la réhabilitation et de la réinsertion dans une société de plus en plus numérique.»
À lire aussi : Les francophones en milieu minoritaire, orphelins de données
En fait, ce n’est pas seulement important : c’est essentiel.
Les Franco-Ontariens, disait Édith Dumont, ont la responsabilité de s’exprimer en français, pour ainsi rappeler haut et fort l’importance de pouvoir utiliser leur langue maternelle.
Parler français dans l’espace public c’est aussi, a-t-elle ajouté, une façon d’honorer le passé et de se souvenir des luttes menées pour protéger notre langue.
Des luttes qui se poursuivent, car il ne faut jamais «tenir pour acquis nos acquis».
En insistant sur l’importance d’une présence francophone dans l’espace public, la lieutenante-gouverneure cherche à affirmer la légitimité du français au pays.
Ce qu’elle a dit, bien des gens le pensent. Bien des gens pensent aussi que la majorité anglophone canadienne ne porte pas suffisamment attention à la situation précaire du français au pays, à commencer par de nombreux élus.
À lire : Discours du Trône : la francophonie minoritaire évoquée, mais «peu considérée»

La nomination de Mary Simons comme gouverneure générale était un pas important pour la vérité et la réconciliation, pas pour le leadeurship en francophonie.
Édith Dumont est la première Franco-Ontarienne à être nommée lieutenante-gouverneure de l’Ontario. Elle occupe une fonction hautement honorifique, mais pour laquelle les symboles jouent un rôle essentiel.
Sa nomination avait été chaudement applaudie par la communauté francophone et par la classe politique. Mais si cette nomination doit être saluée, il ne faut pas non plus être dupe. Elle est survenue après plusieurs décisions politiques malheureuses.
Ainsi, Justin Trudeau avait nommé une lieutenante-gouverneure unilingue anglophone au Nouveau-Brunswick, pourtant la seule province officiellement bilingue au pays. Il avait aussi choisi Mary Simon comme gouverneure générale du Canada, alors qu’elle était incapable de s’exprimer en français.
Quant à Doug Ford, premier ministre de l’Ontario, il s’était empressé de sabrer dans les services en français dès son arrivée au pouvoir, en 2018, notamment en abolissant le poste de commissaire aux services en français, poste rétabli depuis, mais avec moins de responsabilités et moins d’autonomie.
La nomination d’Édith Dumont peut être vue comme une initiative pour réparer les torts causés par ces décisions. Mais est-ce suffisant?
À lire : Mary Simon, gouverneure générale : «Une nomination presque parfaite»
Il y a matière à inquiétudes. Pour commencer, le premier ministre du Canada, Mark Carney, ne donne pas l’impression d’avoir une solide compréhension des questions linguistiques. Celles-ci semblent secondaires en cette grande période d’incertitude économique.
Ça ne fait pas encore six mois qu’il a été élu et déjà la situation linguistique est préoccupante.
La Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) a même décidé de rappeler le gouvernement à l’ordre, il y a deux semaines. En conférence de presse, elle a dénoncé le peu d’empressement du gouvernement fédéral à régler plusieurs dossiers.

Le titre de ministre des Langues officielles n’a pas été attaché à Steven Guilbeault lors de la formation du premier cabinet de Mark Carney. Il en a hérité après l’élection seulement.
Elle notamment soulevé des inquiétudes à propos de l’atteinte des nouvelles cibles d’immigration francophone. Le gouvernement n’a toujours pas présenté sa stratégie.
Elle s’est aussi dit préoccupée par la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la Loi sur les langues officielles. Encore une fois, le gouvernement tarde à dévoiler ses plans de mise en œuvre.
À lire : Loi sur les langues officielles : Steven Guilbeault promet des règlements d’ici Noël
Enfin, la FCFA appréhende les effets des prochaines compressions budgétaires qui risquent d’affecter l’offre des services en français.
Le gouvernement a d’ailleurs déjà annoncé que l’une de ses premières initiatives en matière d’intelligence artificielle concernera les services de traduction. Ceux-ci seront offerts par un logiciel, actuellement mis à l’essai dans six ministères.
Pourtant, le commissaire aux langues officielles avait émis plusieurs doutes quant à l’utilisation de tels logiciels. Le français n’est pas juste une affaire de traduction.
On le sait, l’histoire est remplie d’exemples montrant que coupes budgétaires et offres de services en français ne font pas bon ménage. Modifier les services en français dans le but de faire des économies n’est tout simplement pas la voie à suivre.
Qui donc doit rappeler à l’ordre le gouvernement? Le commissaire aux langues officielles ainsi que les organismes de défense des droits linguistiques, comme la FCFA, ont la légitimité de le faire et ils le font.
Par contre, il n’y aura pas de résultats tangibles si le gouvernement ne les écoute pas. Non seulement doit-il y avoir un interlocuteur dans l’appareil gouvernemental, mais cet interlocuteur doit être de très haut rang.

Entouré d’autant de ministres francophones, on pourrait s’attendre à ce que le premier ministre Mark Carney soit plus sensibilisé aux besoins des communautés francophones.
À vrai dire, ça doit être le premier ministre.
C’est lui qui définit les priorités du gouvernement et c’est lui qui peut exiger des résultats de la part de l’ensemble de sa fonction publique, à commencer par ses ministres et ses sous-ministres. Mais surtout, c’est lui qui donne le bon exemple.
Jusqu’à présent, le premier ministre ne montre pas l’exemple.
N’a-t-il pas en fait «oublié» de nommer un ou une ministre aux affaires francophones lors de la création de son premier cabinet? Même s’il a depuis rectifié le tir, le mal est fait. Le message était clair : la francophonie ne fait pas partie de ses priorités.
À lire : Mark Carney premier ministre : les Langues officielles évincées
Encore, au cours des dernières semaines, nous avons eu des manifestations du peu de préoccupations du premier ministre sur les questions linguistiques.
Il aurait dû dénoncer le fait que ce sont les contribuables canadiens qui paient la facture des cours de français de la gouverneure générale. Il ne l’a pas fait. Doit-on rappeler que, depuis sa nomination en 2021, Mary Simon n’a toujours pas donné d’entrevue en français, à part une tentative très inefficace en 2023?
Mark Carney aurait aussi dû saluer, avec empressement et enthousiasme, la décision du premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, de faire de sa province, une province bilingue. Encore une fois, il ne l’a pas fait.
Faut-il donc accepter le fait que nous n’avons plus de défenseur de la cause francophone dans la personne du premier ministre?
Il est difficile et peut-être même prématuré de se résoudre à un tel fatalisme. On peut encore espérer que le premier ministre comprendra éventuellement l’importance des questions linguistiques pour les populations francophones. Mais en même temps, il faut peut-être se préparer à cette éventualité pour les prochaines années.
Geneviève Tellier est professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa. Ses recherches portent sur les politiques budgétaires des gouvernements canadiens. Elle commente régulièrement l’actualité politique et les enjeux liés à la francophonie dans les médias de tout le pays.