Crésus était le dernier roi de Lydie, un royaume situé dans la Turquie d’aujourd’hui. On lui attribue en effet les premières frappes de monnaie. À moins que ce soit attribuable à son prédécesseur … ou encore à d’autres avant eux. Souvent, l’Histoire nous dit tout et son contraire.

L’une des plus vieilles (vers 560-546 av. J.-C.) pièces de monnaie (en or) a été frappée par Crésus (qui, apparemment, était riche), roi de Lydie (dans la Turquie moderne). Tête de lion et de taureau.
Quoi qu’il en soit, l’argent (en pièces) a commencé à se répandre et à être échangé contre des marchandises, comme du bétail ou des céréales, en remplacement du troc traditionnel.
Évidemment, les Grecs ne vont pas tarder à réfléchir à cette nouvelle façon de faire.
Le philosophe Platon y voit un symbole de cohésion dans la cité, pourvu que les commerçants fassent preuve de modération dans leurs désirs de gains. Son disciple Aristote dira que la monnaie est un objet social, utile pour satisfaire des besoins et non pour faire des profits. Ils étaient meilleurs philosophes que devins.
Diogène, un autre philosophe, mais d’un tout autre genre, voit l’argent comme un élément contre nature, le symbole des institutions de la cité qui écarte les hommes du bonheur.
Il faut dire que Diogène était opposé aux lois et à presque tout ce qui lui venait à l’idée. Ironiquement, son père était banquier et avait été accusé de fabriquer de la fausse… monnaie.
Les Romains ont eu un gros mot – littéralement – à dire sur cet outil d’échange, car ils sont à l’origine du mot monnaie. Au IIIe siècle av. J.-C., la République romaine commence à frapper des pièces en argent dans une annexe du temple de Junon Moneta (en latin : Monetae, «qui avertit»). Junon était la sœur du dieu Jupiter (l’équivalant du Zeus grec).
Alors que les Romains prennent de l’expansion autour de la mer Méditerranée, leur monnaie se répand aussi, sous la forme de sesterces ou de deniers. Moneta deviendra ainsi le mot général pour dire «monnaie» et sera adopté avec certaines variantes dans plusieurs langues européennes.
Au cours des siècles, la monnaie évolue : aux pièces en métal s’ajoute le papier-monnaie. Bien avant tout le monde, ce sont les Chinois qui conçoivent et adoptent ce genre de monnaie, qui n’est pas tout à fait du papier, mais de l’écorce de murier transformée en feuilles minces.

La monnaie de carte était un genre de papier-monnaie en usage au cours des 100 dernières années de la Nouvelle-France.
Le grand voyageur Marco Polo sera d’ailleurs fasciné par cette invention et en fera les louanges dans ses écrits.
Dans les années 1660, la Suède devient le premier pays d’Europe à faire usage du papier-monnaie; l’innovation ne se répand au reste du continent qu’au siècle suivant.
À peu près au même moment, un genre de papier-monnaie fait son apparition en Nouvelle-France : la monnaie de carte.
On doit cette monnaie nouveau genre à l’intendant Jacques de Meulles, qui était confronté à une pénurie d’argent sous forme de pièces. La monnaie de carte était appelée ainsi parce qu’elle était faite à partir de cartes à jouer.
Les autorités à Paris s’opposent vivement à cette pratique et cette monnaie est retirée de la circulation. Mais la situation monétaire se détériore et Québec réémet des cartes. Avec quelques interruptions, la monnaie de carte restera en usage presque jusqu’à la conquête britannique de 1759.
Les nouveaux dirigeants introduisent la livre anglaise, mais celle-ci a de la difficulté à s’imposer. D’autres monnaies circulent tout au cours de la première moitié du XIXe siècle, dont le dollar américain et la piastre espagnole.
Ah, la piastre! Si cette monnaie a disparu depuis longtemps, le mot, lui, subsiste au Canada francophone pour désigner familièrement notre bon vieux dollar.
D’ailleurs, au départ, le mot piastre était le véritable équivalent français du mot anglais dollar. Mais l’Académie française en a décidé autrement au XIXe siècle et le dollar a été accepté dans la langue de Molière.
Cela dit, piastre résiste encore et toujours à l’envahisseur et se prononce généralement piasse.

Dans la première moitié du XVIIIe siècle, dans le Bas et le Haut-Canada, le mot piastre était l’équivalent en français de dollar.
Dans les années 1860, alors que les colonies britanniques du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve s’émancipent de plus en plus de Londres, elles commencent toutes à substituer leur propre monnaie à la livre britannique.
Cependant, le dollar canadien remplacera ces devises lors de l’entrée de ces provinces dans la Confédération canadienne.

Des billets de 25 $ ont été imprimés une seule fois, soit en 1935, à l’occasion de 25e anniversaire du couronnement du roi George V. Exceptionnellement, deux versions distinctes, en français et en anglais, ont été fabriquées.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la première pièce de monnaie canadienne mise en circulation n’a pas été le cent, mais le dix cents, en 1858, suivi du vingt-cinq cents en 1870. La «cenne noire» n’a été frappée qu’en 1920, suivie de la pièce de cinq-cents en 1922.
Le billet d’un dollar canadien est apparu en 1858, alors que les billets de deux, cinq, cinq-cents et mille dollars ont été imprimés pour la première fois en 1887. Le billet de vingt dollars s’est ajouté en 1934.
En 1935, la Banque centrale du Canada, créée cette même année, a imprimé exceptionnellement un billet de vingt-cinq dollars afin de souligner le 25e anniversaire du couronnement du roi George V. Deux versions distinctes en français et en anglais ont été émises.
Beaucoup d’encre – c’est le cas de le dire – a coulé depuis cette époque et l’avenir du papier-monnaie est aujourd’hui plus qu’incertain.

Nettoyage à la main d’une presse à billets de banque en 1955.
Chaque année, de moins en moins de transactions sont effectuées avec de l’argent comptant. Au Canada, entre 2017 et 2022, les paiements en argent comptant ont diminué de 41 %.
Et il y a aussi tout le phénomène de la cryptomonnaie.
Il est aussi de plus en plus question de l’apparition d’un dollar numérique au Canada, comme l’ont déjà fait d’autres pays. Cette devise virtuelle pourrait être utilisée sans avoir de compte bancaire, mais son usage serait cependant parallèle à l’argent liquide.
On prédit depuis quelques années la fin de l’argent liquide. Mais l’annonce de la mort du dollar papier est largement exagérée. Pour l’instant.
Le philosophe Aristote est l’un des premiers à avoir cherché à mesurer la circonférence de la Terre. En divisant le globe en différentes zones (polaires, tempérées, centrale), il parvient à un chiffre se situant en unités de mesure modernes entre 60 000 et 70 000 km. Or, la mesure exacte du tour de la Terre est de 40 075 km. On peut pardonner ce léger écart à Aristote. Le GPS n’existait pas encore.
Quant à Posidonius, il errera dans l’autre sens. En observant l’étoile Canopus à Rhodes puis à Alexandrie, en Égypte, ce philosophe, astronome et géographe pense avoir déterminé l’angle – ou la fraction du cercle – qui sépare les deux endroits.
Il mesure ainsi une circonférence de 18 000 km, soit moins de la moitié de la distance que l’on connait aujourd’hui.
Né en 276 av. J.-C., Ératosthène est appelé à Alexandrie par le pharaon Ptolémée III (à ne pas confondre avec le savant). Le souverain souhaite que le savant veille à l’éducation de son fils, le futur Ptolémée IV.

Grâce à un bâton et à un chameau, le savant Ératosthène a réussi l’exploit de mesurer la circonférence de la Terre.
Une vingtaine d’années plus tard, le pharaon nomme Ératosthène directeur de la célèbre bibliothèque d’Alexandrie, créée par le fondateur de la dynastie lagide, Ptolémée Ier.
Dans ce temple de la connaissance, Ératosthène peut mener de multiples recherches dans des domaines variés, que ce soit l’altitude des montagnes, le catalogage des étoiles, la répartition des continents ou encore l’invention d’un procédé mathématique pour trouver les nombres premiers.
C’est déjà un bon bagage. Mais Ératosthène passera plutôt à l’Histoire pour son calcul de la circonférence de la Terre. On pourrait dire que sa méthode était simple et qu’il fallait seulement y penser. À bien y regarder… pas si simple que ça.
Peut-être a-t-il été inspiré par la personne d’Archimède, l’un des plus grands mathématiciens de l’Antiquité, qu’il a côtoyé lors du séjour de celui-ci à Alexandrie.
Il faut dire qu’Ératosthène vivait dans l’endroit idéal pour faire ce genre de calculs. Il lui fallait d’abord deux lieux situés sur un même méridien (ou à peu près), dont l’un devait être près du tropique du Cancer.
Or, la ville de Syène (aujourd’hui Assouan, dans le sud de l’Égypte) se trouve un peu au-dessus de ce tropique, qui revêt une importance cruciale dans cette expérience. Pourquoi? C’est qu’au solstice d’été, le Soleil frappe directement le tropique du Cancer. Ce jour-là, l’astre lumineux ne produit aucune ombre, car il est à la verticale de ce tropique à midi.
Ératosthène avait constaté (ou on lui avait dit) qu’au solstice d’été, à Syène, le Soleil se reflétait parfaitement au fond d’un puits vertical. Il savait également qu’au même moment, à Alexandrie, on pouvait apercevoir une petite ombre au fond d’un puits, car la ville était plus au nord du tropique.
Le savant a l’idée de génie de calculer l’angle que fait cette ombre sur le sol le jour du solstice d’été à Alexandrie. Il y plante donc un bâton, qui était en fait un gnomon, soit un piquet utilisé à l’époque pour les cadrans solaires.
Il part évidemment du principe que la Terre est ronde, ce qu’avaient déjà attesté les savants grecs longtemps auparavant, et que le Soleil est très éloigné, ce qui fait en sorte que ses rayons vont sembler atteindre la planète comme un faisceau parallèle.
Ces prémices sont la clé du calcul qu’Ératosthène veut établir. Par déduction géométrique, l’angle de l’ombre projetée sur le sol d’Alexandrie par le bâton correspond à l’angle que formerait une ligne qui partirait du centre de la Terre vers le bâton avec une autre vers Assouan.
La fraction du cercle représentée par l’angle de l’ombre à Alexandrie est la même que celle entre les deux villes par rapport à la circonférence de la Terre, car celles-ci sont sur la même longitude.
Ératosthène mesure ainsi un angle de 7,2 degrés, exactement un cinquantième de 360 degrés, soit un cercle. Ou un méridien. C’était un véritable coup de chance, car il lui suffit maintenant de multiplier la distance entre Alexandrie et Syène simplement par 50 pour obtenir la mesure du cercle de la planète.
Ératosthène doit maintenant trouver un moyen de mesurer la distance entre les deux villes.
La méthode employée fait l’objet de débats, mais on rapporte le plus souvent qu’Ératosthène a eu recours à des chameaux, réputés pour avoir un pas très régulier.
Certaines sources affirment qu’il s’agissait en fait de dromadaires. D’autres avancent que ce sont plutôt des bématistes qui ont fait le calcul. Les bématistes étaient des arpenteurs très sollicités qui pouvaient mesurer assez précisément les distances en comptant le nombre de pas.

Le savant grec Aristote a fait de grandes choses, mais pour la circonférence de la Terre, il a de loin raté son coup.
Quel que soit le moyen utilisé, on arrive à une distance Syène-Alexandrie de 5000 stades. En multipliant par 50, on arrive à une circonférence terrestre de 250 000 stades. Maintenant, la question qui tue : à quoi correspond un stade dans nos mesures modernes?
Bien que le stade était une unité de mesure répandue dans l’ensemble de l’empire fondé par Alexandre le Grand, sa valeur pouvait varier d’un endroit à l’autre. Pierre-Simon Girard, un ingénieur qui participe à la campagne d’Égypte de Bonaparte, a estimé qu’un stade égyptien – région où Ératosthène a fait ses mesures – mesurait environ 158 mètres.
Faisons maintenant le calcul final : un stade fait 158 mètres qui, multipliés par 250 000 stades (évaluation d’Ératosthène), donnent 39 500 km, soit 575 km de moins que la distance exacte, qui est, rappelons-le, de 40 075 km.
Le savant est presque arrivé pile, même s’il a commis deux erreurs : les deux villes ne sont pas exactement sur le même méridien et la distance entre les deux est de 5 346 stades et non 5 000. Mais par un hasard étonnant, ces deux erreurs se sont annulées.
La marge d’erreur d’Ératosthène était donc de moins de 2 %. Tout ça grâce à un bâton, des chameaux – ou dromadaires (peut-être) –, beaucoup de jugeote et… un peu de chance.

Quand on pense à l’exploration européenne des Grands Lacs, un nom s’impose immédiatement : Étienne Brûlé. On lui attribue l’exploit d’avoir été le premier Blanc à voir jusqu’à quatre des cinq Grands Lacs.
Étienne Brûlé, c’est l’aventurier par excellence. Non seulement est-il le premier Européen à atteindre les Grands Lacs, il sera aussi le premier à vivre parmi les Autochtones, à partager leur mode de vie, à chasser et à pêcher avec eux, et à être coureur des bois. Ce sera les Autochtones toutefois qui mettront fin à sa vie vers 1632 pour des raisons encore inconnues.
Étienne Brûlé est un personnage énigmatique. Les traces de sa vie ne sont révélées que bribe par bribe dans les écrits de certains missionnaires et de Samuel de Champlain. Contrairement à ce que croyaient les historiens, de nouveaux documents découverts dans les archives de sa ville natale, Champigny-sur-Marne, près de Paris, démontrent qu’il n’est pas venu en Nouvelle-France en compagnie de Champlain en 1608, mais peut-être deux ans plus tard.
Champlain ne mentionne son nom qu’en 1618, mais il souligne que Brûlé vit avec les Autochtones depuis huit ans. Or, en 1610, on rapporte qu’un «jeune garçon qui avait déjà hiverné deux ans à Québec» avait demandé à Champlain d’aller vivre avec les Autochtones afin d’apprendre leur langue. Les dates collent. Les âges aussi.
Champlain avait confié le jeune Brûlé au chef algonquin Iroquet. Brûlé y reste un an, revient à Québec raconter ses aventures à Champlain et repart chez les Hurons. Les sources sont un peu nébuleuses, mais on croit que c’est lors de ce deuxième séjour, en 1611, qu’il se rend jusqu’à la baie Georgienne, qui fait partie du lac Huron.

Situé à l’extrémité nord-ouest du lac Supérieur, Fort William était l’un des points de départ pour se rendre dans l’Ouest canadien.
Champlain sur les traces de Brûlé
En 1615, Champlain part en expédition chez les Hurons en suivant le même parcours que Brûlé qui l’accompagne d’ailleurs probablement. Avec une dizaine d’Autochtones, le groupe contourne Montréal par le nord, emprunte la rivière des Outaouais, puis celle de Mattawa jusqu’au lac Nippising, suit la rivière des Français pour aboutir à la baie Georgienne.
Étienne Brûlé se joint ensuite à une autre campagne qui le mène chez les Andastes, alliés des Hurons, qui vivent au sud du territoire occupé par les nations iroquoises. Cela l’amène à traverser le lac Ontario. Il devient ainsi le premier Européen à voir ce grand lac également.
Dans les années 1620, d’autres expéditions lui font découvrir le lac Supérieur, puis le lac Érié. Seul le lac Michigan manquera à son arc; c’est Jean Nicolet qui sera le premier Européen à l’atteindre, en 1669.
Point névralgique pour la traite des fourrures
C’est le commerce des fourrures qui pousse principalement les Français à s’aventurer dans la région des Grands Lacs et qui mènera la population de la vallée du Saint-Laurent à s’étendre vers l’ouest.
Dès le début des années 1620, la traite des fourrures s’organise dans la région des Grands Lacs, d’abord avec les Hurons. Des postes de traite sont érigés dans des endroits stratégiques, le plus éloigné étant situé à l’embouchure de la rivière Kaministiquia, à l’extrémité nord-ouest du lac Supérieur.
Français et ensuite Britanniques établiront tour à tour des postes à cet endroit, qui deviendra une ville connue sous le nom de Fort William et qui, plus tard, fusionnera avec la ville voisine de Port Arthur pour créer la ville actuelle de Thunder Bay.

Carte très détaillée des Grands Lacs dessinée en 1755.
Un couloir économique sans pareil
Mais les Grands Lacs ne seront pas seulement un lieu d’établissements et d’échanges. Ils feront partie d’un système de navigation majeur pour le Canada et les États-Unis qui reliera l’océan Atlantique et le fleuve Saint-Laurent à l’extrême ouest du lac Supérieur et au sud, à Chicago, via le lac Michigan.
Le trajet est parsemé d’obstacles. Le premier à franchir est les rapides de Lachine, le long de la rive sud de Montréal. Un canal de contournement, le canal Lachine, sera terminé en 1825.

Le canal Welland, ouvert en 1829, permet aux navires de naviguer entre les lacs Ontario et Érié.
La prochaine étape est l’ouverture, en 1829, du canal Welland, entre les lacs Ontario et Érié, à l’ouest de la rivière et des chutes Niagara. Au cours du même siècle, une série d’autres canaux et d’écluses seront construits pour améliorer la navigation.
L’idée d’une véritable voie maritime fait l’objet de plus en plus de discussions. Mais il faut du temps avant que le rêve ne devienne réalité. Les travaux ne débutent qu’en 1954, retardés par les deux guerres mondiales et les pressions des entreprises ferroviaires américaines.
La Voie maritime du Saint-Laurent est inaugurée en 1959. Le moment est historique : le président américain Dwight Eisenhower et la reine Élisabeth II sont sur place pour inaugurer l’infrastructure.
L’activité économique issue du transport des marchandises acheminées sur la Voie maritime du Saint-Laurent et les Grands Lacs atteignait en 2018 environ 70 milliards de dollars.
On estime aujourd’hui à 6 000 milliards de dollars la production économique des provinces et États américains qui entourent le réseau des Grands Lacs. Si cette région était un pays en soi, elle serait la troisième économie du monde.

L’élévation au-dessus du niveau de la mer est la plus grande dans le lac Supérieur et diminue constamment jusqu’à l’océan Atlantique, d’où le besoin de nombreuses écluses pour assurer la navigation.
Menacés de toutes parts
Inévitablement, la croissance démographique et l’augmentation de l’activité économique allaient avoir des conséquences sur la santé des Grands Lacs. Les changements climatiques ont ajouté une – et même plusieurs – couche aux menaces qui planent sur cet écosystème unique.
De 1970 à 2020, le nombre d’habitants de la région a augmenté de 35 %; le bassin des cinq Grands Lacs fournit de l’eau potable à environ 28 millions de personnes au Canada et aux États-Unis.
À lire aussi : La série «Les Grands Lacs : bilan de santé»
Des études ont montré que le lac Supérieur est l’un des lacs qui se réchauffent le plus rapidement dans le monde. Sa couverture de glace ne cesse de diminuer année après année. L’augmentation des pluies torrentielles y a multiplié la quantité de nutriments qui, jumelés au réchauffement, ont favorisé l’apparition d’algues bleues nuisibles.
Dans le lac Huron, la biodiversité est sous attaque. Seulement une fraction de la biomasse présente au moment de l’arrivée des premiers Européens a survécu.
De son côté, le lac Érié est envahi par les nutriments néfastes comme l’azote et le phosphore. On considère que ce lac est «malade» et que son état est «médiocre». Les deux autres grands lacs se portent mieux.
La bonne nouvelle, c’est que des efforts colossaux sont en marche pour mitiger les dommages accumulés et, si possible, renverser la vapeur. Mais avec le réchauffement de la planète qui ne donne aucun signe de répit, la lutte ressemble de plus en plus à celle de David contre Goliath.
Décidant d’entrer en contact avec ce dernier au club où il séjourne, Bond le bat à une partie de poker, empochant son Aston Martin DB5, avant de séduire sa femme, Solange, pour obtenir plus d’informations sur le contractant gouvernemental.
Tiré du synopsis de Casino Royale, 2006
Encore une fois, le Rétroviseur doit plonger jusqu’à l’époque des Romains pour éclairer le présent. On connait l’expertise de cette civilisation pour la construction de routes. La Voie Appienne (Vi Appia) en est l’exemple le plus connu.
Il semble que les légions romaines, lorsqu’elles parcouraient l’empire, marchaient à gauche sur les routes. Cela permettait aux soldats, pour la plupart droitiers comme la population en général, de pouvoir sortir leur glaive, au besoin.
Et comme l’Empire romain s’est étendu et étendu et étendu et a duré plusieurs siècles, la tradition s’est comme perpétuée. Une même logique pratique s’est installée au Moyen-Âge, en Europe. Conduire les charriots à gauche, rennes dans la main gauche, libérait la main droite au cas où il fallait sortir une arme, ce qui arrivait quand même assez souvent.
Au cours des siècles après le déclin de l’Empire romain, la tendance lourde sur les chemins d’Europe était de conduire à gauche. En 1669, à Londres, l’équivalent d’un arrêté municipal d’aujourd’hui prévoyait qu’un homme soit placé sur le pont de Londres (LE pont de Londres) pour veiller à ce que la circulation se fasse à gauche. Une centaine d’années plus tard, cette mesure sera légiférée.
Les premières contraventions pour conduite en mauvais sens (en l’occurrence, à droite) sont données à Dublin en Irlande, à la fin du XVIIIe siècle. Les fautifs étaient sommés de payer 10 «shillings».
Si l’ordre semblait régner sur les routes de Grande-Bretagne et d’Irlande, ce n’était pas le cas à Paris. Dans les années 1820, un observateur étranger (Edward Planta) rapportait qu’il n’y avait pas de règles de circulation et que les cochers changeaient de voie à qui mieux mieux. Rien n’a changé.

Des soldats romains en marche.
À droite toute avec le Conestoga
Puis arrive le Conestoga. Ce nouveau type de charriot couvert à larges roues fait son apparition au XVIIIe siècle aux États-Unis, nommément en Pennsylvanie. Comme dans toutes les colonies britanniques, on roulait à gauche aux États-Unis. Mais ce charriot va tout changer.

Au XVIIIe siècle, aux États-Unis, un nouveau type de charriot, le Conestoga, sera à l’origine de la conduite à droite au pays.
Servant principalement au transport de marchandises, le Conestoga a la particularité de ne pas avoir de siège pour le cocher. Pour diriger les chevaux qui tiraient le charriot, le cocher montait le cheval le plus près, à gauche, afin de manier les rennes ou le fouet de sa main droite (encore là, la tyrannie des droitiers). Tout naturellement, les chevaux tenaient la droite sur les routes.
Et c’est ainsi que les États-Unis sont passés de la gauche à la droite. Plus tard, Henry Ford consolidera la pratique en plaçant le volant de son modèle T à gauche, afin que les voitures circulent à droite.
En Europe, la France donne le pas
Comme on l’a vu, la circulation à gauche sur les routes était largement répandue, que ce soit par les habitudes des Romains ou pour toute autre raison qui demeurera inconnue jusqu’à la fin des temps.
Un «virage» important survient à la fin du XVIIIe siècle, soit à la même époque qu’aux États-Unis, mais il n’a rien à voir avec le charriot-sans-siège-pour-le-cocher.

Vers 1930, on roulait toujours à gauche à Vienne, en Autriche.
En fait, ce n’est pas tout à fait clair. Certains affirment qu’en France, les nobles circulaient à gauche et les pauvres, à droite (ce qui n’a pas beaucoup de sens, à moins que les routes fussent en sens unique, mais bon). Les meneurs de la Révolution, Robespierre en tête, voulant éliminer les distinctions de classe, auraient envoyé tout le monde à droite. Pourquoi la droite alors que le reste de l’Europe était à gauche? On ne le dit pas. Pourquoi faire simple quand on peut faire français?
L’autre grande hypothèse avancée a trait au fait que les succès militaires de Napoléon s’expliquaient, entre autres, par sa décision d’attaquer ses ennemis par le flanc droit plutôt que le flanc gauche, comme cela se faisait à l’époque.
En conquérant une bonne partie de l’Europe, Napoléon aurait imposé ce nouveau code de conduite dans plusieurs pays. Plus ou moins convaincant comme hypothèse.
Ô Canada, terre à droite et à gauche
La situation au Canada est un peu plus complexe, compte tenu des héritages français et anglais au pays. Et l’évolution de la pratique est un peu floue.
Au temps de la Nouvelle-France, il semble que l’on conduisait à gauche, comme en France et en Grande-Bretagne. Puis, à un moment imprécis, tout vire à droite. Pourtant, le changement en France s’est fait après la conquête britannique du Canada.
Comme ce qui allait devenir l’Ontario et le Québec faisaient partie d’une même colonie à l’époque, l’Ontario maintient la droite en devenant colonie distincte. Par la suite, les Prairies ont imité l’Ontario. Mais la Colombie-Britannique et les provinces maritimes ont maintenu le côté gauche.

Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, vers 1898. La province se convertira à la conduite à droite en 1922.
Dans le but de s’harmoniser avec le reste du Canada et avec les États-Unis, la conduite côté gauche va disparaitre progressivement : en 1922 en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick, en 1923 en Nouvelle-Écosse et en 1924 à l’Île-du-Prince-Édouard. Terre-Neuve fera de même en 1947, deux ans avant son entrée dans la Confédération.
Quel est le bilan de tout ça? Eh bien, en 1914, il y avait autant de pays qui avaient une circulation routière gauche que de pays à droite, soit 104 dans chacun des deux cas. Mais 70 ans plus tard, 34 des pays qui conduisaient à gauche étaient passés à la droite.
Il y a donc beaucoup plus d’endroits qu’on ne le pense où il faut garder la gauche sur la route, dont certains pays importants en plus du Royaume-Uni et de l’Irlande : l’Inde, l’Indonésie, l’Afrique du Sud, le Japon, l’Australie et, en Europe, Malte et Chypre. Dans les Amériques, le Guyana et plusieurs nations ou territoires insulaires s’ajoutent à cette liste.
Finalement, c’est donc environ le tiers de la population mondiale. Et rien n’indique qu’ils se mettront dans le droit chemin.
Cadien et non cajun, car mettons tout de suite une chose au clair : le mot «cajun» ne devrait pas exister en français. Pour le dire poliment, il s’agit d’un anglicisme. Pour être vrai, c’est une corruption linguistique, une déformation d’une déformation, un illogisme. Bref, c’est pas beau!

L’arrivée des Acadiens en Louisiane, une murale réalisée par Robert Dafford à Saint-Martinville, en Louisiane.
Les Cadiens (ou Cadjins), quand ils parlent français, ne se décrivent jamais comme des «Cajuns». Pourquoi donc?
Lorsque les Acadiens se sont installés en Louisiane dans les années suivant la Déportation, ils ne s’identifiaient pas à l’oral comme des «Acadiens», mais comme des «Cadjins», soit un diminutif ou une variante d’«Acadiens» (d’ailleurs prononcé autrefois, et encore de nos jours par certains, comme Aca-djins).
Les anglophones ont écrit le gentilé comme ils l’entendaient, d’où le mot «Cajun», prononcé «ké-djeune». Des francophones de l’extérieur de la Louisiane ont par la suite «francisé» le mot anglais «Cajun» en conservant la même graphie, mais en lui donnant la prononciation française «ka-jeun».
Voilà pourquoi «Cajun», en français, est un non-sens et devrait être extirpé des dictionnaires et de nos bouches à la faveur de «Cadiens».
Voilà pour ça.
Dérangés, mais non déportés
Avant d’aller plus loin, déboulonnons un mythe qui a la vie dure, très dure même, voulant que les Acadiens aient été déportés en Louisiane. Faux et archifaux!
Les Acadiens ont été déportés dans les colonies américaines du Massachusetts à la Géorgie, en Angleterre et en France. Aucun n’a été déporté en Louisiane. Nada.
Les Acadiens sont arrivés en Louisiane de leur propre chef.

Détail d’une fresque de Robert Dafford représentant des Acadiens à Nantes, d’où des centaines d’Acadiens sont partis en 1785 pour la Louisiane.
Le premier groupe y met les pieds en février 1764. Il s’agit de quelques familles déportées en Géorgie qui auraient été attirées en Louisiane par un certain Joseph de Goutin de Ville, né à Port-Royal en Acadie d’une mère acadienne, mais résident de la Nouvelle-Orléans depuis 1747. Il a un lien de parenté (c’est le cousin de son père) avec l’un des membres du groupe.
Une autre vague arrive quelques mois plus tard en Louisiane. Elle compte environ 600 Acadiens, qui étaient détenus en Nouvelle-Écosse avec à leur tête les frères Joseph et Alexandre Broussard dit Beausoleil. Les deux frères ont chacun épousé une parente du nommé de Goutin de Ville.
Et puis, en 1785, arrivent en Louisiane quelque 1600 Acadiens qui avaient été déportés en France et qui ont fini par accepter l’invitation des représentants de l’Espagne en France de s’établir au chaud, parmi leurs compatriotes.
C’est sans compter les nombreux Créoles blancs (Français non acadiens) et noirs (esclaves) qui se trouvent également dans la colonie désormais espagnole de la Louisiane.
L’enracinement en Amérique
Les Acadiens s’adaptent remarquablement à leur nouvel environnement. Plusieurs parviennent rapidement à accumuler un cheptel important. Cette relative aisance en amènera certains à atteindre le statut d’élite, ce qui, dans le Sud des États-Unis de l’époque, rime avec esclavagisme.

La statue d’Évangéline trône, un peu à l’écart, dans un parc de Saint-Martinville, en Louisiane.
Ce phénomène fera son apparition dès la fin des années 1770; en 1785, 10 % des fermiers acadiens auraient au moins un esclave. À certains endroits, leur proportion aurait frisé les 40 %*.
La distance et le peu de communication font en sorte que les Cadiens et leurs frères et sœurs de ce qu’ils appellent «l’Acadie du Nord» (les provinces maritimes) n’auront que très peu de contacts pendant longtemps.
Un phénomène qui survient au milieu du XIXe siècle leur donnera cependant une cause commune : Évangéline.
Le personnage inventé par le poète américain Henry Wadsworth Longfellow dans son livre Evangeline : A Tale of Acadie, séparé de son Gabriel à Grand-Pré au moment de leur déportation, sera un grand succès littéraire et fera connaitre la saga du Grand Dérangement à l’échelle de l’Amérique du Nord et même ailleurs.
À lire aussi : La statue emblématique d’Évangéline au site historique de Grand-Pré a 100 ans
Au début du XXe siècle, les Cadiens vont «s’approprier» l’héroïne mythique qu’est Évangéline avec la publication de The True Story of Evangeline en 1907 par le juge louisianais Félix Voorhies, d’origine cadienne par sa mère, Cidalise Mouton.

Le drapeau des Cadiens de la Louisiane compte des références aux origines françaises (les lis), aux origines acadiennes et à la participation à la Révolution américaine (l’étoile), et à l’Espagne (la tour), pays qui a gouverné la colonie pendant 40 ans.
Selon Voorhies, la «vraie» histoire d’Évangéline – inspirée par des histoires familiales – est celle d’Emmeline Labiche et de Louis Arceneaux, qui ont véritablement existé.
Comme Évangéline et Gabriel, les fiancés sont séparés au moment de leur expulsion. Mais alors qu’Évangéline est réunie avec son amour sur son lit de mort à Philadelphie, Emmeline retrouve Louis sous un chêne, à Saint-Martinville, au bord du bayou Teche, lieu symbolique d’établissement acadien en Louisiane.
L’histoire finit mal : Louis s’est marié et a refait sa vie. Emmeline pleure la sienne et meurt, après avoir perdu la raison.
Un retour aux sources
Cet élan de fierté identitaire frappe cependant un mur au tournant de la Première Guerre mondiale, alors que la Louisiane proscrit l’enseignement du français dans les écoles. On interdit même aux élèves de parler français entre eux. Ceux qui transgressent cette règle sont soumis à des punitions corporelles.
En conséquence, ces jeunes Cadiens, une fois devenus adultes, auront un réflexe d’autoprotection : ils cessent de parler français à leurs enfants. Cette répression linguistique perdure jusque dans les années 1960, provoquant des ravages pour le français en Louisiane.

Le fameux chêne à Saint-Martinville, en Louisiane, où Emmeline Labiche et Louis Arceneaux, les «vrais» Évangéline et Gabriel, se seraient retrouvés après avoir été séparés pendant la Déportation.
Le vent tourne en 1968 avec la création du Conseil pour le développement du français en Louisiane (CODOFIL), un organisme gouvernemental. Après avoir tout fait pour faire disparaitre le français, l’État veut maintenant le rétablir et le promouvoir.
La refrancisation des jeunes se fait par le biais d’écoles d’immersion. Le rattrapage à faire est gigantesque et le succès n’est pas garanti. Mais de plus en plus de jeunes Cadiens et Créoles renouent avec la langue de leurs grands-parents et arrière-grands-parents.
Les Cadiens n’ont pas dit leur dernier mot. À l’instar des francophones à l’extérieur du Québec, on les a souvent laissés pour morts. Mais le corps bouge toujours.
Laissons le dernier mort à Zachary Richard qui, avec son âme de poète, a réussi, lors du premier Congrès mondial acadien en 1994, à lancer ce cri du cœur : «On est tombé de la falaise. Mais on n’a pas encore touché terre.»
À lire aussi : Le Congrès mondial acadien a bousculé la vie de Zachary Richard
* Voir Carl A. Brasseaux, The Founding of New Acadia, Bâton -Rouge, Louisiana State University Press, 1987.

Joseph Plamondon, fondateur du village albertain qui porte son nom, vers 1900.
L’histoire de Plamondonville – qui deviendra «Plamondon» – débute dans le village de Saint-Norbert, au nord-est de Joliette, au Québec. En 1868, la famille Plamondon quitte tout pour s’exiler dans l’État du Michigan, à Provemont plus exactement.
Les Plamondon font partie d’une grande mouvance qui a marqué l’est du Canada à cette époque. De 1850 à 1940, on estime qu’entre 900 000 à 1 000 000 de Canadiens français et d’Acadiens ont quitté le pays en quête d’un meilleur avenir économique aux États-Unis.
Si la très grande majorité avait comme destination la Nouvelle-Angleterre et ses filatures de coton, d’autres se sont dirigés vers le Midwest américain, où vivaient 150 000 Canadiens français en 1874 selon un décompte effectué par l’abbé Gendron. Les Plamondon sont du nombre.
Joseph «Joe» Plamondon est le onzième enfant de la famille. Devenu adulte, il fait l’acquisition de 140 acres de terre près de Provemont. Avec une Canadienne française d’une famille également exilée, Mathilda Gauthier, il fonde une famille.
Joseph n’a pas de scolarité, mais il a beaucoup de talents. C’est un conteur, un chanteur, un musicien. Il sait parler aussi. Et il sait tisser des liens avec ses compatriotes. Joseph prend sa place dans la communauté. Il tient également beaucoup à sa langue maternelle. Joseph n’accepte pas que sa famille parle anglais à la maison.

Bien qu’ils vivaient au Michigan. Joseph Plamondon et Mathilda Gauthier se sont mariés à Montréal.
L’attrait de l’Ouest
Qu’est-ce qui a poussé la famille Plamondon – et bien d’autres – à quitter ses terres du Michigan et d’ailleurs dans le Midwest pour aller s’installer dans la jeune province de l’Alberta?
Ce ne sont pas des gestes isolés ou aléatoires. Le tout fait partie d’une vaste campagne orchestrée par le gouvernement canadien, avec l’appui du clergé catholique, pour «peupler» cette partie du pays, qui était pourtant déjà habitée par de nombreux Autochtones et Métis, rappelons-le.
Les premières vagues d’immigrants dans les années 1890 sont surtout anglophones, mais le clergé catholique et certains gens d’affaires canadiens-français ont une vision d’un Ouest canadien où les francophones auraient aussi leur place.
Le rôle des oblats
De nombreux «prêtres-colonisateurs» vont s’affairer à convaincre des Canadiens français installés aux États-Unis de revenir au pays, mais dans l’Ouest.
Ce chant des sirènes atteint le Michigan et la petite ville de Provemont. Même si la vie est bonne pour les Plamondon, la terre commence à être étroite pour les nombreux enfants et les possibilités d’expansion sont limitées.

La famille Plamondon et quelques autres à leur départ de Morinville pour Lac la Biche, près d’où sera fondé Plamondonville.
L’un des fils de Joseph, Isidore[1], se rend en Alberta pour travailler dans des fermes. Il revient à la maison rempli de louanges pour cette contrée où les terres sont bon marché et où la sauvegarde du français pourrait être plus propice qu’aux États-Unis.
La décision est donc prise et, en 1908, les membres du clan Plamondon transportent leur vie dans le nord-est de l’Alberta, sauf une fille, Isabel, qui est mariée et décide de rester aux États-Unis.
Les Plamondon ne sont pas seuls. Quelques autres familles francophones de Provemont, Gauthier, St. Jean, Cagle et d’autres localités du Midwest font le même choix.
Après un long périple de 2800 kilomètres à travers les Prairies, le groupe gagne Morinville, en Alberta, puis monte jusqu’à Lac la Biche. Près de là, la famille Plamondon et d’autres familles choisissent de s’installer sur des terres à prendre. Ce sera Plamondonville.

La famille Plamondon en 1912 : Joseph et Mathilda sont assis devant, entourés de leurs enfants et certains petits-enfants.
Dellamen Plamondon, pionnière
L’une des filles Plamondon, Dellamen, fréquente bientôt l’école des Filles de Jésus à proximité. Mais le trajet est dangereux en hiver et Joseph craint pour la sécurité des enfants. Une petite école prend donc forme à Plamondonville. Mais il n’y a pas d’enseignante. Qu’à cela ne tienne, Dellamen s’en chargera. Elle a… 12 ans.
La jeune fille puise dans l’expérience qu’elle a eue chez les sœurs et parvient, en se fiant beaucoup à son instinct, à assurer l’enseignement dans son village.

The Stoping House, l’auberge gérée par Dellamen Plamondon (debout, avec des membres de sa famille) et son mari Albert Chevigny.
Ce ne sera pas seulement la carrière qui sera précoce chez Dellamen. L’année suivante, une nouvelle famille arrive à Plamondonville : les Chevigny. Un couple et leur fils de 30 ans, Albert. Celui-ci jette son dévolu sur l’enseignante qu’il croit âgée de 20 ans. Rien n’arrête les amoureux; ils se marient un an plus tard, le jour du 14e anniversaire de Dellamen.
Puisqu’elle n’est plus célibataire, Dellamen doit renoncer à l’enseignement, comme le veut la tradition de l’époque. Une autre occupation l’attend, soit celle de gérer un hôtel, The Stopping Place, que le couple Chevigny vient d’ouvrir.
Albert prend également sous sa responsabilité le magasin général du village. Le couple est prospère. Dellamen devient «femme à tout faire» : fermière, sagefemme, assistante au bureau de poste (fondé par son père), sans oublier mère de famille.
Tous les espoirs sont permis pour l’épanouissement d’une communauté francophone dans la mer d’anglophones qu’est l’Alberta.

Le village de Plamondon, en 1921, soit une douzaine d’années après sa fondation.
Mais l’opposition aux écoles françaises séparées prend de l’ampleur au début du siècle. Le gouvernement albertain restreint l’enseignement du français, ce qui ne peut mener qu’à l’assimilation.
Dès la génération suivante, les effets se font sentir. Même les enfants de Dellamen perdent la bataille.
Mais d’autres ont trouvé la force de résister. À preuve : la chanteuse Crystal Plamondon, arrière-petite-fille de Joseph, et Léo Piquette, enfant du village, qui a été député de l’Assemblée législative de l’Alberta, où il est passé à l’histoire pour avoir osé s’exprimer en français en Chambre.
L’une des arrière-petites-filles de Dellamen, Krysti MacDonald, profitera du retour des écoles françaises, grâce à la Constitution de 1982, pour se réapproprier la langue de ses ancêtres. Elle découvre les lettres en français écrites par son aïeule à sa sœur demeurée au Michigan.
Krysti a eu la chance de connaitre son arrière-grand-mère Dellamen avant que celle-ci ne meure en 1994, à l’âge de 97 ans. Et de lui parler en français. Elle a étudié à la Faculté Saint-Jean à l’Université de l’Alberta. Elle enseigne aujourd’hui dans les écoles francophones d’Edmonton. Une revanche sur l’Histoire.

Premier hôtel de Plamondon, construit par le fondateur Joseph Plamondon.
[1] Voir Valérie Lapointe-Gagnon avec la collaboration de Krysti MacDonald, «Plamondonville», dans De racines et de mots, Persistances des langues en Amérique du Nord, Québec, Les éditions du Septentrion, 2021.
Au début de février, une tempête de neige qualifiée «d’historique» a frappé le centre et l’est de la Nouvelle-Écosse. Le Cap-Breton y a particulièrement gouté avec les quelque 150 cm de neige qui ont enseveli Sydney. L’état d’urgence décrété a duré cinq jours.

En mars 1971, la «tempête du siècle» s’abat sur l’est du Canada, particulièrement au Québec, comme ici à Laval, au nord de Montréal.
Historique, peut-être, mais était-ce la tempête du siècle? Comme il reste encore 76 années au siècle présent, il serait de mise de se garder une petite gêne. On verra bien. Mais si vous ajoutez 76 à votre âge, peut-être qu’en fait, on ne verra pas.
Et encore faut-il définir l’espace-temps de «tempête du siècle». Tempête du siècle pour la région? La province? Le pays? La Voie lactée? Parions que la Voie lactée en a vu d’autres. Ce n’est peut-être pas pour rien qu’elle est blanche. Enfin.
Qu’est-ce qu’un blizzard?
Avant d’aller plus loin, entendons-nous sur la définition du mot «blizzard». On ne parle pas ici d’un dessert glacé populaire servi dans un gobelet qu’on peut retourner à l’envers sans que la cuillère qui y a été insérée tombe.
À l’instar de beaucoup de choses dans ce bas monde, la réponse n’est pas unilatérale et varie selon à qui l’on pose la question.

La tempête de 2017 a secoué les colonnes du temps de la «tempête du siècle de 1971».
Pour Environnement Canada, un blizzard est une tempête de neige qui dure au moins quatre heures avec des rafales de 40 km/h et une visibilité réduite de moins d’un kilomètre. La température doit également être sous le point de congélation… ce qui habituellement est nécessaire pour la formation de la neige.
Wikipédia, qui cite également Environnement Canada, souligne qu’il faut seulement un minimum de trois heures de mauvais temps pour qu’une tempête atteigne le stade de blizzard, mais les rafales doivent être plus fortes, soit au moins 50 km/h, et la visibilité réduite de 400 mètres. D’autres sources ont, encore, d’autres réponses. Entendez-vous s.v.p.
Aux États-Unis, le National Weather Service place la barre des rafales plus haute, à 60 km/h pour étamper «blizzard» sur une tempête. À noter qu’aucune de ces sommités météorologiques ne mentionne une quantité minimale de neige. Une définition de blizzard, bizarre…
Bon. On n’en fera pas un blizzard dans un verre d’eau. Ou de cristal de glace.
Le palmarès des blizzards : un terrain glissant
Du point de vue des précipitations seulement, les 150 cm du Cap-Breton au début février mettent la barre haute. Mais…
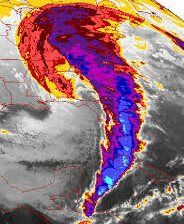
L’étendue de la «tempête du siècle» de 1993 était impressionnante.
Le «grand blizzard de 1888» – c’est son nom – est souvent mentionné dans la liste des tempêtes de neige mémorables en Amérique du Nord. L’étendue du blizzard va du Maryland, près de Washington, jusqu’au Maine et dans l’est du Canada.
Les quantités de neige rapportées diffèrent selon les sources, de près de 60 cm à New York jusqu’à 150 cm au Connecticut.
Pas mal. Disons qu’on pourrait le considérer comme la «tempête du siècle» du XIXe siècle.
Mais qu’en est-il du XXe siècle? La tempête qui est le plus souvent étiquetée comme étant celle «du siècle» est celle de l’hiver 1971. Entre le 3 et le 5 mars, une partie du continent nord-américain, y compris le Québec et les provinces de l’Atlantique, a été balayée par ce blizzard.
Montréal reçoit presque 60 cm de neige, ce qui est loin des 150 cm de cette année au Cap-Breton, mais ce sont les vents de plus de 100 km/h qui vont paralyser la région. Certaines personnes doivent dormir à leur lieu de travail, ce qu’on pourrait qualifier de l’inverse du travail à domicile.
Quatre ans plus tôt, en avril 1967, on a rapporté 175 cm de neige dans le sud de l’Alberta. Mais en y regardant de plus près, on s’aperçoit qu’il s’agissait en fait de deux tempêtes au cours du même mois. Bel essai, mais ça ne compte pas.
Deux tempêtes du siècle?
Un autre blizzard vient rivaliser avec celui de 1971, soit celui du 12 au 15 mars 1993. Les Américains vont non seulement lui donner le nom de «tempête du siècle», mais aussi de «superstorm» [supertempête] ou «the great blizzard of 1993» [le grand blizzard de 1993].

Brooklyn enseveli sous la neige après le blizzard de 1888. Près de 60 cm de neige sont tombés sur New York.
Ce mégasystème couvrait un immense territoire allant du Honduras (qui, en passant, n’a pas reçu de neige) jusqu’à l’est du Canada. C’était à la fois un ouragan en Floride et un blizzard dans le nord. Là on jase.
Dans la catégorie «mention spéciale», on peut souligner le blizzard de 1978 qui a laissé 70 cm sur Boston (bof) ou celui de 1939 qui a laissé 131,6 cm (qui a compté?) sur la ville de Québec, mais comme pour le cas du sud de l’Alberta, c’était deux tempêtes distanciées de plusieurs jours. Disqualifié.
Les Américains, qui aiment bien les superlatifs, ont donné à de grosses tempêtes les noms de «Snowzilla» (2016) et même de «Snowmageddon» (2010).
Évidemment, tout le monde veut pouvoir dire qu’il a vécu la «plusse-pire-grosse-tempête du siècle».
Le 14 et 15 mars 2017, le blizzard qui a frappé le sud du Québec a été couronné de «nouvelle tempête du siècle» (quelle était l’ancienne?). On a mesuré 119 cm de neige sur deux jours. On a envie d’y croire.
Mais le gagnant est…
Curieusement, les annales «blizzardiennes» omettent une autre «tempête du siècle» qui pourrait bien ravir le titre : Moncton, 1992. (Note de la rédaction : l’auteur nie tout biais même s’il réside dans cette ville depuis plus de 30 ans et qu’il a vécu ladite tempête.)

En trois jours à l’hiver 1992, Moncton, au Nouveau-Brunswick, a reçu 162 cm de neige. Les raquettes étaient de mise.
Fin janvier, il n’y a presque pas de neige au sol, ce qui est inhabituel. Encore plus inhabituel, il va neiger pendant trois jours, du 31 janvier au 2 février.
Des conditions de blizzard pendant 28 heures avec des rafales à plus de 110 km/h, des bancs de neige de plus de trois mètres cachant les façades des commerces. Des résidents doivent creuser des tunnels pour sortir de chez eux. Et un époustouflant total de 162 cm de neige!
Pour toutes ces raisons, le blizzard qui a frappé Moncton en 1992 peut être qualifié de «plusse-pire-grosse tempête du siècle ever». Le sujet est clos.
Cette blague de la demi-heure de Terre-Neuve trouve son origine dans le fait que les émissions nationales du réseau anglais de Radio-Canada (CBC) débutent partout à la même heure au pays, sauf à Terre-Neuve, où c’est «une demi-heure plus tard».
C’est une taquinerie dont les francophones de Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick ont longtemps été l’objet lorsque le réseau français de Radio-Canada annonçait l’heure de ses émissions nationales en ajoutant «une heure plus tard dans les Maritimes».
Et cette précision sous-entendait que cette même émission, qui était «une heure plus tard» dans les Maritimes, était encore une autre demi-heure «plus tard» à Terre-Neuve.

La capitale de Terre-Neuve-et-Labrador, Saint-Jean, est située sur le méridien séparant les fuseaux horaires UTC-4 et UTC-3.
Vous me suivez?
Sinon, ce n’est pas grave. Là n’est pas notre propos principal. Voici la vraie question : pourquoi Terre-Neuve évolue-t-elle dans le temps avec une demi-heure de différence par rapport aux fuseaux horaires voisins, et non une heure comme (presque) tout le monde?
Avant d’aller plus loin – et pour ajouter encore plus de confusion –, précisons qu’une région du sud-est du Labrador vit à la même heure que l’ile de Terre-Neuve, mais que tout le reste de la partie continentale de la province est dans le même fuseau horaire que les provinces maritimes (et les Iles de la Madeleine), soit l’heure de l’Atlantique.
On verra tout à l’heure que ça se complique encore plus. Reposons la question : pourquoi une demi-heure de plus?
Eh oui, pourquoi?
Parce que faire simple n’est pas terre-neuvien.

Le Canada compte cinq fuseaux horaires différents.
Plus sérieusement, Terre-Neuve-et-Labrador aurait pu partager la même heure et ne pas être «décalée» de 30 minutes. Géographiquement, la province se trouve dans le même fuseau que les Maritimes, «UTC-4» (heure normale), c’est-à-dire quatre heures de moins que l’heure du méridien 0, soit celui de Greenwich en Angleterre.
La référence qui s’appelait autrefois «temps moyen de Greenwich» (GMT) est maintenant désignée comme le «temps universel coordonné» ou UTC.
Il faut se rappeler que pendant très longtemps, en Europe comme en Amérique du Nord, chaque ville avait une heure totalement différente de ses voisines parce qu’elles utilisaient l’heure solaire..
La pratique est devenue très problématique avec l’arrivée du chemin de fer puisqu’elle pouvait provoquer des collisions entre les trains puisqu’il n’y avait pas encore de référence universelle pour l’heure.
En Grande-Bretagne, les compagnies ferroviaires parviennent à faire adopter une heure commune, celle de Londres, sur tout le territoire.

Si la planète est divisée en 24 fuseaux horaires équivalents à une heure chacune, on le doit beaucoup à l’ingénieur écossais Sandford Fleming, qui a vécu toute sa vie adulte au Canada.
Au Canada et aux États-Unis, l’affaire est plus complexe en raison de l’étendue des deux pays. Là également, les compagnies de chemin de fer vont jouer un rôle déterminant.
Entre en jeu un ingénieur écossais : Sandford Fleming. Pendant plusieurs décennies, Fleming travaillera au sein de différentes compagnies ferroviaires canadiennes en tant qu’ingénieur et arpenteur, jusqu’à devenir ingénieur en chef du Canadien Pacifique.
Il jouera un grand rôle dans l’organisation d’une conférence internationale à Washington, en 1884, qui adoptera un temps universel et la division du monde en 24 fuseaux horaires avec comme référence le méridien de Greenwich.
À lire aussi : Méridien de Greenwich : la bataille pour le point zéro
Terre-Neuve choisit son heure
Les pays définissent alors tour à tour leurs fuseaux horaires.
Or, Terre-Neuve ne fait pas encore partie du Canada à l’époque et est un dominion indépendant. Elle va donc choisir elle-même son heure standard, en 1935. C’est la Commission de gouvernement de Terre-Neuve qui s’en charge.
Comme un peu partout ailleurs, l’ile compte plusieurs différentes heures en usage. Terre-Neuve – le Labrador compris – se trouve, comme mentionné plus haut, dans le fuseau horaire UTC-4.

Les délégués de 25 pays à la conférence internationale de Washington, en 1884, se sont entendus pour uniformiser le monde en 24 fuseaux horaires, avec comme référence le méridien de Greenwich.
Sauf que la capitale, Saint-Jean, où vit la grande majorité de la population, est située à l’extrême est de ce fuseau, presque à cheval sur la ligne démarquant les zones UTC-4 et UTC-3.
Quand on dit presque, c’est vraiment presque. Plus précisément, la ville de Saint-Jean est à 3 heures 33 minutes et 33 secondes de moins que l’heure du méridien 0. C’est donc pour cette raison que la future dernière province canadienne a adopté une heure officielle de 30 minutes de plus que UTC-4 et 30 minutes de moins que UTC-5.
Et le Labrador? Cette région étant située plus à l’ouest que l’ile de Terre-Neuve, elle observe le même fuseau horaire que les provinces maritimes, «l’heure normale de l’Atlantique» (HNA). Sauf… comme on l’a dit, une petite région du sud-est qui, elle, est synchronisée avec l’heure de l’ile de Terre-Neuve.
De multiples espaces-temps
Pour ajouter un peu de piquant à tout ça, il faut rappeler que l’archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon, près de la côte sud de Terre-Neuve, est quant à lui dans le fuseau UTC-3, soit une demi-heure de plus que l’ile de Terre-Neuve, une heure de plus que les provinces maritimes et la grande partie du Labrador.
L’entente du 18 janvier est historique, non seulement pour le Nunavut, mais aussi pour le Canada. Il s’agit du plus important transfert de terres depuis la création du pays. Deux-millions de kilomètres carrés de terres publiques qui étaient administrées jusqu’ici par Ottawa seront dorénavant gérées par le Nunavut.

Le 18 janvier dernier, signature de l’entente historique de transfert de terres publiques et de responsabilités du gouvernement canadien vers le Nunavut.
Pour ce territoire, c’est l’aboutissement d’une longue épopée. Cette terre habitée depuis des milliers d’années faisait partie des Territoires du Nord-Ouest, une région contrôlée par la Compagnie de la Baie d’Hudson, qui l’a cédée au Canada en 1870, peu après la Confédération.
L’idée de diviser les Territoires du Nord-Ouest en deux remonte à la fin des années 1950. Une première tentative fait son chemin à la Chambre des Communes, en 1963; le projet de loi meurt cependant au feuilleton lors du déclenchement des élections.
Les Inuits, qui forment plus de 80 % de la population de l’est des Territoires du Nord-Ouest, prennent le relai. En avril 1982, un plébiscite sur la division des Territoires du Nord-Ouest recueille 56,5 % d’appui. Dans l’est, à majorité inuite, le oui l’emporte à 80 %.
Il faudra cependant user de patience. Les négociations portant sur la frontière commune s’étirent. Ce n’est que 10 ans plus tard, en 1992, qu’une entente intervient. Un autre référendum a lieu. Cette fois, la proposition récolte près de 85 % des appuis.
On y est presque. Bien que deux lois soient adoptées en 1993 sur la création du Nunavut (qui signifie «notre terre» en inuktitut), ce n’est que le 1er avril 1999 que le nouveau territoire voit formellement le jour avec un premier gouvernement au Canada contrôlé par des Autochtones.
Qui sont les Inuits?

Le Nunavut arrive au cinquième rang dans le monde pour l’étendue de sa division administrative. Le territoire comprend la majorité des iles de l’Arctique canadien, dont l’ile de Baffin (extrême est) et l’ile d’Ellesmere (extrême nord), à proximité du Groenland.
On pourrait penser que les Inuits sont les premiers humains à habiter ces contrées nordiques. Ce n’est pas le cas.
Les ancêtres du peuple inuit («peuple», en inuktitut) auraient atteint l’Alaska vers l’an 1000 apr. J.-C. en traversant la Béringie, ce pont terrestre qui existait entre la Sibérie et le nord-ouest de l’Amérique du Nord, avant d’être submergé et de devenir le détroit de Béring. En moins de trois siècles, ces ancêtres parcourent l’extrême nord du continent nord-américain jusqu’au Groenland.
On les a nommés «gens de Thulé», du nom d’un comptoir danois du Groenland où les archéologues les ont identifiés pour la première fois.
Thulé était le nom donné par le navigateur grec Phytéas, de Marseille, à un archipel situé au nord de l’Écosse qu’il aurait visité, ou du moins dont il aurait entendu parler lors de son voyage dans la région. Thulé devient ensuite un endroit mythique, le point le plus au nord du monde connu.

Peuplements de divers groupes inuits et préinuits dans l’est de l’Arctique canadien et le Groenland.
Résumons : les experts ont donné aux premiers Inuits, venus d’Asie, un nom mythique inventé par un Grec vivant dans le sud de la France actuelle pour nommer une hypothétique ile au nord de la Grande-Bretagne, et repris par les Danois pour nommer un de leurs comptoirs au Groenland. C’est cela, oui.
Toujours est-il que, lorsque les premiers Inuits/gens de Thulé s’aventurent à l’est de l’Alaska et dans les iles de l’Arctique, ils rencontrent un autre peuple arrivé avant eux : les Dorsétiens.
Inuits, gens de Thulé, Dorsétiens, Prédorsétiens
Les Dorsétiens, venus aussi d’Asie, étaient arrivés en Amérique vers 500 av. J.-C., mais ils avaient été précédés par un autre groupe apparenté, mais culturellement distinct appelé Prédorsétiens.

Chasseur inuit avec son harpon, vers 1908-1920.
Les Prédorsétiens disparaissent avec l’arrivée des Dorsétiens. Ces derniers subsistent dans la région de l’extrême nord de l’Amérique du Nord jusqu’à ce qu’ils disparaissent, soudainement, lors de la période correspondant à la venue des premiers Inuits.
Que s’est-il passé? Le débat est ouvert. Les hypothèses vont de l’assimilation au génocide en passant par la transmission de maladies apportées par les nouveaux arrivés. Il est aussi possible que les deux peuples se soient tenus à distance et que les Prédorsétiens soient simplement morts de leur belle mort. Bref, on ne sait trop.
Contact avec les Européens
Les premiers Européens à rencontrer les Inuits sont les Vikings qui, après avoir colonisé la côte sud-ouest du Groenland, se déplacent dans les iles les plus à l’est de l’archipel arctique. Ils auraient même eu des contacts avec des Dorsétiens.

Vue de la ville d’Iqaluit, capitale du Nunavut, à l’hiver 2010.
Ce sera ensuite le tour des explorateurs britanniques à atteindre ces régions nordiques à la recherche du «passage du Nord-Ouest». D’autres viendront, de plus en plus souvent, et de plus en plus nombreux, et feront la traite des fourrures.
Plusieurs y laisseront leur peau. Ceux qui connaitront du succès le devront bien souvent aux Inuits qui leur servent de guide, leur montrent à se déplacer, à se vêtir et à survivre à même les ressources locales.
L’arrivée des Européens finira par bouleverser le mode de vie des Inuits. Comme pour les autres Autochtones du Canada, les colonisateurs tenteront de leur inculquer, parfois de force, la culture européenne et de les assimiler linguistiquement en envoyant les enfants dans des pensionnats où ils seront victimes de mauvais traitements physiques et sexuels.
Et les francophones?
Dès le XIXe siècle, des équipages canadiens-français chassent la baleine dans la région du Nunavut actuel. La présence francophone débute vraiment au début du XXe siècle avec l’arrivée des missionnaires oblats.
La formation d’une véritable communauté francophone ne survient que dans les années 1970 lorsque des Québécois viennent à Iqaluit, alors nommé Frobisher Bay, pour travailler dans des bureaux du gouvernement fédéral ou encore pour la compagnie Bell Canada.
C’est de ce noyau que naitra l’Association des francophones de Frobisher Bay, qui se transformera plus tard, en 1997, en Association des francophones du Nunavut.
Le nombre de francophones reste cependant minime dans le territoire. Le recensement de 2021 a dénombré 575 résidents de langue maternelle française, soit 1,6 % de la population (qui s’élève à 40 000 habitants), une proportion à la baisse comparée aux 2 % de 1991.
En 2021, le nombre de personnes pouvant converser en français se situait à 1 450, soit 4 % de la population. C’est peut-être peu, mais cela n’a pas empêché le Nunavut, à sa création en 1999, de faire du français l’une de ses langues officielles.
Le français a également le statut de langue officielle dans les deux autres territoires.
La lutte contre la consommation d’alcool et les tentatives pour enrayer son commerce constituent un mouvement qui s’est déroulé en parallèle au Canada et aux États-Unis.

Les saisies d’alcool étaient fréquentes pendant la prohibition. En 1925, au lac Elk, en Ontario, les autorités ont détruit 160 barils d’alcool.
Les premières «sociétés de tempérance» remontent aux années 1820. Elles ont pour objectif de modérer la consommation de vin et de bière, mais surtout d’éliminer celle des spiritueux, qu’elles jugent être un véritable fléau social et moral.
Ces sociétés apparaissent d’abord à Pictou, en Nouvelle-Écosse, et à Montréal, puis le mouvement se répand à l’échelle du pays. Au cours de la même période, des groupes de tempérance voient également le jour aux États-Unis; certains, comme les «Sons of Temperance», étendent leurs activités au Canada.
C’est le cas au Nouveau-Brunswick, où une première prohibition sera imposée en 1855 avant d’être levée l’année suivante après l’arrivée au pouvoir d’un parti politique qui y était opposé.
La prohibition légiférée
En 1875, les sociétés de tempérance se sont grandement multipliées. Des centaines d’entre elles, y compris des groupes religieux, convergent à Montréal pour former une fédération, la Dominion Prohibitory Council.
Celle-ci adoptera un an plus tard un nom plus percutant : Dominion Alliance for the Total Suppression of the Liquor Traffic [Alliance du Dominion pour l’élimination totale du commerce de l’alcool].

Carte postale non datée montrant des policiers de Moncton, au Nouveau-Brunswick, déversant des barils d’alcool illégal, en application de la Loi de tempérance.
Cette fédération, ayant des sections dans toutes les provinces, jouera un rôle majeur dans ce qui mènera à la prohibition. Elle est l’auteure de l’ébauche d’une loi fédérale qui deviendra, en 1878, la Loi de tempérance du Canada.
Cette mesure donnait suite à la loi Dunkin adoptée en 1864, soit avant la Confédération, par la Province du Canada, qui accordait aux municipalités et autres gouvernements locaux l’autorité d’interdire la vente au détail d’alcool.
La loi de 1878 va plus loin en installant un cadre aux mesures locales de prohibition. Mais l’interdiction n’est pas encore généralisée. La prohibition nationale est le prochain pas que les mouvements de tempérance veulent forcer le gouvernement fédéral à franchir.
En 1898, le mouvement parvient à obtenir un plébiscite national sur la question. Il s’agit de la première consultation nationale depuis la fondation du Canada.
À l’instar du plébiscite sur la conscription en 1942, les résultats montrent l’ampleur des «deux solitudes» : le Québec vote contre à 81 %, tandis que le reste du Canada se prononce pour à 73 %.

Manuel de la Dominion Alliance for the Total Suppression of the Liquor Traffic, 1881.
Le premier ministre Wilfrid Laurier estime cependant que la majorité nationale, d’environ 13 000 voix pour le oui, est trop faible pour justifier l’adoption d’une loi. Il craint aussi la réaction du Québec si le gouvernement fédéral légiférait sur la question.
Les provinces vont alors prendre les choses en main.
L’Île-du-Prince-Édouard, celle qui avait le plus fortement appuyé le plébiscite (89 %), est la première à imposer la prohibition à l’échelle provinciale au tournant du XXe siècle. Durant la Première Guerre mondiale, elle sera suivie de toutes les autres provinces canadiennes ainsi que du Yukon et de Terre-Neuve (alors toujours une colonie britannique), sauf… le Québec.
En 1919, les Québécois votent massivement (78 %) par référendum en faveur de la vente de vin, de bière et de cidre. Plus encore, en 1921, le gouvernement québécois adopte carrément une loi contre la prohibition.
Ce sera, pour un moment, le seul endroit au Canada – et même aux États-Unis – où l’alcool sera légal. Cependant, plusieurs municipalités de la province imposeront la prohibition.
Le Québec ne restera cependant pas seul longtemps dans son camp. Dès 1920, la Colombie-Britannique et le Yukon votent en faveur de la vente légale d’alcool. Ce sera ensuite le Manitoba (1921), l’Alberta (1923), la Saskatchewan (1925), l’Ontario et le Nouveau-Brunswick (1927) et la Nouvelle-Écosse. (1930). Quant à la championne de la prohibition, l’Île-du-Prince-Édouard, elle tiendra le fort jusqu’en 1948.
Meanwhile, aux États-Unis…
Ironiquement, pour un pays où les États ont davantage de pouvoir que les provinces en ont au Canada, les États-Unis mettront en œuvre la prohibition partout au sein de leurs frontières pendant 13 ans. Pour y arriver, il aura cependant fallu un amendement constitutionnel, obtenu facilement auprès de 46 des 48 États de l’époque.

En mars 1916, des barmans de Toronto ont fait une file d’un demi-mille de long pour protester contre la prohibition.
Il faut alors légiférer. Le Congrès américain adopte avec une forte majorité La National Prohibition Act. Mais le président Woodrow Wilson met son véto. En deux jours, le Congrès réussit cependant à contrecarrer le refus du président en votant à plus de deux tiers contre le véto.
L’Amérique est désormais «sèche»…, mais en apparence seulement. Une contrebande massive et efficace s’organise. Elle profite énormément au crime organisé, dont le membre le plus notoire est Al Capone, chef de la pègre de Chicago.
La contrebande au Canada
Le Canada sera l’un des principaux fournisseurs d’alcool aux États-Unis pendant les années de la prohibition. La frontière est longue et les douaniers, peu nombreux… Surtout qu’au Canada, pendant les années de restriction, la vente est interdite, mais non la fabrication.

On ne peut pas parler de prohibition sans évoquer Al Capone, gangster par excellence, qui a fait la loi à Chicago pendant les années 1920.
À certains endroits, les trafiquants versent des pots-de-vin pour obtenir une heure de passage à la frontière sans problème.
Au Nouveau-Brunswick, les Acadiens sont fortement engagés dans la contrebande vers les États-Unis. En 1930 seulement, 73 % des amendes ou des arrestations impliquent des patronymes acadiens.
Située le long de la frontière américaine, la région du Madawaska dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick comptait huit entrepôts d’alcool destinés à l’exportation illégale dans les années 1920.
Dans cette région, seule une petite rivière sépare les deux pays. La violence fait partie du jeu. Les maisons de deux policiers à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, sont abimées partiellement par des explosions à la dynamite.
La palme de la contrebande d’alcool revient cependant aux iles Saint-Pierre-et-Miquelon, cet archipel français situé à 20 kilomètres des côtes de Terre-Neuve. Des cargos partis de France et d’ailleurs en Europe viennent y décharger l’alcool qui sera acheminé au pays de l’Oncle Sam.
L’âge d’or des contrebandiers se terminera en février 1933, alors que les États-Unis mettent fin à la prohibition et abrogent l’amendement constitutionnel de 1920. Le lendemain de veille sera pénible pour les trafiquants.