Taxe carbone et financement de projets autochtones
Le chef du Parti conservateur du Canada (PCC), Pierre Poilievre, a annoncé lundi que son parti allait lancer une campagne pour encourager les sénateurs à voter en faveur du projet de loi C-234.

Pierre Poilievre souhaite étendre l’exemption de la taxe carbone au gaz naturel et au propane pour les agriculteurs.
Présentement en troisième lecture au Sénat, ce dernier vise à exempter les agriculteurs de la tarification sur le gaz naturel et le propane.
Les premiers ministres de la Saskatchewan, de l’Alberta et de l’Ontario ont envoyé des lettres aux sénateurs pour leur demander de voter en faveur de C-234.
Pour eux, il est question d’alléger les dépenses des agriculteurs, qui utilisent le gaz naturel et le propane, entre autres, pour chauffer les bâtiments agricoles ou faire fonctionner les séchoirs à grains.
La semaine dernière, une motion conservatrice soutenue par les néodémocrates visant à étendre l’exemption de la taxe carbone sur le chauffage au mazout à tous les types de chauffage résidentiel avait été rejetée.
À lire aussi : Qui défend maintenant la cause de l’environnement au Canada? (Chronique)
Les chefs politiques de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, de l’Alberta et de la Saskatchewan jugent que la suspension de la taxe sur le mazout favorise les résidents de l’Atlantique, dont 30 % se chauffent au mazout.
Mardi, selon un sondage d’Abacus Data, 72 % des répondants estiment que l’exemption de la taxe devrait également être élargie, afin d’aider les Canadiens à affronter l’augmentation du cout de la vie.
Mardi, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a annoncé le lancement du Fonds de leadership autochtone.
Le programme, élaboré en collaboration avec les Premières Nations, des organisations inuites et des gouvernements métis, fournit jusqu’à 180 millions de dollars pour soutenir des projets d’énergie renouvelable, d’efficacité énergétique et de chauffage à faible émission de carbone détenus et dirigés par ces peuples.

«Nous ne pourrons pas tourner la page de la crise climatique sans les Premières Nations, les Inuits et les Métis à la barre», dit Gary Anandasangaree dans un communiqué.
«Les peuples autochtones sont en première ligne de la crise climatique : ils subissent de manière disproportionnée les effets des changements climatiques dans leurs collectivités et prennent des mesures concrètes et ambitieuses pour réduire les émissions et préserver la pureté de l’air», souligne dans un communiqué Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones.
Du 30 octobre 2023 jusqu’au 31 mars 2027, 73,9 millions soutiendront des projets menés par les Premières Nations dans le cadre d’un processus de demandes de financement continu.
Le montant alloué aux Inuits et aux Métis sera réparti sur six ans, selon un processus dirigé.
Justin Trudeau cumule les reproches
D’une part, le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a réprimandé le premier ministre canadien après que ce dernier a exhorté Israël à faire preuve de «la plus grande retenue» dans sa guerre contre le Hamas, afin de protéger les civils de Gaza.
«Ce n’est pas Israël qui vise délibérément les civils, mais le Hamas qui a décapité, brulé et massacré des civils dans les pires horreurs perpétrées contre les Juifs depuis l’Holocauste», a rétorqué Benyamin Nétanyanhou mardi soir sur la plateforme X, en interpelant directement son homologue.
«Israël fournit aux civils de Gaza des couloirs humanitaires et des zones de sécurité, tandis que le Hamas les empêche de partir sous la menace d’une arme», a-t-il écrit.
.@JustinTrudeau
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 15, 2023
It is not Israel that is deliberately targeting civilians but Hamas that beheaded, burned and massacred civilians in the worst horrors perpetrated on Jews since the Holocaust.
While Israel is doing everything to keep civilians out of harm’s way, Hamas is doing…
D’autre part, Justin Trudeau, qui n’appelle pas à un cessez-le-feu, mais plutôt à une «trêve humanitaire» à Gaza, s’est attiré la foudre d’environ 250 manifestants mardi soir, en Colombie-Britannique.
Le premier ministre dinait dans le quartier chinois de Vancouver quand le groupe s’est placé devant le restaurant pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza. Quelques affrontements ont eu lieu entre des manifestants et des agents de la police.

En date du 25 novembre, 356 Canadiens ont pu quitter la bande de Gaza, selon Affaires mondiales Canada.
Des vidéos publiées sur Internet démontrent qu’un autre rassemblement a eu lieu le même soir, cette fois-ci dans un restaurant indien. Des manifestants ont entouré Justin Trudeau qui a dû quitter les lieux. «Vous avez du sang sur les mains», lui ont reproché des manifestants.
À lire aussi : Mieux comprendre le conflit entre Israël et Hamas
Questionné sur sa décision de ne pas appeler au cessez-le-feu lors d’une conférence de presse plus tôt mardi, le premier ministre a expliqué que «ce n’est pas toujours [une solution magique] définie par un premier ministre canadien qui va soudainement apporter la paix au Moyen-Orient du jour au lendemain».
«Il s’agit de nous rappeler que lorsqu’un enfant a peur d’aller à l’école le matin à cause de sa religion ou de son appartenance ethnique, ce n’est pas seulement la responsabilité du gouvernement, mais celle de chacun d’entre nous de dire que cela s’arrête maintenant», a-t-il poursuivi, en faisant allusion à la montée d’actes antisémites et islamophobes au Canada.
À lire aussi : Sans justice, il ne peut y avoir de paix

La ministre Mary Ng était présente à l’APEC cette semaine.
De mercredi à vendredi, Justin Trudeau a participé à la réunion des dirigeants de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), à San Francisco, aux États-Unis, où il a rencontré le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom.
Celui-ci et Justin Trudeau ont discuté «de possibilités dans le domaine de l’énergie propre, notamment de la résilience des réseaux d’électricité propre, de l’énergie nucléaire de même que du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone», peut-on lire dans le communiqué du bureau du premier ministre.
Le principal objectif de l’APEC est de «promouvoir une croissance économique durable et la prospérité dans la région Asie-Pacifique», précise le site du gouvernement canadien.
Le premier ministre était accompagné de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et de la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, Mary Ng.
Francopresse : Vous venez d’être assermentée en tant que juge à la Cour suprême du Canada. Vous êtes une fière Franco-Albertaine qui exerce le droit depuis près de 30 ans, mais qui est la femme derrière la juge Moreau?
Juge Mary T. Moreau : Je suis native de l’Alberta, sixième de huit enfants, un père franco-albertain avec un grand-père qui, lui, a déménagé du Québec aux Prairies et une mère anglophone avec du sang écossais et irlandais. Alors, je suis un produit d’une famille exogame. Les deux langues étaient utilisées à la maison durant ma jeunesse.
Je suis allée aux écoles bilingues, ce qui voulait dire 50 % en français, soit la limite prescrite par la législation provinciale à cette époque.
Par la suite, je me suis inscrite à une faculté francophone, le campus Saint-Jean, de l’Université de l’Alberta, où j’ai suivi des cours en arts ainsi qu’en sciences, parce que je n’avais pas encore décidé ce que je voulais faire comme carrière.
Après quelques années, j’ai poursuivi mes études à l’École de droit de l’Université de l’Alberta.
J’ai été nommée juge à l’âge de 38 ans, alors que les femmes composaient seulement un quart environ de la Cour. À l’époque, des dispositions en vigueur du Code criminel exigeaient d’avoir des juges bilingues pour présider des procès en français. C’est ce qui, je pense, a été valorisé dans ma nomination.
Vingt-trois ans plus tard, j’ai été nommée juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, qui est maintenant la Cour du Banc du Roi.
Vous avez un intérêt marqué pour le droit criminel et constitutionnel, mais vous avez aussi cofondé l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA). On peut comprendre que la francophonie a une place importante pour vous?
Bien entendu, c’est mon histoire personnelle, la langue et la culture, qui fait partie de moi.
Quand j’ai commencé à pratiquer à Edmonton, j’avais une clientèle mixte francophone et anglophone.
J’ai fait beaucoup de droit criminel en tant qu’avocate de la défense et c’est là où j’ai rencontré un client qui a voulu subir son procès criminel en français pour trafic de cocaïne.
C’est le début d’un long voyage, un parcours de quatre niveaux de tribunaux jusqu’à la Cour suprême pour établir le droit de cet accusé de subir son procès en français. À l’époque, les dispositions du Code criminel qui permettaient le procès dans l’une ou l’autre ou les deux langues n’avaient pas été proclamées en vigueur en Alberta.
C’était vraiment le lancement d’une carrière en droit constitutionnel ainsi qu’en droit criminel et en litige civil et familial.
Dans ma carrière d’avocate, j’ai aussi participé à l’affaire Mahé sur l’interprétation des droits de l’article 23 de la Charte des droits et libertés qui s’est rendue en Cour suprême. J’étais un des conseillers juridiques pour les appelants.
À lire aussi : 30 ans plus tard, l’héritage incroyable de l’arrêt Mahé
Quand j’étais juge de procès, j’ai présidé plusieurs causes et procès en français devant jury, y compris des affaires de droit criminel, et j’ai aussi présidé des procès en français, surtout comme juge suppléant, à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et à la Cour suprême du Yukon.
Alors, comme juge en chef, ça m’intéressait de créer plus d’espace pour l’accès à la justice dans les deux langues officielles, vu les dispositions du Code criminel sur l’offre de services en français.
Sous mon administration, on a développé une politique pour les services en français qui incluait les conseils, les avis enregistrés aux accusés à leur première comparution devant notre cour. Ils avaient la possibilité d’avoir un procès en français ou en anglais ou bilingue.
Ce sont des étapes comme ça qui, pour moi, suivaient la rigueur des dispositions du Code criminel.
Je pense qu’à la Cour suprême, les membres de la Cour ont différentes origines ethniques, géographiques, culturelles, et je pense que c’est une bonne chose que la Cour contienne cette diversité pour que les gens puissent se reconnaitre dans sa composition.
Juge Mary Moreau
Votre nomination a une valeur historique, car pour la première fois à la Cour suprême du Canada, il y a plus de femmes juges que d’hommes. Qu’est-ce que cela signifie pour vous?
Pour moi, ça signifie une évolution importante. Les femmes constituaient un quart de ma classe en droit à l’Université de l’Alberta. Maintenant, les femmes représentent facilement la moitié des étudiants dans les classes de droit.
C’est une évolution à ce niveau-là. En matière du choix de carrière que j’ai fait comme avocate, les femmes étaient plutôt rares en droit criminel. On les voyait moins au niveau de la défense.
J’ai vu dans ma carrière, et surtout durant ma carrière de juge, que ça aussi, ça a évolué. Maintenant les femmes participent activement à la défense criminelle. Et comme juge, quand j’ai accepté une nomination à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, en 1994, on était environ un quart de femmes.
Maintenant, on est très très proches de 50 % des femmes à la Cour du Banc du Roi. C’est donc une autre évolution.
Je suis très très contente d’être dans un contexte où les femmes occupent maintenant une place majoritaire à la Cour, ce qui veut dire que l’évolution continue. J’espère qu’il y aura un moment où ça ne sera plus remarquable.
Maintenant que vous êtes à la Cour suprême du Canada, quelle sera votre priorité?
Comme j’ai dit au Comité parlementaire, c’est de rendre justice, d’écouter, de réfléchir dans un contexte qui est nouveau pour moi. J’ai beaucoup à apprendre, mais de rendre justice, je pense que c’est l’aspect le plus important pour que le public soit confiant dans le rôle des tribunaux et de la Cour suprême dans le système de justice.
Avec mon travail à l’international, la primauté du droit est quelque chose à nourrir tout le temps. Il ne faut pas le prendre comme acquis, même dans une démocratie très développée.
Avez-vous pu accéder à une salle de bain propre et sécuritaire aujourd’hui? Si oui, vous avez de la chance : vous faites partie de la moitié de l’humanité qui dispose de ce privilège.
En effet, selon les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), 3,5 milliards de personnes vivent sans accès à des toilettes salubres et sécuritaires. À l’occasion de la Journée mondiale des toilettes, penchons-nous – ou plutôt, assoyons-nous – sur ce sujet fondamental.
Quoi de plus banal dans nos vies confortables que d’accéder facilement à une salle de bain?
Véritables havres de paix pour certaines personnes, qui s’y enferment des heures durant pour améliorer leurs compétences en sudoku ou fuir l’agitation familiale, et dignes des meilleurs spas pour d’autres, qui y installent douchettes et sièges chauffants, nos toilettes font rarement l’objet de discussions en société.
Elles font partie de ces sujets dont on parle peu, si ce n’est pour quelques blagues en fin de soirée ou pour se plaindre d’un abattant non baissé.
Pourtant, à l’échelle mondiale, le sujet n’a rien de drôle ou de futile. La contamination de l’eau, la déficience des systèmes d’assainissement et le manque d’hygiène sont à l’origine de la mort de quelque 1 000 enfants de moins de 5 ans chaque jour.
Il s’agit donc d’un enjeu majeur de santé publique dont il est important de parler.
Impact disproportionné sur les femmes
Imaginez-vous devoir parcourir chaque jour des kilomètres pour trouver un endroit décent et sécuritaire pour vous soulager.
Ou devoir faire face à des situations dangereuses, comme du harcèlement sexuel, chaque fois que vous vous rendez dans les toilettes partagées de votre village.
Ou encore, risquer de contracter une maladie mortelle telle que le choléra ou des parasites intestinaux à cause d’installations sanitaires défectueuses et inadaptées dans votre lieu de vie.
Ceci est la réalité de nombreuses femmes et jeunes filles de partout dans le monde, touchées de manière disproportionnée par les conséquences d’un manque d’accès aux services d’hygiène. Cette situation peut avoir de graves conséquences sur leur santé, sur leur dignité et sur leurs chances de réussite.
En l’absence de toilettes dans les écoles, par exemple, les filles peuvent être obligées de manquer les cours pendant leurs règles, ce qui peut ainsi compromettre leur accès à l’éducation.
Aussi, comme le révèlent les chiffres de l’OMS et de l’UNICEF, dans 7 cas sur 10, les foyers sans point d’eau à domicile – une réalité pour 1,8 milliard de personnes dans le monde – s’en remettent aux femmes et aux filles pour la collecte de l’eau.
Celles-ci doivent parcourir des distances importantes pour s’acquitter de leur tâche, ce qui réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à l’éducation, au travail ou aux loisirs, et perpétue le cycle de la pauvreté. Elles s’exposent également à de nombreux dangers lors de leurs déplacements.
Une question de dignité
Même chez nous, au Canada, l’accès à des toilettes propres et sécuritaires peut s’avérer un défi. Pensons notamment aux femmes sans-abris, qui doivent faire face à des obstacles uniques en matière d’hygiène et de dignité, ou aux personnes porteuses d’un handicap.
En mettant l’accent sur l’amélioration de l’accès à des installations sanitaires adéquates pour tout le monde, et en particulier pour les femmes et les filles, la Journée mondiale des toilettes contribue à sensibiliser à ces questions et à promouvoir des solutions inclusives.
Il s’agit d’une question de dignité, d’égalité des genres et de respect fondamental.
Originaire de Belgique, Julie Gillet est titulaire d’une maitrise en journalisme. Militante éprise de justice sociale, elle travaille depuis près de quinze ans dans le secteur communautaire francophone et s’intéresse aux questions d’égalité entre les genres. Elle tire la force de son engagement dans la convergence des luttes féministes, environnementales et antiracistes. Elle vit aujourd’hui à Moncton, au Nouveau-Brunswick.
Début octobre, Radio-Canada révélait que plusieurs hauts gradés de la GRC occupent des postes bilingues alors qu’ils ne maitrisent pas le français. Une information qui ne surprend pas du tout Jean-François Savard.
«Il n’y a rien de surprenant, a lancé le professeur en entrevue avec Francopresse. Je ne vois pas en quoi c’est une nouvelle même. C’est simplement un reflet [de la société] que l’on trouve aussi dans la fonction publique fédérale en général.»
Projet pilote
Quelques semaines après la publication de l’article, le commissaire de la GRC, Michael Duheme, était convoqué devant le Comité permanent des langues officielles.
Lors de son témoignage, le 30 octobre, il a affirmé que l’organisme étatique mettrait en place une nouvelle stratégie afin de se conformer à la Loi sur les langues officielles.

Le commissaire de la GRC Michael Duheme a été convoqué le 30 octobre devant le Comité permanent des langues officielles.
«Nous identifierons les lacunes et les obstacles comme matière de conformité», a lancé le commissaire en séance parlementaire.
Michael Duheme a en outre présenté les quatre axes prioritaires de cette stratégie : «Renforcer le leadeurship en matière de langues officielles, promouvoir la conformité législative avec la Loi sur les langues officielles, créer une culture d’inclusion et assurer la responsabilité, la transparence et l’évaluation des progrès», a-t-il énuméré.
À défaut de répondre favorablement à une demande d’entrevue, la GRC a envoyé un courriel à Francopresse où elle affirme avoir récemment lancé un projet pilote qui consiste à embaucher des enseignants de langues secondes pour offrir des formations à l’interne aux employés.
Pour Jean-François Savard, c’est un projet comme un autre. «Penser qu’un projet pilote pourrait améliorer une situation comme celle-là, non je n’y crois pas vraiment, dit-il avec un ton pessimiste. Ça fait trop partie de la culture canadienne.»
«C’est un problème de culture»
«Ce n’est pas un problème de projet pilote, c’est pas un problème de programme. Le problème, c’est un problème de culture. Dans la culture canadienne, il y a très peu d’intérêt pour le bilinguisme», se désole le professeur.
Quant aux lacunes francophones au sein de la GRC, «on est pas dans une situation où, par exemple, il y a une mauvaise gestion des effectifs en région, où on n’est pas capable de trouver à ce moment-là une solution […]. On parle ici de la volonté des gens d’apprendre une autre langue», insiste Jean-François Savard.
Il faut vouloir la pratiquer [la langue française]. Donc tant que cette volonté-là n’existera pas, il n’y a pas de programme qui va permettre de changer cette situation-là.
En plus de constater que la maitrise du français est «généralement très mauvaise» au sein des institutions fédérales, le professeur soutient que les francophones semblent être souvent défavorisés lorsqu’il s’agit de grimper les échelons.
Selon lui, très peu d’entre eux arrivent à atteindre des niveaux de cadres supérieurs dans l’administration fédérale.
Tout cela représente, d’après lui, un ensemble de caractéristiques de la société canadienne hors du Québec.

Pour Jean-François Savard, il est nécessaire d’apporter des changements au sein de la société canadienne afin de créer une meilleure compréhension du fait français au Canada.
«On entend des gens comme le premier ministre Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick qui disent à tout le monde publiquement que lui, en tant qu’anglophone, il se sent menacé, il se sent bafoué dans ses droits d’avoir à parler français […], illustre Jean-François Savard. À l’exception de la Nouvelle-Écosse, c’est un mouvement qu’on retrouve partout au Canada [anglais].»
Dans un courriel envoyé à Francopresse, la GRC assure qu’elle veille à ce que les personnes d’expression française et celles d’expression anglaise aient des chances égales d’emploi et d’avancement dans l’institution.
À lire aussi : Dans l’Ouest, des aéroports boudent leurs obligations linguistiques
L’éducation et des politiques ciblées
Pour Jean-François Savard, le changement de culture doit passer d’abord et avant tout par l’éducation, primaire et secondaire.
Selon lui, il serait important d’améliorer la qualité du français enseigné partout au Canada, «avec des programmes qui sont plus enrichis, qui donnent une meilleure immersion dans la langue seconde. C’est ça qui va faire que les gens vont comprendre une culture».
À partir du moment où ils sont capables de s’immerger dans cette culture-là […], ils arrivent à mieux comprendre la réalité des francophones et ils ne sont plus menacés par le fait français.
Dans un deuxième temps, la mise en place de politiques publiques en faveur de la langue française et de sensibilisation aux questions linguistiques serait une étape importante pour soutenir les francophones hors Québec, soutient le professeur en administration publique.
Même si la Loi sur les langues officielles garantit l’offre de services bilingues, il n’existe pas selon lui de politiques ayant pour but d’assurer la francophonie ou le bilinguisme.
Dans cette optique, le spécialiste soutient que des politiques fédérales pourraient amener à sensibiliser la population sur le fait français et aussi uniformiser l’enseignement de langue seconde partout au pays.
Pendant plusieurs années, les gouvernements qui se sont succédé n’ont pas toujours pris conscience de l’importance des investissements publicitaires et de la mécanique derrière ses achats.
Au Québec, le gouvernement a passé un décret en février 1995, promettant d’investir 4 % annuellement au sein des médias communautaires québécois. Cet ajout a permis une plus grande équité envers la population, permettant la diffusion de message publicitaire dans l’ensemble des régions pour que les résidents des villes et des régions puissent avoir accès à ses messages d’intérêt public.
Au sein du gouvernement fédéral, il n’existe aucune mesure de la sorte et les Canadiennes et Canadiens, de partout au pays, se sont retrouvés avec des budgets publicitaires profitant à des entreprises étrangères, provoquant une sortie des capitaux au lieu de créer des emplois et des services dans nos communautés.
Cette mesure d’établir un seuil minimum de l’investissement publicitaire gouvernemental vers les médias communautaires de partout au pays devrait s’imposer sur la scène fédérale.
À lire aussi : «Non, on ne recule pas sur C-18»
C-18 manque de sens pratique
Le gouvernement Trudeau semble impuissant, sans véritable plan, ni de connaissance du terrain.
Le projet de loi C-18 est un bel exemple. Le principe derrière cette loi est noble, mais la belle naïveté de croire qu’un tel projet allait rapidement et concrètement se mettre en place provient d’une déconnexion totale du terrain. Oui, il y a eu des concertations, mais l’idée du gouvernement Trudeau manquait visiblement d’un sens pratique et d’une vision des conséquences.
Tout en restant solidaires du principe derrière C-18, nous constatons que le gouvernement n’avait pas pensé aux conséquences que peuvent avoir des médias locaux et sa population qui a souvent besoin de l’information rapidement, dans des situations d’urgence, telles que des inondations ou des feux de forêt.
Nous avons salué le gouvernement fédéral et certaines provinces ainsi que certaines municipalités d’avoir décidé d’arrêter d’investir dans Meta, mais il y a eu un manque de planification pour la suite. Chaque jour, les stations de radios communautaires au pays reçoivent des commentaires de la part de leurs auditeurs et lecteurs qui demandent pourquoi les médias ne sont plus sur Facebook et Instagram. Les stations ont des messages en ondes, mais de là à avoir à expliquer continuellement C-18, démontre toute la faiblesse du plan.
À lire aussi : Les médias francophones locaux en crise
Campagne de sensibilisation urgente
Nos deux associations, représentant 65 stations de radio au pays, demandent plus que jamais qu’une campagne de sensibilisation auprès de la population soit mise en place.
Nos deux associations ont d’ailleurs eu des conversations avec des députés de partout au Canada, qui questionnent eux-mêmes leurs actions. «On a peut-être agi trop rapidement», nous disent certains. À preuve, à voir certains partis politiques et élus à continuer à investir argent et temps dans les plateformes de Meta, on se retrouve avec des réflexes qui perdurent. Certains élus préfèrent encore continuer à nourrir Facebook que de communiquer avec leurs médias locaux qui, pourtant, représentent l’intérêt du public.
Les stations de radio communautaire sont devenues, dans les dernières années, des producteurs importants de nouvelles locales autant à la radio que par l’écrit grâce au Web. Les plateformes de Meta permettaient de rendre le contenu plus accessible, surtout lorsqu’il y avait des situations d’urgence climatique.
À la veille de la menace de Google d’imiter son collègue de Meta, il est plus que temps que le gouvernement fédéral se penche sur des actions et les moyens à prendre. Nos collectivités francophones hors Québec et les communautés de partout au Québec veulent continuer à s’entendre et à avoir accès à de l’information de proximité.
Soyons tous conséquents, prenons les actions qui s’imposent.
Fondée en 1991, l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC du Canada) regroupe 28 radios communautaires de langue française en situation de minorité au pays. L’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) a été fondée en 1979 et compte 37 membres. Les stations membres de ses deux associations emploient près de 600 employés avec un chiffre d’affaires de plus de 30 millions de dollars et un auditoire combiné dépassant largement le 1 00 000 d’auditeurs chaque semaine, selon les données et plus récentes études de StatsRadio.
Pour le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes, l’annonce récente des prochaines cibles en immigration est une «occasion manquée» de mettre en place les mesures nécessaires afin d’accroitre la protection des migrants.
Le 1er novembre, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (IRCC), Marc Miller, a annoncé l’objectif d’admettre 500 000 résidents permanents en 2025. Un chiffre que le gouvernement souhaite stabiliser à partir de 2026.
À lire aussi : Cibles en immigration : la francophonie est déçue
«Au cours de la dernière année, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires et le gouvernement pour identifier les lacunes et les défis du système d’immigration du Canada. Le but de cette invitation était d’avoir des mesures pour protéger des nouveaux arrivants, des étudiants internationaux et des survivants de la traite des personnes, y compris des travailleurs, travailleuses migrants», déplore Aziz Froutan, gestionnaire des communications du Centre.

Aziz Froutan est déçu de voir les lacunes en matière de protection des migrants.
«Il y avait des plans et des recommandations envoyés vers le gouvernement, et malheureusement, il n’a pas considéré toutes les recommandations, mesures et actions soulignées par les organismes qui travaillent avec les victimes et les survivants de la traite des personnes», se désole-t-il.
Parmi les éléments manquants, il note les questions des permis fermés, du regroupement familial et de l’accès à un statut permanent.
Les Nations Unies grondent le Canada
Plus tôt en septembre, Tomoya Obokata, rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines d’esclavage a déclaré que «les programmes de travailleurs étrangers temporaires du Canada sont un terrain propice aux formes contemporaines d’esclavage».
Selon lui, le Canada doit régulariser le statut des travailleurs migrants étrangers et mettre fin au système fermé des permis de travail.
Ce système a d’ailleurs perturbé le rapporteur qui l’accuse de rendre les travailleurs migrants «vulnérables aux formes contemporaines d’esclavage, car ils ne peuvent pas dénoncer les abus subis sans craindre d’être expulsés».
À lire aussi : Les travailleurs étrangers temporaires mal informés de leurs droits
Potentielle hausse de traite
Alors que les Nations Unies recommandent que le Canada améliore l’accès à la résidence permanente pour tous les migrants, la stabilisation prévue en 2026 aurait l’effet inverse d’après des experts.

Mylène Coderre-Proulx effectue des recherches sur l’immigration.
Cette stabilisation ne vise pas l’immigration temporaire, dont les chiffres ont atteint des records cette année. «Si on a plus de nouveaux arrivants, surtout des étudiants et étudiantes internationaux et des travailleurs et travailleuses migrantes, et qu’on n’a pas pris les mesures nécessaires, on va avoir plus de problèmes [d’exploitation]», s’inquiète Aziz Froutan.
L’accès restreint à la résidence permanente préoccupe aussi Mylène Coderre-Proulx, doctorante en développement international à l’Université d’Ottawa. Elle rappelle que plusieurs demandeurs de statut permanent se trouvent déjà sur le territoire canadien.
Un statut temporaire reste un statut précaire, souligne-t-elle. «La résidence permanente pour motifs humanitaires, c’est souvent la dernière voie qu’il reste pour sécuriser un statut.»
Si on continue de connaitre un taux de croissance élevé d’immigration temporaire et qu’en parallèle, on gèle les seuils d’immigration permanente, bien là on précarise une population migrante sur notre territoire, peu importe le statut.
Pour illustrer la précarité d’un statut temporaire, Mylène Coderre-Proulx prend l’exemple d’un employeur lié à un permis fermé abusif.
«[Le travailleur] rencontre quelqu’un qui lui promet un nouvel emploi, de s’occuper de démarches d’immigration permanente et de faire venir sa famille, amorce-t-elle. Le travailleur quitte son emploi et la personne peut lui extorquer de l’argent en disant qu’elle s’occupe de ses démarches d’immigration alors que ce n’est pas le cas. Elle peut saisir ses documents d’identité, son passeport. On arrive tranquillement dans une situation de traite.»
Des promesses qui datent
C’est sur toutes les personnes temporaires et sans statut «que repose le fonctionnement de tout un pan de l’économie, mais on ne leur reconnait pas les mêmes droits fondamentaux qu’à n’importe quel autre citoyen», a dénoncé le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) dans un communiqué le 3 novembre, en réaction à l’annonce du gouvernement.
Pour le CTI, restreindre l’accès à la résidence permanente sans améliorer les conditions des résidents temporaires les vulnérabilise et les améliorations en ce sens tardent à voir le jour.
À lire aussi : L’embauche des travailleurs étrangers temporaires facilitée, mais pas leur protection
Le CTI dénonce l’absence dans le plan du gouvernement d’annonce relative à l’abolition du permis fermé, «pourtant réclamée par nombre d’organisations communautaires et syndicales».
Malgré les recommandations venant de plusieurs intervenants comme les Nations Unies et Amnistie internationale d’abolir ce type de permis, le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a statué qu’il ne le fera pas, lors d’une réunion du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration (CIMM) le 7 novembre.

Marc Miller est ouvert à l’idée d’assouplir le permis fermé.
Il a toutefois reconnu que des changements devaient être apportés et a indiqué que son département cherchait des façons pour permettre des changements d’emplois plus rapides pour ceux possédant un permis lié à un employeur spécifique.
«Rien sur la régularisation des personnes sans papier, malgré la promesse faite par Justin Trudeau il y a vingt-trois mois», argüe aussi l’organisme.
À lire aussi : La traite des personnes évolue toujours dans l’ombre
La «promesse» faite par le premier ministre fait quant à elle référence à la lettre de mandat de 2021 de l’ancien ministre de l’Immigration dans laquelle il lui était demandé de «poursuivre l’exploration de moyens de régulariser le statut des travailleurs sans papiers qui contribuent aux communautés canadiennes».
La lettre de mandat de Marc Miller, ministre de l’Immigration depuis juillet 2023, n’est pas encore connue.
«Il y a des points positifs»
Néanmoins, Aziz Froutan reconnait «des points positifs» au sein de la nouvelle stratégie du gouvernement libéral.
«Il y a un plan pour aider et pour protéger des étudiants·tes internationaux en leur donnant des informations sur le système d’immigration au Canada […] On a vu que le gouvernement essaie d’avoir un groupe consultatif des survivants de l’immigration ou des gens ayant des expériences vécues.»
Quant aux propos de Marc Miller sur l’assouplissement du permis fermé, Aziz Froutan déclare, dans un courriel, que le Centre «est heureux de constater que le ministre est ouvert aux réformes désespérément nécessaires. Toutefois, une action est nécessaire immédiatement».
«Le gouvernement doit sortir le Canada de sa dépendance à l’égard du Programme des travailleur·euses étrangers temporaires. Cela ne signifie pas fermer la porte au travail migrant. Cela signifie plutôt développer une stratégie fondée sur les droits qui donne la priorité à l’équité, à la justice et à l’égalité des chances.»
Alexandra Bolduc, directrice du Salon du livre de Vancouver en Colombie-Britannique, et Liette Paulin, directrice générale du Salon du livre de Dieppe au Nouveau-Brunswick, partagent leur vision et leurs défis. Elles parlent de leur amour de la littérature et de leur rôle de passeuses de culture.
Francopresse : Quel rôle jouent les salons du livre dans les communautés francophones en situation minoritaire?
Liette Paulin : Dans un contexte où il y a peu, voire pas du tout de librairies francophones, les salons constituent la principale porte d’entrée vers la littérature en français. Le public peut avoir accès aux ouvrages, les voir, les toucher, parler également avec les écrivains et écrivaines. Ce sont tout simplement des indicateurs de la vitalité de la culture franco-canadienne.

Liette Paulin explique que le Salon du livre de Dieppe accorde une grande place aux scolaires dans sa programmation, avec plus de 200 activités organisées dans les écoles et les bibliothèques.
Alexandra Bolduc : Ce sont comme des librairies ambulantes. Ils participent à la création d’un bassin littéraire dynamique, d’une culture francophone par-delà des frontières provinciales. C’est fondamental pour préserver la langue et donner une légitimité à notre culture.
Ce sont également des évènements rassembleurs qui permettent de faire connaitre et rayonner les auteurs et leurs œuvres d’un bout à l’autre du pays. Chaque année, on s’attèle à faire venir des auteurs et des maisons d’édition de toute la francophonie canadienne, de l’Ouest, mais aussi de l’Ontario et de l’Acadie. Les écrivains peuvent ainsi se retrouver, partager leurs réflexions et développer un sentiment d’appartenance commune.
Quel public fréquente les allées de vos salons?
Alexandra Bolduc : Notre public est très divers, mais le salon attire de nombreuses familles. Le volet jeunesse est d’ailleurs très important pour nous, c’est au cœur de notre mandat. La graine de la lecture et de la littérature doit se planter dès le plus jeune âge.
À cet égard, il est essentiel que les références des enfants soient des livres de leur milieu, écrits par des auteurs locaux. Ainsi, ils pourront développer un imaginaire local francophone.
Nous avons également de nombreuses écoles qui viennent nous rendre visite et nous essayons d’embaucher des auteurs pour qu’ils animent des activités pour les jeunes.
Liette Paulin : Nous accordons également une grande place au niveau scolaire. Nous offrons plus de 200 activités et animations dans les écoles et les bibliothèques. De nombreux auteurs vont dans les salles de classe pour donner aux jeunes le gout de la lecture.
Très souvent, on revoit ces élèves dans les allées du salon : ils s’assoient par terre et commencent à lire avant même d’avoir acheté l’ouvrage. C’est tout ce qu’on veut voir. Quel que soit ce qu’ils lisent, c’est bénéfique pour leur alphabétisation.
Les défis sont plus grands avec les adolescents de 12 à 17 ans. C’est souvent à cet âge-là qu’on les perd, car leur vie à l’extérieur des murs de l’école est en anglais et les écrans occupent beaucoup de leur temps. On doit se mobiliser avec les éditeurs et les organismes communautaires pour les récupérer.
Êtes-vous confrontées à des difficultés financières?
Liette Paulin : C’est un défi de conserver un nombre d’animations constant et de bien rémunérer nos auteurs, car les financements n’augmentent pas aussi vite que les couts. Depuis la pandémie, les couts de transport ont particulièrement explosé. Résultat, certains distributeurs et maisons d’édition ne viennent plus. Par chance, nous avons plus de 50 bénévoles qui nous aident pour l’organisation.

Alexandra Bolduc est entourée de Vanessa Léger (autrice) et Louis Anctil (éditeur des Éditions du Pacifique Nord-Ouest). Selon la directrice du Salon du livre de Vancouver, les salons répondent à un besoin essentiel de culture des communautés francophones en situation minoritaire.
Alexandra Bolduc : Les salons du livre sont souvent remis en question à cause de leur cout élevé. Oui ça coute cher, mais ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte. Ces manifestations répondent à un besoin essentiel de culture au sein de nos communautés.
À Vancouver, nous avons un petit budget, nous sommes constamment à la recherche de fonds fédéraux et provinciaux. Hormis trois salariés, c’est une équipe de bénévoles qui porte l’organisation à bout de bras. En tant que jeune évènement, ce n’est pas évident de s’insérer dans l’industrie du livre, on doit démontrer notre valeur. Heureusement, le Regroupement des Éditeurs franco-canadiens (REFC) nous aide depuis le début.
Les salons du livre de l’Ouest ont besoin du soutien de tout le monde, des éditeurs, mais aussi des distributeurs pour acheminer les ouvrages jusqu’ici. Si l’on veut que la culture perdure, il faut créer des ponts.
Je reste confiante. En cinq ans, nous avons gagné des assises solides et nous sommes bien implantés dans le paysage. Nous sommes devenus un évènement attendu autant par le public que par les auteurs.
Les propos ont été réorganisés pour des raisons de longueur et de cohérence.
Négocier pour assurer la paix
Mona Paré, professeure titulaire à la Faculté de droit, section de droit civil, à l’Université d’Ottawa et experte en droit international, juge que «le droit international a un rôle beaucoup plus important aujourd’hui qu’il l’avait au début du XXe siècle et avant, parce qu’il s’est énormément développé».
Depuis la signature de la Charte des Nations unies en 1945, le droit international interdit l’usage de la force lors de conflits entre différentes entités en relations internationales.

Selon Mona Paré, professeure à l’Université d’Ottawa, la paix «ne veut pas seulement dire l’absence de conflits».
«L’emploi de la force inclut l’agression armée, c’est à ça qu’on penserait en premier. Mais il y a aussi d’autres manières comme les menaces d’emploi de la force, des représailles […], l’occupation militaire d’un territoire qui n’est pas le nôtre, la violation de frontières ou de lignes de démarcation internationale», informe-t-elle.
La Charte des Nations unies préconise plutôt la conclusion pacifique d’accords entre des États membres opposés par un conflit.
D’ailleurs, tous les États membres des Nations unies doivent s’engager à respecter ce traité et à privilégier différents modes de résolution de conflits, comme la médiation, l’arbitrage, les tribunaux arbitraux et la négociation, indique Mona Paré.
Les États optent souvent pour la négociation, ce qui permet d’atteindre un consensus, rapporte la professeure. «Ça ne veut pas dire évidemment que les négociations réussissent toujours, […] mais lorsque les négociations échouent, ça ne veut pas dire qu’on doit arrêter là non plus.»
Le 19 décembre 2016, l’Assemblée générale Nations unies a adopté une déclaration sur le droit à la paix.
Depuis, «on demande que les États éliminent les menaces de guerre, qu’ils abandonnent le recours à la force dans les relations internationales», détaille Mona Paré, professeure titulaire à la Faculté de droit à l’Université d’Ottawa.
La fin justifie-t-elle les moyens?
S’il est évident de soutenir la paix, «les moyens de l’atteindre divisent tout le monde», souligne Melchior Mbonimpa, professeur émérite en philosophie à l’Université de Sudbury, en Ontario.
«Les philosophes n’ont pas une définition de la paix qui leur serait commune. Ils ont beaucoup abordé la question par divers angles d’attaque», ajoute-t-il.
Le professeur Melchior Mbonimpa dresse un tableau chronologique de la définition de la paix selon divers grands penseurs :
Le philosophe italien Machiavel (1469-1527) voit la paix comme l’absence de guerre. Pour l’Anglais Hobbes (1588-1679), la paix n’est pas naturelle pour l’homme et donc elle doit être imposée. Le courant des Lumières définira ensuite la paix comme une absence de conflit entre les religions, mais le Prussien Kant (1724-1804) avancera que la paix est un phénomène plus considérable qu’une absence de conflit.
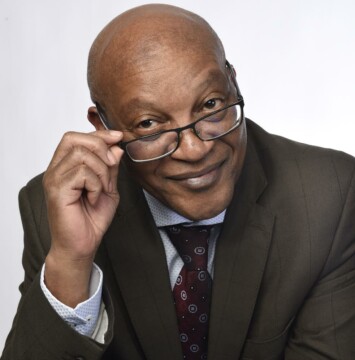
«Il n’y a pas de consensus sur la notion de la paix» pour les philosophes, explique Melchior Mbonimpa, professeur à l’Université de Sudbury.
Pour Melchior Mbonimpa, il n’est pas possible de parler de paix sans aborder la question de la guerre. «Quand on est surs que faire la guerre ça va causer moins de dégâts que de ne pas la faire, il faut la faire. Il y a des moments où la paix à tout prix n’est pas bonne.»
Le philosophe prend l’exemple de l’invasion militaire du Cambodge par le Vietnam en 1978 pour mettre fin au régime communiste et violent des Khmers rouges dirigés par Pol Pot, qui a conduit au génocide de deux-millions de personnes entre 1975 et 1979.
«Le Vietnam a décidé d’intervenir parce que le voisin était en train de décimer sa population [des Vietnamiens résidaient au Cambodge]. C’était une manière de sauver le reste, ce qu’il laissait de la population», explique le professeur.
Cela dit, «il ne faut pas non plus prendre des canons pour tuer des mouches», nuance-t-il.
Comprendre les violences pour construire la paix
La psychologie de la paix ne se limite pas à comprendre la violence des guerres. Elle s’intéresse aux divers aspects de celles-ci, comme les rapports sociaux, la structure, la culture, l’individu.
Selon Adelheid Nicol, professeure titulaire au Collège militaire royal du Canada à Kingston, en Ontario, plusieurs facteurs ne permettent pas d’instaurer la paix, notamment la violence épisodique et intermittente qui comprend les agressions entre les personnes, qu’elles soient verbales, psychologiques ou physiques, «ainsi que des formes organisées de violence entre États, telles que la guerre, le génocide, le terrorisme».

«La paix peut être définie, étudiée au niveau de l’individu, du groupe, de la culture et de la structure», indique Adelheid Nicol, du Collège militaire royal du Canada.
Moins connue, la violence structurelle adopte une forme indirecte et continue dans le temps. Elle existe dans le système politique des États, ce qui entraine des conflits, explique Adelheid Nicol.
Selon elle, «les pratiques discriminatoires, l’inégalité des revenus, les préjugés, le sexisme intégré dans le mode de fonctionnement des organisations, des gouvernements» sont autant d’exemples de violence structurelle.
Pour éviter la violence et les guerres dans la société, il faut assurer une bonne gestion des conflits en favorisant les discussions pacifiques, estime Adelheid Nicol.
D’ailleurs, il est possible de distinguer des types de paix : la paix négative, qui tente de trouver des moyens efficaces pour éviter les guerres, et la paix positive, qui se focalise sur la réduction de tout risque de conflit, en améliorant les structures de la société, informe Adelphie Nicol.
Le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a débattu jeudi de l’article 8 du projet de loi sur l’apprentissage et les services de garde (C-35), très attendu chez les francophones.

L’amendement proposé par le sénateur René Cormier visait à assurer le financement des services de garde en contexte minoritaire à long terme.
Ce dernier précise que : «Le gouvernement du Canada s’engage à maintenir le financement à long terme des programmes et services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, notamment ceux destinés aux peuples autochtones.»
Le sénateur René Cormier a proposé un amendement pour ajouter à la fin de cette phrase la mention «et aux communautés de langue officielle en situation minoritaire», ou CLOSM, qui désignent les francophones hors Québec et les anglophones au Québec.
«Certes, les ententes bilatérales conclues avec les provinces et territoires prévoient actuellement du financement envers les CLOSM, mais nous ne pouvons en aucun cas prendre cela pour acquis», a défendu le sénateur indépendant du Nouveau-Brunswick.
À lire aussi : Petite enfance, grande pénurie de services en français
Tout engagement qui n’est pas codifié dans une loi demeure précaire. Les gouvernements changent, les lois restent.
Un «outil» devant les tribunaux
«Les CLOSM ne demandent pas un privilège, elles demandent d’être bien outillées sur le plan législatif afin que leur droit puisse être respecté partout au Canada», a tenu à souligner René Cormier en comité.
Pour la sénatrice Lucie Moncion, l’amendement devait assurer un financement «non pas par le fédéral, mais par tous les paliers de gouvernement, sur une longue période».
«C’est extrêmement important parce que le gouvernement fédéral met des choses en place et ensuite, quand on arrive au niveau provincial ou territorial, c’est là où le mécanisme change souvent et c’est là où […] les droits des minorités linguistiques sont brimés», a-t-elle déclaré.

L’histoire des francophones au Canada, c’est la réalité de devoir se battre constamment pour nos droits. Le sénateur Cormier a une pile d’exemples. […] Partout nous sommes devant les tribunaux parce que le Parlement n’a pas assuré la protection du droit des minorités dans la loi.
Or, tous membres du comité ne l’ont pas entendu de cette oreille.
Un amendement non nécessaire?
Pour la sénatrice Rosemary Moodie, cet amendement n’est pas nécessaire, car le projet de loi contient déjà des dispositions qui protègent les CLOSM dans l’article 7 portant sur les principes directeurs. Celui-ci mentionne les enfants «issus des minorités linguistiques francophones et anglophones» et la Loi sur les langues officielles.
La sénatrice ontarienne va plus loin en disant que l’ajout demandé par le sénateur Cormier pourrait porter préjudice. «En adoptant cet amendement, il y aurait des inquiétudes et des préoccupations de la part de certaines provinces et certainement de la part des peuples autochtones et des autres communautés. C’est un problème qu’on créerait là où il n’y en a pas actuellement.»
Cheri Reddin, directrice générale du Secrétariat de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones, a quant à elle rappelé l’absence de référence aux langues autochtones dans le projet de loi.
René Cormier s’est dit extrêmement mal à l’aise de voir des groupes et minorités mis en opposition.
Cette conversation est extrêmement importante pour l’avenir, pour nos relations avec les peuples autochtones et les minorités linguistiques de ce pays. Le gouvernement ne doit pas nous diviser, d’aucune façon que ce soit. On doit être solidaire.
«On ne demande pas davantage de financement, on demande que le financement soit maintenu. C’est là au cas où il y ait des affaires devant les tribunaux. C’est un outil, c’est tout. C’est la seule chose qu’on demande», a martelé le sénateur.
Un oubli «dangereux»
Un outil nécessaire, estime François Larocque, avocat et professeur titulaire au programme de common law français de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.

Pour l’avocat François Larocque, l’absence de mention des minorités linguistiques à l’article 8 du projet de loi créée une ambigüité dommageable.
En octobre dernier, il avait d’ailleurs recommandé au comité de reconnaitre les CLOSM dans l’article 8.
La mention des CLOSM dans les principes directeurs de l’article 7 ne garantit pas une protection totale, notamment devant les tribunaux, selon lui.
«Lorsqu’il s’agit des droits linguistiques, les cours judiciaires vont regarder ce que le texte dit. Si le texte est silencieux à l’égard des CLOSM, les cours vont inférer qu’il s’agit là de l’intention du Parlement», a-t-il assuré en entrevue avec Francopresse.
Pour lui, il était primordial de faire figurer les CLOSM dans l’article 8, déterminant dans ce texte de loi.
«Ça vient créer une brèche, un argument très fort pour un gouvernement qui dit : “non, on n’a pas d’obligation de créer des financements parce que dans l’article 8, l’article déterminant de cette obligation-là, on est silencieux à l’égard des cas.”»
On a décidé de maintenir l’incohérence et ça, c’est problématique et c’est dangereux.
Où sont les langues officielles?
Il rappelle en outre que le projet de loi C-35 devait aussi s’inscrire dans la continuité de la nouvelle Loi sur les langues officielles. Or, il remet selon lui en question le sérieux de l’engagement pris par le gouvernement.
«Dans la loi sur les langues officielles, le gouvernement s’est pourtant engagé à prendre des mesures positives pour soutenir l’éducation des CLOMS de la petite enfance au postsecondaire.»
À lire aussi : La Loi sur les langues officielles modernisée

Jean-Luc Racine regrette le manque d’engagement de la part du gouvernement fédéral.
«Grande déception»
L’amendement, soutenu par la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) et la Commission nationale des parents francophones (CNPF), a finalement été rejeté par le Comité, à 7 votes contre 4, et une abstention.
En entrevue avec Francopresse, Jean-Luc Racine n’a pas caché pas sa «grande» déception. «C’est la seule demande qu’on avait au Sénat.»
Mais le directeur général de la CNPF relativise. «On a quand même gagné, parce que quand le projet de loi a été présenté, il y avait zéro mention sur les langues officielles.»
Pour lui, l’amendement engageait les gouvernements dans le cas de nouvelles ententes. «Là, il n’y a rien de sûr.»
Plus sur la francophonie
L’inclusion des droits des minorités linguistiques dans le projet de loi C-35 relatif à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants au Canada a animé les discussions en comité sénatorial jeudi.

La proposition d’amendement au projet de loi C-35 du sénateur René Cormier a été rejetée au Comité sénatorial des affaires, des sciences et de la technologie.
Le sénateur René Cormier a demandé l’ajout d’une référence aux communautés de langue officielle en situation minoritaire à l’article 8, portant sur le maintien du financement à long terme des programmes d’apprentissage.
L’amendement a été rejeté à 7 contre 4, et une abstention.
Les membres du comité s’opposant à l’amendement ont notamment souligné que d’autres clauses du projet de loi protégeaient les droits des minorités linguistiques, jugeant ainsi que la modification n’était pas nécessaire.
Pour le sénateur Cormier, sa proposition visait strictement à maintenir le financement pour les minorités linguistiques. «Si ça ne se retrouve pas ici [dans le texte de loi] les communautés n’auront pas d’outils pour se battre pour leurs droits», a-t-il affirmé pendant le comité sénatorial des affaires sociales, des sciences et de la technologie.
À lire aussi : Petite enfance, grande pénurie de services en français
Semaine nationale de l’immigration francophone

Marc Miller réaffirme qu’une cible en immigration francophone atteignable en 2o24 permettrait une révision à la hausse pour les années subséquentes.
Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a reconnu l’importance de l’immigration francophone au Canada lors du lancement de la 11e édition de la Semaine nationale de l’immigration francophone organisée par la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA).
La semaine dernière, les organismes francophones ont manifesté leur déception à la suite de l’annonce des nouvelles cibles en immigration francophone. L’immigration francophone à l’extérieur du Québec passera de 6 % à 8 % entre 2024 et 2026. La cible de 4,4 %, établie en 2003, a été atteinte pour la première fois en 2022.
«Ces cibles, à la fois ambitieuses, réalistes et atteignables, témoignent de l’engagement du Canada à renforcer la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire, à soutenir les besoins en main-d’œuvre partout au pays et à contribuer au rétablissement du poids démographique des francophones», a indiqué le ministre dans une déclaration publiée lundi.
Conscient de la déception des francophones, Marc Miller a précisé préférer miser sur une cible atteignable en 2024 pour possiblement l’augmenter les années suivantes.
À lire aussi : Cibles en immigration : la francophonie est déçue
Par ailleurs, le ministre a octroyé mercredi un financement de près de 85 000 dollars à l’Université de l’Ontario français (UOF) pour appuyer la mise en place de l’Observatoire en immigration francophone au Canada. L’observatoire va notamment de produire de nouvelles données sur l’immigration francophone.
À lire aussi : Bientôt un Observatoire de l’immigration francophone au Canada
Division persistante sur la taxe carbone et demande de fonds d’urgence pour les médias
Le Parlement a rejeté lundi une motion conservatrice réclamant l’élargissement de l’exemption de la taxe carbone sur le chauffage au mazout à tous les types de chauffage résidentiel.

La proposition néodémocrate de suspendre la taxe sur le mazout a été défaite en Chambre.
Seul le Nouveau Parti démocratique (NPD) a appuyé la motion. «C’est un vote contre la proposition des libéraux qui divise, a indiqué le chef du NPD, Jagmeet Singh en conférence de presse lundi. On n’appuie pas l’approche des conservateurs qui n’ont pas de plan pour faire face à la crise climatique.»
Les conservateurs et les néodémocrates avancent que la suspension de la taxe sur le mazout offre un avantage aux provinces de l’Atlantique (où le mazout est une source de chauffage importante), créant ainsi une division.
La contreproposition du NPD d’éliminer la taxe de vente sur les produits et services sur toutes les formes de chauffage domestique a été défaite mercredi à la Chambre des communes.
À lire aussi : Qui défend maintenant la cause de l’environnement au Canada? (chronique)
«On demande que le gouvernement prenne des mesures immédiates et des mesures d’urgence pour nos médias d’information. La proposition du Bloc est un montant de 50 millions [comme] fonds d’urgence», a déclaré mardi Martin Champoux, porte-parole bloquiste en matière de Patrimoine.

Le bloquiste Martin Champoux réclame 50 millions de dollars en fonds d’urgence pour les médias.
Alors que la crise des médias persiste au pays, le gouvernement est toujours en négociation avec Google dans l’application de la Loi sur les nouvelles en ligne (C-18) qui vise à forcer ces géants numériques à indemniser les médias pour partager leurs contenus.
À lire aussi : Les médias francophones locaux en crise
Selon Martin Champoux, le montant demandé équivaut à trois mois des revenus dont auraient bénéficié les médias si C-18 était adopté. La loi doit entrer en vigueur dans son intégralité le 19 décembre prochain.
Le Bloc Québécois demande aussi au gouvernement de convoquer sans délai des états généraux sur l’avenir des médias.
La ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, n’a pas fermé la porte à l’idée. «On regarde ce qu’on peut faire pour le moment», a-t-elle indiqué en mêlée de presse mardi.

Le gouvernement égyptien autorise les Canadiens à rester dans le pays pour une durée maximale de 72 heures.
Évacuation des Canadiens de Gaza et des mesures de sécurité au Canada
En date de jeudi, 107 Canadiens avaient quitté Gaza mardi pour se rendre vers le poste frontalier de Rafah, en Égypte, selon Affaires mondiales Canada (AMC).
«Ils ont été rencontrés du côté égyptien de la frontière par des diplomates canadiens. Ils vont être éventuellement acheminés au Canada en toute sécurité», a expliqué la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dans une publication vidéo sur X, mardi.
Le premier groupe de Canadiens a quitté Gaza. Notre équipe de fonctionnaires les a accueillis du côté égyptien de la frontière et leur apporte un soutien. pic.twitter.com/1ekZJDP5OI
— Mélanie Joly (@melaniejoly) November 7, 2023
Israël a aussi consenti à faire des pauses quotidiennes de bombardement de quatre heures dans certaines zones de la bande de Gaza, selon une annonce des États-Unis survenue jeudi.
À lire aussi : Sans justice, il ne peut y avoir de paix (chronique)
Le gouvernement fédéral ajoute 5 millions de dollars pour la sécurité des communautés vulnérables aux crimes haineux.
«De récents évènements internationaux ont conduit des communautés du Canada à craindre, à juste titre, pour leur sécurité», a indiqué le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, lundi.
Le financement servira à protéger et renforcer la sécurité de centres communautaires, de lieux de culte et d’autres institutions.
Mercredi en mêlée de presse, Justin Trudeau a lancé un appel au calme face à la hausse de tensions liées au conflit Hamas-Israël qui ont lieu en sol canadien. «On voit une hausse d’antisémitisme qui est terrifiante», a-t-il constaté, en citant notamment des commerces juifs menacés de violence.
«Ce n’est pas qui nous sommes comme Canadiens», a-t-il poursuivi. «La montée d’islamophobie que l’on voit dans le pays et dans le monde est aussi inacceptable.»