Depuis plus de 30 ans, la communauté atikamekw de Manawan réclame que cette route soit réaménagée et sécurisée.
«Le chemin de Manawan, c’est le seul accès pour avoir des services essentiels, comme les soins de santé ou l’épicerie», explique Sipi Flamand, chef du Conseil Atikamekw de Manawan.
Mais cette route est étroite, sinueuse, et souvent très dure à utiliser. Au printemps et en automne, la pluie et la boue rendent le passage encore plus risqué… et il y a parfois des accidents.
«Les ambulanciers et les patients qu’ils évacuent vivent le danger à chaque déplacement», ajoute le chef.
À l’hiver 2022, l’état de la route a même eu un impact sur l’accès à l’eau potable. « Il y avait eu un verglas, et un des camions transportant de l’eau potable pour nous aider a été obligé de s’arrêter et de se ranger sur le bord de la route à cause de sa mauvaise condition», raconte-t-il.
En 2018, le gouvernement du Québec avait annoncé qu’il allait réparer le Chemin Manawan. Mais les travaux n’ont jamais commencé. Face à l’inaction, la communauté a décidé de passer à l’étape suivante.
En octobre dernier, le Conseil des Atikamekw de Manawan ont poursuivi le gouvernement en justice pour le forcer à améliorer la route. «On souhaite que ça fonctionne, c’est le moyen de pression le plus important qu’on a déposé jusqu’à maintenant», explique Sipi Flamand.
Pour l’instant, pas de nouvelles du gouvernement. Il faudra attendre la décision des tribunaux pour savoir si leur demande sera écoutée.
Selon Sipi Flamand, le gouvernement devrait davantage prendre en compte la réalité des communautés autochtones qui vivent en région éloignée: «la sécurité et la dignité des citoyens, autochtones comme non autochtones, doivent être traitées sur un même pied d’égalité».
Et toi, as‑tu déjà vu quelque chose dans ta ville qui serait plus sécuritaire si on le réparait?
Depuis mercredi, si un ado ou un enfant australien tente de se connecter sur un réseau social, il reçoit ce message : «Une nouvelle loi nous oblige à bloquer ton compte. Tu pourras revenir quand tu auras 16 ans.»
Cette loi force les plateformes à vérifier l’âge des utilisateurs. Et d’interdire l’entrée aux jeunes. Si un réseau social n’obéit pas, il risque jusqu’à 45 millions de dollars d’amende!
Selon le gouvernement australien, les réseaux sociaux nuisent à la santé et à la sécurité des enfants. Les autorités veulent lutter contre la cyberintimidation, la dépendance aux écrans et le risque de voir du contenu inapproprié.
Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat, Threads, X, Kick et Reddit. Et le gouvernement pourrait allonger sa liste!
Certains le sont! Plusieurs ont peur de perdre la communauté qu’ils avaient développée en ligne. Deux ados australiens essaient de faire annuler la loi devant un juge!
Plusieurs ont des doutes. Par exemple, le chercheur Vincent Paquin craint que les jeunes fréquentent les réseaux sociaux en cachette et que, s’ils y vivent des choses difficiles, n’en parlent pas. Pour lui, la clé, c’est entre autres «des conversations ouvertes entre les jeunes et les adultes qui les entourent».
Il croit aussi que 16 ans, c’est trop vieux, et qu’il faut plutôt montrer aux jeunes à être des internautes avisés, prêts à naviguer en toute sécurité!
Le gouvernement canadien étudie présentement la question. Au Québec, un comité a recommandé l’interdiction aux moins de 14 ans. Tous les yeux sont donc rivés sur l’Australie!
Et toi? Que penses-tu de cette loi?
«Pour certaines personnes, cela peut être un moment de fête, pour d’autres, cela peut représenter un vide», lâche Pierre Soucy, président de Carrefour 50+ Colombie-Britannique.
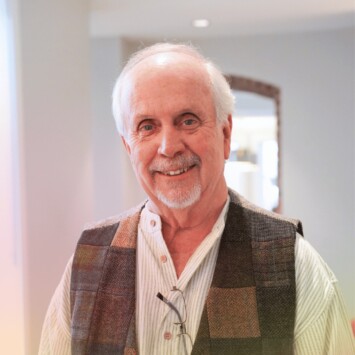
L’accès à la technologie peut aussi réduire la sensation d’isolement, remarque Pierre Soucy.
Selon lui, plusieurs variables viennent influencer le vécu des personnes ainées lors des Fêtes, à commencer par le fait de vivre seul ou seule, sans partenaire. «Les gens qui n’ont pas d’enfants ou de petits-enfants se sentent un peu plus isolés, du moins pas inclus», ajoute-t-il.
«Les gens sont partis; on a perdu des membres de notre famille ou des amis. Avec le temps des Fêtes, on pense toujours au passé», témoigne de son côté la directrice générale de la Fédération des ainé.e.s et retraité.e.s francophones de l’Ontario (FARFO), Kim Morris.
La présidente de la Fédération des aîné.e.s francophones du Canada (FAAFC), Johanne Dumas, rappelle quant à elle que «l’isolement et l’ennui, ce n’est pas exclusif au temps des Fêtes».
«Je pense que dans la période des Fêtes, comme n’importe quel groupe d’âge, si on n’est pas en famille ou entre amis, il n’y a pas de doute que pour plusieurs, c’est très difficile.»
À lire aussi : Francophones, âgés et queer : vieillir avec fierté malgré l’isolement
«Le plus on vieillit, le plus on a un désir de retrouver nos racines», remarque Pierre Soucy. Se trouver loin – géographiquement ou émotionnellement – de son lieu d’origine peut créer un manque.
Qui dit racine, dit culture et dit langue : «C’est vraiment très profond.» Même si lui-même ne recherche pas nécessairement à célébrer les Fêtes uniquement avec des francophones, Pierre Soucy admet qu’il ressent un besoin d’entendre des chansons de Noël en français.
Il évoque aussi la messe de Minuit en famille. Autant de déclencheurs de souvenirs involontaires, véritables Madeleines de Proust, dont on aimerait retrouver le gout pendant les célébrations de fin d’année.

Kim Morris rappelle que dans certains foyers de soins de longue durée majoritairement anglophones, il est difficile, voire impossible, de célébrer les Fêtes en français.
«C’est une période qui est nostalgique et le plus on vieillit, le plus on est nostalgique, note-t-il. On a de beaux souvenirs et on s’en rappelle. C’est inévitable, parce qu’on est saturé par les médias de toutes sortes d’images.»
«Quand tu regardes tout autour, c’est la belle musique et puis les films; c’est toujours la magie de la vie. On dirait que ça fait en sorte que c’est encore pire, parce qu’on voit la magie, mais on ne la ressent plus», renchérit Kim Morris.
«C’est un couteau à double tranchant : ça fait mal parce qu’on sait qu’on ne peut jamais revivre ces souvenirs-là.»
Sans oublier le stress financier. Avec des cadeaux de plus en plus dispendieux, les budgets serrés de certaines personnes âgées ne suivent pas, relève-t-elle.
À lire aussi : Le sapin de Noël naturel : une option vraiment écologique?
Claude Blaquière est président sortant de l’Association des Francophones de l’âge d’or de l’Île-du-Prince-Édouard (FAOÎPÉ). Dans la province, «la majorité des gens vivent en milieu rural. Il y a moins de services que dans les grandes villes comme à Charlottetown».
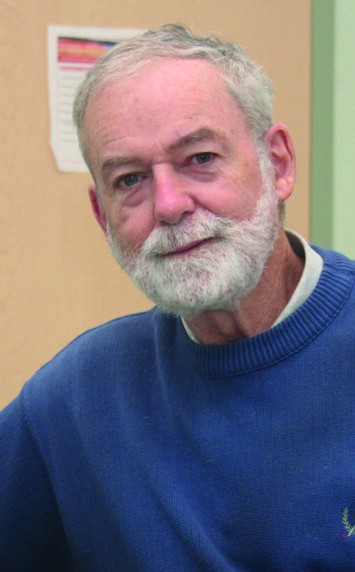
Sur l’Île-du-Prince-Édouard, l’association des ainés et ainées propose aussi des activités pour intégrer les nouvelles personnes arrivantes âgées et briser leur isolement, explique Claude Blaquière.
L’organisme essaie de sensibiliser au mieux la population grâce à son infolettre et ses différents partenariats avec d’autres organismes locaux. «On envoie des communiqués disant : “Soyez attentifs et si vous avez des préoccupations, vous pouvez toujours communiquer avec tel et tel numéro.”»
Au-delà d’informer, les FAOÎPÉ proposent différents programmes et services en français pour briser l’isolement et favoriser l’intégration des personnes ainées à la communauté. L’association présente aussi des activités pour intégrer les nouvelles personnes arrivantes âgées.
«Quand on vit dans une grande ville, on est plus anonyme. Le sens communautaire est peut-être un peu perdu», signale pour sa part Pierre Soucy.
Les membres de la communauté 2SLGBTQIA+ peuvent également se sentir plus vulnérables pendant les Fêtes. «Dans certains cas, la sortie du placard a des conséquences vraiment tragiques par rapport à la famille», signale Pierre Soucy.
Le fait d’être francophone contribue aussi à isoler les personnes âgées, notamment dans des résidences ou foyers de soins de longue durée majoritairement anglophones. «Les chansons, la culture, les tourtières : tout ce qui est culturel n’existe peu ou pas dans ces lieux», observe Kim Morris.
Celles et ceux qui ont une mobilité réduite rencontrent également des difficultés, «parce qu’ils n’ont pas un accès aussi facile aux endroits où on célèbre», souligne Pierre Soucy. «Alors ils dépendent très souvent sur d’autres personnes d’avoir la gentillesse de les accompagner.»
«Plusieurs personnes ainées ne peuvent plus conduire le soir», ajoute Kim Morris.
À lire aussi : Le défi de vieillir en français chez soi
«Il y a de plus en plus d’initiatives qui sont mises de l’avant pour aider les ainés pendant le temps des Fêtes», rassure Johanne Dumas.

Johanne Dumas souligne que les personnes ainées francophones ne ressentent pas de l’ennui et de l’isolement uniquement pendant les Fêtes.
La FARFO organise des concerts, des diners, des soupers ou des paniers de Noël livrés à domicile partout en Ontario. L’organisme propose aussi des activités et des ateliers en ligne. «Nous avons eu plus de 500 participants et participantes par mois, c’est incroyable», se réjouit Kim Morris. Des visites amicales et des appels téléphoniques sont aussi au programme.
Dans la région Évangéline, à l’Île-du-Prince-Édouard, 124 personnes sont venues pour un diner organisé par l’Association des Francophones de l’âge d’or de l’Île-du-Prince-Édouard. «C’était un repas très peu dispendieux et ça les amenait dans l’atmosphère de Noël», raconte son président sortant, Claude Blaquière.
Carrefour 50+ Colombie-Britannique offre pour sa part plusieurs activités sur son site Internet. «Certaines organisations locales organisent aussi des soupers de Noël et nous on peut aider en leur fournissant un peu de financement», explique Pierre Soucy.
Car le nerf de la guerre reste souvent l’argent. «S’il n’y a pas assez de sous pour embaucher des gens ou former des bénévoles, ça devient un grand défi», soulève Johanne Dumas.
«C’est peut-être le temps de revisiter nos traditions et de s’entourer de gens, que ce soit des parents ou des amis ou des voisins; de faire de nouveaux souvenirs», suggère Kim Morris.
Johanne Dumas souhaite que tout le monde trouve une façon de rejoindre les ainés, «non seulement de leur famille, mais aussi de leur milieu, de leur quartier, puis d’essayer le plus possible de créer des activités où on pourra créer une petite douceur dans le cœur de chacun et chacune».
Il n’y a pas de solution miracle. La solution c’est vraiment qu’on devienne tous des personnes qui portent un peu plus attention justement aux besoins des autres autour de nous.
Pour Pierre Soucy, il est essentiel de travailler avec les associations locales pour identifier les personnes isolées ou en détresse mentale. Il suggère par exemple de parrainer un ou une ainée avec des jeunes, pour leur rendre visite ou leur passer un appel. S’inspirer des bons coups des autres organismes francophones partout au pays est aussi important.
«On pourrait être plus organisé, mettre en place une chaine téléphonique avec des bénévoles ou des livraisons de repas de Noël. On pourrait faire plus de promotions de l’importance de l’inclusion pendant cette période, et pas seulement pour les personnes qui sont seules ou de 50 ans et plus, mais pour toutes celles qui sont en minorité.» Il cite celles pour qui Noël ne fait pas partie de leur culture ou de leurs traditions.
Pierre Soucy tient également à lancer un appel : que chacun et chacune pense aux personnes de sa communauté et trouve des façons de les inclure pendant le temps des Fêtes, pour qu’elles se sentent moins seules. «C’est quelque chose que l’on a peut-être tendance à oublier.»
Marc Miller, ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et responsable des Langues officielles, a réitéré jeudi l’investissement de 6 millions de dollars sur trois ans, prévus dans le budget de 2025, pour l’achat d’œuvres canadiennes en français qui seront diffusées sur la plateforme TV5MONDEplus.

Marc Miller a réitéré qu’il continuerait de se «battre» pour la langue française et le Québec, «mais pas sur le dos des immigrants qui ont aidé à bâtir cette province, incluant les anglophones et les Autochtones».
Cette initiative vise à renforcer la présence et la découvrabilité des contenus francophones canadiens dans l’espace numérique et à l’international.
«La formule de savoir qui a quoi sera dévoilée au cours de 2026», a précisé le ministre.
Ce soutien devrait compenser les pertes de revenus et permettre de maintenir la qualité de la programmation.
Le ministre Miller a réaffirmé l’importance de TV5MONDEplus au Canada, surtout dans les communautés francophones en situation minoritaire, «très minoritaire parfois» et a vanté les plus de 7 millions de visionnements depuis 2020.
Il a également annoncé l’octroi de plus d’un million de dollars à TV5 Québec Canada pour 2025-2026, ainsi que la prolongation du soutien financier temporaire à une douzaine de médias de service public, pour un total de 8 millions de dollars sur deux ans à compter de 2026-2027.
Retour sur ses propos : Marc Miller a affirmé en anglais qu’il continuerait de se «battre» pour la langue française et le Québec, «mais pas sur le dos des immigrants qui ont aidé à bâtir cette province, incluant les anglophones et les Autochtones».
À lire aussi : Feuilleton de la Colline : le déclin du français à l’avant-scène
La Cour fédérale a confirmé que Patrimoine canadien a l’obligation de consulter de façon effective les conseils scolaires francophones et de tenir compte des impacts de ses décisions sur les communautés francophones, reconnaissant ainsi un devoir fédéral en matière d’éducation des minorités linguistiques.
En revanche, elle estime que les mécanismes de transparence du financement sont adéquats et a refusé d’accorder des dommages et intérêts.
À lire aussi : Patrimoine canadien : le devoir de consultation en éducation confirmée en cour
Le gouvernement fédéral a annoncé mardi un renforcement de la règlementation sur les émissions de méthane dans le secteur pétrolier et gazier, avec des exigences accrues en matière de détection, de réparation des fuites et de ventilation.
Cette mesure s’appliquera progressivement à partir de 2028 aux installations terrestres de production, de traitement et de transport.
Le méthane, le composant principal du gaz naturel, est aussi un puissant gaz à effet de serre (GES). Sa réduction est considérée comme un moyen efficace et peu couteux de lutter contre les changements climatiques.
Un financement d’environ 16 millions de dollars est également prévu pour soutenir le déploiement de technologies de réduction du méthane.
Réduction des GES? : Ottawa estime que ces mesures permettront de réduire les émissions de GES de 304 mégatonnes d’ici 2040 pour le secteur pétrolier et gazier, et de 100 mégatonnes supplémentaires pour les décharges.
L’annonce intervient alors qu’Ottawa et l’Alberta se sont entendus pour prolonger de cinq ans l’échéancier de réduction des émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier albertain.
Cette prolongation suscite des critiques, certains observateurs estimant qu’elle pourrait réduire l’impact global des nouvelles règles fédérales.
Le Congrès des peuples autochtones (CPA) exhorte les députés à adopter l’amendement du Sénat au projet de loi S-2, qui élimine la clause de la deuxième génération de la Loi sur les Indiens. Cette clause retire le statut juridique aux descendants après deux générations consécutives de parents non inscrits.
Pourquoi? : Adopté par le Sénat le 4 décembre 2025, l’amendement permettrait de rétablir la transmission du statut par un seul parent, mettant fin à une mesure jugée discriminatoire et contraire aux droits de la personne.
Le CPA souligne que cette règle, instaurée en 1985, a entrainé la perte de droits, d’identité et d’appartenance pour de nombreuses familles autochtones.
Le projet de loi est maintenant à l’étude à la Chambre des communes. Le CPA appelle les députés de tous les partis à appuyer rapidement l’amendement afin de mettre fin à cette discrimination.
À lire aussi : «Forte et fière», la jeunesse autochtone fait entendre sa voix
Jeudi, les gouvernements fédéral et de l’Ontario ont conclu une entente visant à simplifier les évaluations environnementales des grands projets d’infrastructure prévus par le gouvernement Carney.
Ce processus d’évaluation est censé être plus simple et plus flexible pour limiter les dédoublements et accélérer les grands projets, tout en maintenant des protections environnementales élevées.
Selon les projets, l’évaluation pourra reposer sur le mécanisme ontarien ou sur une démarche conjointe avec le gouvernement fédéral. L’entente prévoit aussi l’appui de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, notamment pour la protection de l’environnement, la participation des peuples autochtones et le respect des compétences et obligations des deux ordres de gouvernement.
Une délégation canadienne d’une trentaine de personnes, comprenant six députés fédéraux et des représentants de l’organisme Canadian-Muslim Vote, s’est vu refuser l’accès à la Cisjordanie, mardi.
Parmi elles se trouvaient la députée du Nouveau Parti démocratique Jenny Kwan, les libéraux Fares Al Soud, Iqra Khalid, Sameer Zuberi, Gurbux Saini et Aslam Rana.
Malgré des démarches effectuées à l’avance et l’obtention de visas, les autorités israéliennes ont refusé l’entrée au groupe après plusieurs heures d’attente, au point de passage d’Allenby, en Jordanie.
Les membres de la délégation auraient été informés que la décision reposait sur des motifs de sécurité publique et d’ordre public, et certains ont signé un document en ce sens.
Ce refus survient dans un contexte de relations tendues entre le Canada et Israël, quelques mois après la reconnaissance par Ottawa d’un État palestinien.
La ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, a indiqué qu’Affaires mondiales Canada était en contact avec la délégation et avait émis des «contestations» auprès des autorités israéliennes.
Aujourd’hui, une délégation privée de Canadiens, qui comprenait des députés, s’est vu refuser l’entrée en Cisjordanie à un point de passage frontalier israélien. Affaires mondiales Canada est en contact avec la délégation et nous avons fait part des objections du Canada…
— Anita Anand (@AnitaAnandMP) December 16, 2025

Selon Me Lepage, cette décision est importante, car la Cour fédérale reconnait que le gouvernement fédéral a des obligations dans le domaine de l’éducation primaire et secondaire.
Dans sa décision rendue le 12 décembre, le juge Guy Régimbald de la Cour fédérale a jugé qu’il était essentiel que les conseils scolaires francophones, dont l’expertise est reconnue et protégée par la Charte canadienne des droits et libertés, soient consultés localement et de manière effective, avec un préavis suffisant.
Le juge a déclaré que le Conseil scolaire francophone provincial (CSF) de Terre-Neuve-et-Labrador doit être invité et consulté lors de toute entente ou négociation future entre les paliers de gouvernement provincial et fédéral. Une consultation aurait permis de mieux répondre aux besoins de la communauté.
«Cette décision-là est très importante, parce que ça met des comptes sur le ministre de Patrimoine canadien : il doit consulter les conseils scolaires francophones. Ça fait que c’est une reconnaissance que ce sont des organismes qui ont un fondement constitutionnel», affirme Me Robert Lepage, du Cabinet Miller Thompson en Saskatchewan.
Il explique que la Cour fédérale reconnait pour la première fois que le gouvernement fédéral a des obligations de consultation dans le domaine de l’éducation primaire et secondaire lorsqu’il est question des minorités linguistiques.
«Normalement, on prétend que les deux sont strictement du ressort provincial et que le fédéral n’a aucune obligation», précise Me Lepage.
Le litige portait sur le Programme des langues officielles en éducation (PLOÉ). La Cour a reconnu les défis «existentiels» auxquels font face ces communautés et a statué sur l’obligation de consultation prévue par la Loi sur les langues officielles.
Pas de dommages et intérêts malgré le peu de transparence
Le juge a toutefois rejeté que les mécanismes de reddition de compte de Patrimoine canadien sont «insuffisants», comme le dénonçait le Conseil scolaire. «Hormis quelques exceptions, les récipiendaires sont identifiés dans les rapports annuels», écrit le juge.
Le conseil scolaire n’avait pas pu retracer plus de 250 000 $ à cause de «ce manque de transparence», a-t-il confirmé.
Mais la Cour fédérale ne s’en choque pas, estimant qu’il est «normal» que cette somme n’ait pas pu être tracée, car «plusieurs organismes bénéficiaient des fonds PLOÉ. […] Cela explique l’incapacité du CSF à communiquer avec et identifier tous les destinataires des fonds PLOÉ».
«Toutefois, cela ne prouve pas que les fonds n’étaient pas dépensés ou que le CSF se voyait priver de fonds dont il avait droit», nuance le juge.
Il accorde ainsi le «manque de transparence» de Patrimoine canadien et du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, qui devaient tous deux attribuer des fonds au CSF. Mais il n’accorde toutefois pas de dommages et intérêts au Conseil scolaire, ce qui «déçoit» Me Lepage.
Selon lui, «la Cour ne prend pas pour acquis que Patrimoine canadien va violer de nouveau la loi sur les langues officielles. En d’autres mots, il n’y a pas un problème systémique ici. Donc, on donne la chance au gouvernement de rectifier le tir.»
Le fédéral était rentré dans les rangs à la suite de la plainte déposée par le CSF auprès du Commissariat aux langues officielles en 2015 et qui concernait l’Entente de financement de 2013-2018. C’est pour cela que le juge conclut ici qu’il n’a pas besoin d’accorder des dommages et intérêts.
Ajoutons que le juge a aussi souligné que le gouvernement fédéral est lié par les valeurs de l’article 23 de la Charte – qui garantit l’éducation dans la langue de la minorité – lorsqu’il prend des décisions touchant le CSFP.
Avec cette décision, les avocats du Conseil scolaire francophone de Terre-Neuve-et-Labrador, affirment que Patrimoine canadien pourraient se sentir davantage contraints avec cette décision, au regard de ses obligations envers les conseils scolaires des communautés de langues officielles minoritaires.
Les parties ont 30 jours si elles souhaitent porter l’affaire en appel.
Le juge Guy Régimbald a interprété cette affaire sous l’ancienne Loi sur les langues officielles, car la plainte a été déposée en 2015. De fait, les articles ciblés par l’affaire ont été depuis grandement modifiés.
Le Canada verra 733 nouveaux bureaux bilingues sur les 8750 qui offrent des services fédéraux.
Trente-neuf d’entre eux deviendront unilingues, dont 15 en français au Québec et le reste en anglais en Ontario. Par ailleurs, 534 nouveaux bureaux fédéraux ont été ajoutés en dehors des grandes villes.
Cette annonce découle des mises à jour aux règlements sur les Langues officielles à propos des communications avec le public. Les règlements encadrent l’application de la Loi sur les langues officielles modernisée en juin 2023.
Les nouveaux bureaux ont un an pour se conformer à cette nouvelle exigence. Les bureaux nouvellement unilingues ont aussi un an pour informer les communautés de langue minoritaire qui les entourent du changement.
Cette annonce survient alors que le gouvernement fédéral a signalé dans le budget de 2025 qu’il voulait réduire le nombre de fonctionnaires.
«Il va y avoir une réduction importante des employés de la fonction publique. On va créer des bureaux, mais est-ce qu’il va y avoir des gens pour y travailler? Est-ce que ça va être des services automatisés? Quelle forme vont prendre ces services?», soulève la professeure émérite à l’Université d’Ottawa, Linda Cardinal.
Le gouvernement projette de réduire les effectifs de la fonction publique d’environ 40 000 postes. Le nombre de fonctionnaires a atteint un niveau record de 368 000 personnes en 2023-2024. Au cours de la dernière année seulement, quelque 10 000 emplois ont déjà été retranchés.
À lire aussi : Budget fédéral 2025 : rien pour la francophonie
Mise à jour – 18 décembre 16h30 ***
Dans un courriel à Francopresse, le Conseil du trésor a affirmé que «toutes nouvelles embauches de fonctionnaires (…) devront rencontrer les nouveaux standards établis au niveau des compétences linguistiques»
Pour ceux qui travaillent déjà dans les bureaux désignés bilingues, le Conseil du trésor souligne que «diverses ressources» sont mises à disposition du personnel pour l’apprentissage des langues officielles, «notamment le Cadre sur la formation en seconde langue officielle du Secrétariat du Conseil du trésor».
Il confirme que ses responsabilités en vertu de la Loi sur les langues officielles incluent également «le suivi et la production de rapports sur le respect de ces obligations par les institutions», par le biais du Rapport annuel sur les langues officielles.
***

La professeure Linda Cardinal affirme que le Conseil du Trésor ne comprend pas que «l’inertie dans le domaine des langues officielles n’est pas à l’avantage de la francophonie canadienne. Ça continue de maintenir cette idée que le Conseil est un peu le parent pauvre des langues officielles.»
L’élément du temps choisi pour publier ces règlements a souvent été souligné par l’opposition pendant les comités des langues officielles.
«Pourquoi est-ce que ça prenait trois ans pour préparer les règlements découlant de la nouvelle Loi sur les langues officielles? […] On ne comprend pas les chiffres qui sont donnés. On ne sait pas sur quel type de processus ça repose […] Donc il y a toujours une certaine opacité», critique Linda Cardinal.
Elle affirme que les «éléments contingents», comme les élections et les vacances, permettent de ralentir la machine, plutôt que de l’accélérer.
«M. Carney n’a pas l’air d’être à l’aise avec des procédures qui sont trop lentes. […] On ne sait pas pour les langues officielles s’il veut que ça bouge. Mais on sait que dans les autres secteurs, il veut que ça bouge, il crée toutes sortes d’initiatives pour faire avancer les choses plus rapidement.»
À lire aussi : Français de Mark Carney : une partie de son agenda dévoilée en comité
Par ailleurs, Linda Cardinal affirme que l’annonce s’est faite dans la plus grande discrétion, sans réaction des groupes linguistiques du pays.
«On ne sait pas si c’est bien reçu dans le milieu, mais on ne peut pas non plus être contre la vertu. On ajoute 733 bureaux bilingues», indique la professeure, qui inclut «tout le travail fait auparavant pour ne pas perdre des bureaux».
«Quand il y a la révision des règlements, ç’a toujours été une inquiétude dans les milieux minoritaires que la loi du nombre influence trop l’attribution des bureaux», ajoute-t-elle.
Une inquiétude atténuée par le fait que la moitié des bureaux désignés bilingues le sont grâce à la condition qu’il y ait une école de la langue minoritaire dans le territoire qu’ils desservent.
«Ça, ça a été une avancée dans la définition du règlement», commente Linda Cardinal.
«Notre but, c’est d’être rassembleur», lance André Roy, animateur et producteur du Grand ménage des Fêtes.
Grève des enseignants en Alberta et de Postes Canada, guerre commerciale avec les États-Unis, changements climatiques, interdiction des téléphones cellulaires dans les écoles : les Newbies (Christian Essiambre, Luc LeBlanc et André Roy) reviennent une nouvelle fois sur les écrans pour passer 2025 au crible, toujours avec humour et en musique.
Cette année encore, le trio entend bien faire rire toute la francophonie, d’ici et d’ailleurs – l’émission sera diffusée sur TV5Monde. «On se ressemble tous. Peu importe d’où on se parle aujourd’hui, on vit un peu les mêmes solitudes, les mêmes débats», remarque André Roy.
Les Québécois et Québécoises ne seront pas en reste : «On veut s’assurer qu’on parle à tout le monde et qu’on n’exclue personne.»
«Si on ne parle pas aussi à eux, comment on fait pour les embarquer? […] Si tout d’un coup, le Québec, on n’en parle pas, c’est comme si on jouait à l’autruche. Puis nous autres, comme francophones minoritaires, [ça serait comme si] on n’assume pas qu’il y a une majorité. Parce qu’en se ralliant avec eux, tout d’un coup, on devient plus forts», commente l’animateur.
À lire aussi : Les Newbies et Improtéine revisitent 2024, pour le meilleur et pour le rire
Du côté d’Improtéine (Olivier Nadon, Martin Laporte, Vincent Poirier, Nadia Campbell et Stéphane Guertin), la solidarité canadienne occupe également une grande partie de l’intrigue.
Dans Improtéine Expose 2025, les cinq complices mènent toujours l’enquête dans un faux documentaire pour tenter de déchiffrer une obscure prophétie annonçant l’effondrement du pays lorsque les six piliers de la société canadienne s’écrouleront… Leur devoir : agir pour sauver le pays. Rien de moins.
«Notre plaisir, c’est d’aller trouver les fausses raisons derrière toutes les nouvelles. Ça fait qu’on s’amuse beaucoup comme ça», confie Vincent Poirier en entrevue avec Francopresse. Quitte à passer pour de vrais faux complotistes quand les fausses nouvelles se rapprochent de la vérité.
«Des fois – surtout en politique –, il y a des choses ridicules qui se passent et on n’est pas trop loin d’une réalité parallèle», plaisante-t-il.
Pour l’écriture de l’émission, les nouvelles ne se sont pas fait attendre. «Il y a des années où on est rendu au printemps pis on se dit : “Mince, il semble qu’il n’y a rien de gros, rien de frappant”. Mais cette année, dès le 6 janvier, Trudeau a démissionné», raconte Vincent Poirier.
«L’actualité était très nationale, très politique, très globale, note de son côté Nadia Campbell. Ça a été plus difficile d’aller trouver ou de cibler les “petites nouvelles”, parce que notre intérêt national était vraiment sur ce qui se passait au sud du Canada.»
On est francophones, mais on est aussi Canadiens. Notre grande bataille, ça a été de défendre notre côté canadien contre les États-Unis plutôt que notre côté francophone contre les anglophones.
Mais cela n’a pas empêché l’équipe de parcourir le pays d’un océan à l’autre, de l’Alberta au Nouveau-Brunswick, en passant par l’Arctique. Coco Belliveau, Georges Laraque ou encore Alain Rayes se sont également prêtés au jeu du groupe franco-ontarien.
Dans le Grand ménage, le mot Canada revient souvent, et «c’est voulu», confirme André Roy. «S’il y a une chose qui est ressortie cette année, c’est comment nous, comme citoyens canadiens, on réagit quand il y a une menace. Ça a changé un peu nos habitudes, ça nous a requestionnés sur nos valeurs, nos façons de faire.»
«Le numéro d’ouverture, pour moi, c’est un choix éditorial», précise-t-il. Pas de divulgâche, mais les Newbies se sont rendus à Ottawa pour rencontrer une personne, disons, haut placée…
La solidarité se ressent aussi sur scène et dans les prestations musicales de l’émission, où les artistes jouent et chantent ensemble. Une belle harmonie, dans tous les sens du terme, avec parfois quatre mains sur un piano.

Pour la première fois, les Newbies ont dévoilé lors de leur phase de promotion un extrait d’une chanson sur le réchauffement climatique qui a été envoyé aux radios partout au Canada, Y fa chaud bro!, accompagnés de Gildor Roy et Fabiola Nyrva Aladin.
Tournée à Moncton, Le grand ménage des Fêtes réunit autour des Newbies de nombreux invités et les artistes Mentana (Acadie-Québec), Vishtèn (Île-du-Prince-Édouard) Damien Robitaille (Ontario) et Maude Cyr-Deschênes (Nouveau-Brunswick), gagnante de La Voix 2024, qui assurent l’ambiance musicale.
«C’est vraiment dans cet esprit-là d’une troupe. Il y a plein de comédiens qui apparaissent, qui disparaissent […] Je pense que les gens vont taper du pied et des mains en même temps en regardant l’émission», espère André Roy. On n’en doute pas.
Improtéine Expose 2025 sera diffusée le 31 décembre à 18 h 05 (HE) sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV pour les téléspectateurs et téléspectatrices d’Ottawa-Gatineau, de l’Ontario et de l’Ouest.
La revue sera diffusée à l’ensemble du pays le 1er janvier 2026 à 1 h 30 sur ICI TÉLÉ et ICI.TOU.TV, ainsi qu’en rediffusion le 4 janvier à 21 h HE sur ICI TÉLÉ, et à 19 h 30 HA sur ICI TÉLÉ Acadie.
Le grand ménage des Fêtes sera diffusé le samedi 20 décembre à 20 h (HE) sur Unis TV et sera aussi disponible sur le site Web TV5Unis.
Tout a commencé quand un citoyen a lancé un défi au ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, John Dornan. Lequel? Aller attendre à l’urgence de l’hôpital de Moncton, au Nouveau-Brunswick, comme n’importe quel patient.
Le ministre a accepté et a finalement passé deux journées de 12 heures à l’urgence, les 14 et 15 novembre dernier, pour un total de 24 heures.
Là-bas, il a vu des gens fatigués, inquiets et parfois découragés. «Les gens qui attendent ont peur de perdre leur place, s’ils quittent la salle d’attente. Donc ils restent là, et ce n’est pas confortable», a-t-il expliqué au journal Acadie Nouvelle.
Le ministre dit avoir trouvé l’attente très longue… alors qu’il est en forme. «Depuis cette expérience, j’éprouve davantage d’empathie pour les personnes qui sont malades et qui doivent attendre longtemps. Nous devons faire mieux», a-t-il affirmé.
Au Nouveau-Brunswick, il faut attendre environ 4 heures et demie à l’urgence avant de voir un médecin. Mais à certains endroits, c’est encore plus long. Par exemple, à l’hôpital de Moncton, des patients doivent parfois attendre jusqu’à 19 heures.
Beaucoup de personnes viennent à l’urgence parce qu’elles n’ont pas d’autre option. Si elles n’ont pas de médecin de famille ou n’ont pas accès à une clinique, elles doivent se tourner vers l’urgence de l’hôpital, même pour des problèmes qui ne sont pas graves. Résultat? Les salles d’attente se remplissent beaucoup plus vite et tout le monde doit patienter plus longtemps.
Après ses 24 heures à l’urgence, John Dornan a affirmé qu’il voulait améliorer le système de santé. Il souhaite l’ouverture de plus de cliniques collaboratives au Nouveau-Brunswick.
Ces cliniques, ce sont des endroits où plusieurs professionnels de la santé (infirmières, médecins, psychologues…) travaillent ensemble. L’idée est simple : permettre aux gens de recevoir de l’aide rapidement, sans avoir à aller à l’urgence pour le moindre petit bobo!
Source : Acadie Nouvelle
Se chauffer et cuire un repas quand on n’a pas d’argent, de logement, d’électricité, c’est un réel défi. On a donc pensé à un poêle très simple : il est fait à partir d’une boîte de conserve dans laquelle on allume un feu pour chauffer la nourriture. Pendant qu’on cuit notre repas, on peut aussi y placer des roches.
Elles emmagasinent de la chaleur. Au moment d’aller se coucher, on les récupère pour garder nos mains et nos pieds au chaud dans la tente. Nos ancêtres faisaient ça! On peut se chauffer ainsi pendant environ deux heures.

L’équipe du Laboratoire d’ingénierie pour le développement durable et les poêles qui ont été distribués à la Nuit des sans-abris le 17 octobre dernier à Montréal. Monsieur Philippe est à droite.
Ça te surprend parce qu’à notre époque, le réflexe est souvent de répondre à tous les problèmes par une nouvelle technologie, si possible plus compliquée que la précédente. Et qui finit souvent au dépotoir parce qu’on n’arrive pas à la réparer. Nous, on a plutôt visé la low-tech. C’est une façon de se servir de la technologie pour développer des solutions simples qui vont vraiment répondre aux besoins des gens.
Oui. Il fallait un objet facile à fabriquer, à utiliser, à transporter, à réparer… De là est né notre petit poêle. Mais on n’a rien inventé. Il est fait avec des matériaux gratuits et faciles à trouver dans la rue : des boîtes de conserve. On n’a pas besoin d’outils pour le fabriquer et on brûle ce qui est disponible dans la rue (bois, carton, journal). Pas besoin de carburant polluant et explosif. Mais je rappelle qu’il ne faut pas faire le feu dans la tente! Ce serait dangereux.
Nous donnons des ateliers sur le terrain. C’est très facile à fabriquer et ça ne prend que 20 minutes. Nous avons aussi préparé des plans gratuits, sans mots, avec des illustrations. C’est très important que les personnes se sentent autonomes et compétentes. Il y a même des groupes de retraités qui se sont mis à fabriquer des poêles! Ils les donnent à des campements près de chez eux.
Les besoins sont nombreux chez les personnes en situation d’itinérance. Être au sec et faire sécher ses habits en est un. L’été, la conservation des aliments est un vrai défi. Pour l’instant, nous n’avons rien de concret, mais on garde toujours les trois principes du low-tech en tête :
1. Répondre à de vrais besoins;
2. Concevoir des objets simples et accessibles qui sont faciles à réparer;
3. avec le moins d’impacts négatifs sur l’environnement et le plus d’impacts positifs sur la société
Et toi, as-tu déjà participé à une activité pour aider les gens dans le besoin? Raconte-moi!