Je dois l’avouer, je n’aimais pas beaucoup l’école. Mes parents étaient exigeants et leurs attentes me mettaient de la pression. Je crois que c’est le stress que je n’aimais pas de l’école, au fond. Mais ce qui me motivait énormément, ce qui me donnait envie d’y aller tous les matins, c’était mes amis et les activités dans lesquelles j’étais impliquée. Les projets, c’était mon moteur! Journal étudiant, comité environnement, comité social, j’y trouvais mon énergie pour persévérer dans mes études. En fait, j’ai puisé ma motivation dans tout ce qui était à l’extérieur de la classe! Ça peut paraître bizarre, mais pour moi, c’est vraiment ce qui m’a accrochée à l’école!
Au primaire, j’ai changé d’école CINQ fois! Les rentrées scolaires étaient donc très stressantes, puisque je devais toujours me faire de nouveaux amis et parce que je devais créer de nouveaux repères. Aller à l’école devenait pénible, puisque j’étais rongée par l’anxiété! Ce qui m’a aidée :
Au primaire et au secondaire, j’avais beaucoup de difficulté à me concentrer en classe… et avec les mathématiques! Pour m’aider, j’allais en récupération et un tuteur venait m’aider avec mes devoirs chaque semaine. Ce qui m’a poussée à persévérer, ce sont les encouragements de ma famille et de mes amis. Je me suis aussi impliquée dans des projets qui me motivaient vraiment, comme un voyage scolaire de coopération en Équateur! Au secondaire, j’ai aussi pu choisir des cours qui me ressemblaient plus. Et avec le temps, j’ai pris confiance en moi. En plus, un de mes anciens tuteurs est devenu un de mes meilleurs amis!
Kuei! Pour moi, la persévérance, ça me ramène en 6e année. Je pleurais à chaudes larmes parce que je ne comprenais rien aux divisions. Pendant que les autres allaient jouer dehors, je restais avec mon enseignante pour essayer encore. J’ai souvent pleuré. Je me sentais découragée. Mais je voulais tellement comprendre que je n’ai pas abandonné. Enfin… pas au primaire. Mais des circonstances ont fait que je n’ai pas réussi à terminer mon secondaire.
Mais une fois adulte, j’ai décidé de retourner à l’école pour terminer mon diplôme d’études secondaires. Ce n’était pas toujours facile de reprendre les cahiers et de me remettre en mode «élève», mais je l’ai fait! Et aujourd’hui, à 36 ans, je suis encore étudiante à l’université! Et je suis devenue une ambassadrice de la Semaine de la persévérance scolaire. Eh oui!
La persévérance, ce n’est pas réussir du premier coup. C’est accepter que ça prenne du temps et continuer quand même. Alors même si quelque chose te semble difficile en ce moment, rappelle-toi que tu as le droit d’apprendre à ton rythme. L’important, c’est de ne pas abandonner tes rêves.
Et toi, qu’est-ce qui te motive à persévérer quand c’est plus difficile à l’école?
Sans aucun doute, l’allocution du premier ministre canadien était bien écrite, bien rendue, courageuse et empreinte de réalisme; ou de pragmatisme, comme il le dit souvent. Il a dit tout haut ce que beaucoup de chefs d’État semblent avoir de la difficulté à comprendre ou à accepter – du moins en public. Soit qu’il n’y a plus de grandes puissances économiques qui travaillent dans un esprit de collaboration.
Il ne faut cependant pas oublier où et devant qui ce discours a été fait. Le Forum économique mondial de Davos est une conférence sur le développement économique. Des milliers de chefs et cheffes d’État et d’entreprises y sont invités pour échanger sur la «croissance, la résilience et l’innovation», est-il écrit sur le site du Forum (traduction libre).
Les phrases coup de poing et les envolées lyriques de Mark Carney créaient une carte au trésor où le «X» était mis en évidence. S’il a peint l’image d’un monde où les relations internationales sont en pleine rupture et que les grandes puissances imposent l’instabilité, c’était pour mieux présenter le Canada comme un pays stable, fiable, où il est prudent d’investir.
À lire aussi : Commerce interprovincial : le Canada avance, tarifs ou non
Entre les constats politiques, il y avait plusieurs listes sur ce que le Canada a, ce que le Canada est. Le terme «we have» («nous avons») revient neuf fois dans le discours. Le terme «we are» («nous sommes») revient 18 fois en lien avec ce que le Canada fait ou représente.
Qu’est-ce que «nous avons», selon Mark Carney? Des baisses d’impôts, des ententes stratégiques existantes, la population la plus éduquée du monde, des capitaux, du talent et un gouvernement prêt et capable d’agir de façon décisive. Surtout, le «Canada a ce que le monde veut».
Ce que «nous sommes», toujours selon le discours? Une superpuissance énergétique, un pays qui collabore déjà avec les autres pays de la planète et qui entend poursuivre sur cette lancée. Et surtout, «un partenaire stable – dans un monde qui est tout sauf stable – qui construit et apprécie les relations à long terme».
Cette liste, qui présente l’économie canadienne de façon favorable, est avant tout un argument de vente destiné aux investisseurs et aux élus et élues assis dans la salle devant lui. Ce n’est pas un appel à la résistance.
Il vaut la peine de le répéter : il a fait le portrait d’un Canada clairement défini dans l’image d’un monde flou et imprévisible.
Son invitation à collaborer entre pays de taille moyenne plutôt que de construire chacun sa forteresse joue le même rôle : inclure le Canada dans la grande forteresse en investissant dans nos ressources naturelles.
À lire aussi : L’Afrique est-elle une alternative viable aux États-Unis pour le Canada?
Les hommes et les femmes d’affaires ont très probablement décelé ce discours dans le discours. Le directeur général des politiques économiques et énergétiques au Forum des politiques publiques du Canada, Jay Khosla, confirme l’intention de l’allocution dans un article de la Presse canadienne. Il dit que «M. Carney semble présenter le Canada comme un pays “en pleine croissance économique”».
Il ajoute qu’il aurait aimé que le premier ministre parle davantage des mesures d’accélération des projets nationaux. Des projets qui pourraient stimuler les investissements.
Ce que Mark Carney a dit dans son allocution, tous ceux et celles qui suivent de plus ou moins près la politique canadienne l’avaient déjà entendu. L’idée de ne plus se fier aux États-Unis, d’élargir les partenariats économiques, de regarder ailleurs, de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, l’électorat canadien connait cette vision. Le premier ministre l’a simplement présentée au reste du monde économique.
C’était donc un discours plus économique que politique, avec une dose de pragmatisme…
En ces instants charnières, nous devons nous tourner vers les valeurs qui nous unissent ici, chez nous, et qui renforcent notre présence à l’étranger – ces valeurs qui font notre force. Conjugué à la réconciliation et au multiculturalisme, le bilinguisme officiel est au cœur de notre identité. En tant que Canadiennes et Canadiens, nous ne devons jamais laisser les pressions politiques ou les contraintes économiques éroder ces valeurs qui nous définissent.
Garantir le soutien des droits linguistiques n’est pas un choix difficile. C’est la pierre angulaire de notre politique linguistique durement acquise, qui est portée par nos valeurs communes et qui constitue une source inépuisable de fierté nationale.
À une époque où les droits linguistiques sont renforcés dans la société canadienne, il est crucial de préserver la capacité du gouvernement fédéral de servir la population canadienne dans la langue officielle de son choix et de protéger sans relâche les communautés de langue officielle en situation minoritaire qui sont présentes dans chaque province et territoire.
Le respect des droits linguistiques repose ultimement sur la volonté politique et le leadership. Il s’agit d’une double responsabilité de veiller au respect des droits linguistiques des Canadiennes et des Canadiens aujourd’hui et de préserver notre identité linguistique et culturelle dans l’avenir.
Je me souviens du sentiment que j’ai éprouvé en tant que jeune francophone au Manitoba, en 1969, lorsque ma langue et ma culture ont été pour la première fois reconnues, protégées et même célébrées. Au milieu d’une crise d’unité nationale, des dirigeants francophones et anglophones s’étaient réunis pour parvenir à une des réalisations législatives déterminantes au Canada : la Loi sur les langues officielles.
Nous l’oublions parfois, mais, sans cette loi, le Canada tel que nous le connaissons aujourd’hui n’existerait tout simplement pas. Elle a contribué à concrétiser le rêve d’un projet politique distinct en Amérique du Nord – une démocratie parlementaire bilingue qui comprend des protections pour les communautés linguistiques en situation minoritaire. Heureusement, nous avons maintenant aussi la Loi sur les langues autochtones qui vise à aider à se réapproprier, à revitaliser, à maintenir et à renforcer les langues autochtones et à prévenir les pertes culturelles.
En tant que Canadiennes et Canadiens, nous reconnaissons les droits linguistiques, que ce soit pour le français, l’anglais ou les langues autochtones, comme des droits individuels et collectifs fondamentaux qui sont nécessaires à notre démocratie.
Aujourd’hui, nous avons une Loi sur les langues officielles actualisée pour s’inscrire dans la modernité et qui intègre un changement majeur adopté il y a tout juste deux ans : elle reconnaît sans détour la vulnérabilité du français au Canada et en Amérique du Nord dans son ensemble.
Après l’anglais, le français est toujours de loin la langue la plus répandue au Canada – y compris à l’extérieur du Québec – et c’est, bien sûr, la langue courante au Québec. L’influence internationale écrasante de l’anglais a toutefois des répercussions sur tout ce que nous disons et faisons en français, particulièrement dans un univers numérique où les algorithmes et l’intelligence artificielle intensifient la présence de plus en plus dominante du contenu culturel anglais américain dans les médias d’information et d’actualité en ligne. C’est une préoccupation non seulement pour le français au Canada, mais pour les langues minoritaires dans le monde entier.
Alors que je m’apprête à tourner la page, j’aimerais vous partager quelques réflexions finales sur les langues officielles au Canada.
En tant que société, nous devons protéger le bilinguisme officiel pour préserver non seulement nos langues elles-mêmes et notre façon de les exprimer, mais aussi les cultures auxquelles elles sont intimement liées. Nos cultures.
Pour les francophones, la reconnaissance du français permet de s’identifier à la plus vaste communauté politique du Canada, bien que l’anglais soit la langue majoritaire au pays globalement. Le soutien du bilinguisme officiel au sein de la population canadienne est resté constant, notamment chez les personnes issues de divers milieux culturels. La population canadienne convient que la présence de deux langues officielles, au lieu d’une seule, favorise l’ouverture à la diversité et confère un avantage sur la scène internationale.
Par ailleurs, la cohabitation des francophones et des anglophones nous a enseigné l’art de coexister dans la diversité et les différences. Elle nous a libérés des entraves de l’homogénéité culturelle et de l’isolement, elle a fait de nous un peuple meilleur que ce que nous aurions pu être autrement. Cela, en soi, confère tout son sens au bilinguisme officiel.
Pourtant, trop peu de Canadiennes et de Canadiens sont conscients de l’existence même de nos communautés de langue officielle en situation minoritaire dynamiques, qui incluent les communautés anglophones au Québec et les communautés francophones dans tout le Canada. Nous n’avons pas suffisamment fait la promotion du fait que les deux langues sont parlées dans tout le pays et pas uniquement dans une seule province.
Les communautés de langue officielle en situation minoritaire incarnent la preuve tangible que nous n’avons pas à être tous identiques. C’est grâce à leur présence dans tout le pays que nous savons que des personnes de langues et de cultures différentes peuvent cohabiter et bâtir ensemble une nation inclusive et fondée sur des valeurs fondamentales partagées plutôt que sur un héritage ethnique commun.
Les Québécois d’expression anglaise veulent se sentir chez eux dans leur province et avoir la pleine reconnaissance de leurs droits et de leur rôle constructif dans la promotion du français au Québec et du bilinguisme au Canada. Pour réduire les clivages et renforcer la compréhension, il faut multiplier les interactions positives entre les francophones et les anglophones, tant au Québec que dans le reste du Canada.
Les communautés francophones en situation minoritaire hors Québec montrent par leur persévérance que les deux langues officielles peuvent coexister pleinement aux quatre coins du pays. Ces communautés sont résilientes et contemporaines; elles ne ressemblent en rien au village où j’ai grandi. Elles évoluent, se diversifient et s’adaptent en phase avec les changements sociétaux. Leur situation démographique demeure toutefois fragile. Il est maintenant plus que jamais essentiel d’offrir des occasions continues d’apprendre et d’utiliser le français, de la garderie à l’enseignement supérieur, pour assurer la transmission de cette langue à la prochaine génération.
À cette fin, la majorité francophone du Québec doit pouvoir constater que la langue française est valorisée et respectée au niveau fédéral et que son rôle de langue principale dans la vie sociale québécoise est confirmé. Veiller à la pertinence continue du français à l’échelle internationale et à l’engagement du Canada envers la francophonie démontre que langue et culture bénéficient d’une reconnaissance authentique chez nous, y compris au Québec.
De son côté, la majorité anglophone hors Québec doit continuer de se percevoir comme faisant partie intégrante du projet sociétal pancanadien qu’est le bilinguisme officiel. Bien qu’il soit largement admis que le français et l’anglais sont nos langues officielles, il faut encourager leur usage, notamment par l’accès à l’enseignement du français langue seconde et aux programmes d’immersion pour les jeunes anglophones afin qu’eux aussi profitent des avantages du bilinguisme.
Il importe aussi de renforcer les relations entre francophones et anglophones bilingues à l’échelle canadienne pour offrir davantage d’occasions aux deux communautés de s’exprimer en français de façon constructive au quotidien.
Ce fut un immense honneur de servir en tant que commissaire aux langues officielles, avec pour mandat de protéger et de promouvoir les droits linguistiques de la population canadienne. J’ai eu l’incroyable chance de travailler aux côtés de membres de la communauté, de décideurs et de parlementaires de ce grand pays qui façonnent le présent et l’avenir de nos langues officielles.
J’ai aussi pu constater un fait : deux langues qui alimentent la conversation nationale – deux langues d’intégration – d’un océan à l’autre contribuent à faire du Canada une nation plus grande que la somme de ses parties.
Le bilinguisme officiel fait partie de notre passé, de notre présent et de notre avenir, et c’est l’une des caractéristiques les plus distinctives de ce qui fait de nous des Canadiennes et des Canadiens. Pendant que nous réinventons un Canada uni, indépendant et fort, engageons-nous à reconnaître, à soutenir et à célébrer la force unificatrice de nos langues officielles aujourd’hui et pour les générations à venir.
La tradition de choisir une présidence du jury issue des personnes nommées l’année précédente se poursuit. Pour le Palmarès de 2025, la professeure et chercheuse de la Saskatchewan Anne Leis a accepté cet honneur.
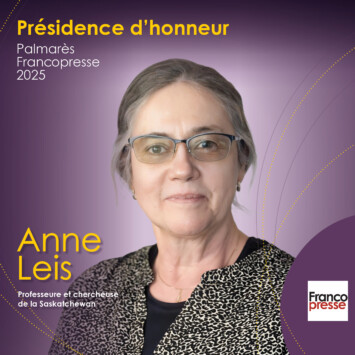
Anne Leis a accepté d’être la présidente du jury pour l’édition 2025 du Palmarès.
«Les candidatures étaient impressionnantes et ont vraiment marqué le jury. C’est beau de voir autant de personnes dévouées qui font avancer la francophonie partout au Canada! C’était la première fois que le jury recevait des candidatures provenant de la Colombie-Britannique et elles ont fait une entrée remarquée au Palmarès. Nous espérons qu’il y aura encore plus de candidatures l’an prochain de toutes les régions du pays pour pouvoir célébrer les talents, les réalisations et le leadeurship d’un bout à l’autre du pays», déclare Anne Leis.
Les candidatures ont été soumises par les journaux francophones en milieu minoritaire des quatre coins du pays. Un jury composé de quatre personnalités des éditions antérieures a eu la tâche de sélectionner les dix personnalités remarquables de 2025 qui ont brillé pour leur contribution à la francophonie canadienne.
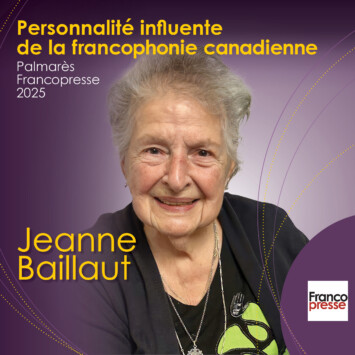
À 90 ans, Jeanne Baillaut a lancé son troisième recueil de poésie, en décembre 2024. Cette pionnière de la francophonie de la Colombie-Britannique prévoit lancer un autre livre en 2026. Dès son arrivée à Vancouver, avec son mari, en 1958, Jeanne Baillaut s’est consacrée à l’enseignement du français. Elle a créé un programme d’apprentissage par les œuvres d’art du Musée des beaux-arts de Vancouver. De 1975 à 1985, elle a été directrice de ce qui deviendra plus tard le Centre culturel francophone de Vancouver. Dans ce poste, elle a entre autres créé le premier festival francophone de Vancouver. Elle n’a pas arrêté par la suite de faire ce qu’elle aime : éduquer, écrire et jardiner, toujours en français.

Une bonne partie du succès du Programme spécialisé en arts de Toronto de l’École secondaire catholique Saint-Frère-André est attribuable à Billy Boulet-Gagnon, qui en est le directeur artistique depuis 2018. Il encourage les jeunes à développer leur propre talent de façon quasi professionnelle. Il a allié formation des élèves et création d’évènements culturels ouverts au grand public. L’auditorium de l’école, partagé avec l’École secondaire Toronto Ouest, est devenu un lieu de rassemblement pour la francophonie torontoise. Le Programme a aussi été un catalyseur pour augmenter les inscriptions à l’École Saint-Frère-André. En parallèle, Billy Boulet-Gagnon met à profit ses talents musicaux lors d’évènements artistiques francophones communautaires.
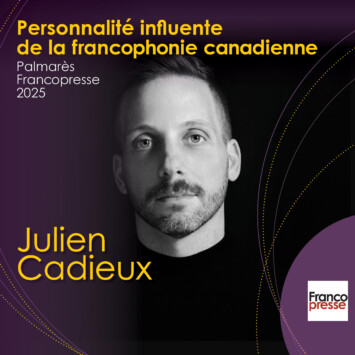
Le réalisateur Julien Cadieux a remporté en novembre le prix de la Meilleure œuvre acadienne et le Prix du public lors du Festival international du cinéma francophone en Acadie pour son documentaire Amir mon petit prince. Ce n’est que le plus récent honneur pour le cinéaste du Nouveau-Brunswick. Avec ses films, comme Y’a une étoile, Une rivière métissée et Les mains du monde, il montre l’importance qu’il accorde à la représentativité et au mieux-vivre ensemble. La diffusion de ses documentaires dans des festivals partout dans le monde fait également rayonner l’Acadie et la langue française.
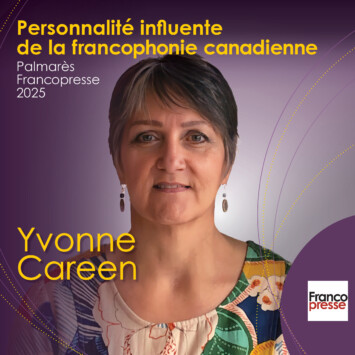
Photo : Courtoisie
Après 35 années à se battre pour améliorer l’expérience et la vie des élèves francophones dans les Territoires du Nord-Ouest, Yvonne Careen a annoncé sa retraite de la direction de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest. Sa carrière a été saluée en grand par les élèves de l’École Allain St-Cyr en mai. Cette école qu’elle a aidé à fonder fêtait justement ses 35 ans. Sa longue bataille judiciaire pour un gymnase dans cette école lui avait valu une première apparition au Palmarès de Francopresse en 2018. La Fédération franco-ténoise et le Regroupement national des directions générales de l’éducation l’ont aussi honoré au cours de sa carrière.

Chantal Fadous est une francophone passionnée originaire du Liban. En 2025, elle a été l’une des 50 coautrices d’un livre sur des femmes inspirantes du grand Vancouver, dans lequel elle met de l’avant l’importance du bénévolat et de la langue française. Après son installation au Canada il y a 16 ans, elle a choisi de s’engager dans la vie francophone. Elle a commencé par faire de la suppléance dans un programme de prématernelle, mais ne s’est pas arrêtée là. En plus d’être restée en éducation, allant jusqu’à occuper la vice-présidence du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, elle a notamment appuyé des familles immigrantes et a été présidente de la Société francophone de Maillardville en Colombie-Britannique.
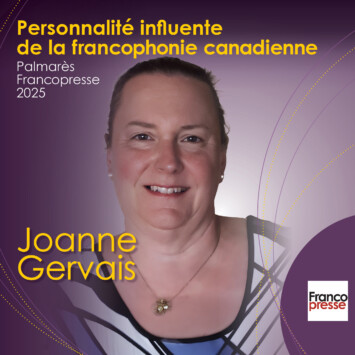
Joanne Gervais est la force tranquille derrière de nombreuses avancées pour la francophonie du Grand Sudbury, en Ontario. La directrice générale de l’Association canadienne-française de l’Ontario du grand Sudbury a rassemblé la francophonie locale et provinciale pour organiser les célébrations du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien le 25 septembre 2025 à l’Université de Sudbury, où a eu lieu le premier lever de ce puissant symbole franco-ontarien. Dès 2021, elle a milité aux côtés de cette même université pour la réouverture de cet établissement postsecondaire «par et pour» les francophones, ce qui s’est concrétisé en septembre 2025.
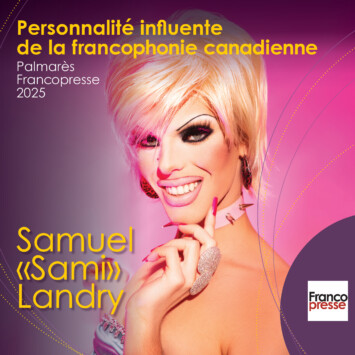
Samuel Landry dans la peau de son personnage Sami Landri.
Samuel Landry profitait déjà d’une popularité impressionnante sur les réseaux sociaux grâce à son alter ego : la dragqueen Sami Landri. Sa notoriété a explosé en fin d’année quand il est devenu le premier Acadien à participer à la populaire émission Canada’s Drag Race. Sur TikTok, ses vidéos – en français – ont été vues des millions de fois. Ses vidéos, ses spectacles, sa série Web Helpez-moi et l’émission DRAG! d’la tête aux pieds qu’il coanime contribuent à rendre la culture queer visible et accessible en français, en plus de faire connaitre le chiac, la culture acadienne et les luttes pour la diversité et l’identité.

Monique Levesque, éducatrice originaire du clan yändia’wich de la nation wendate au Québec, s’est engagée activement dans le rapprochement et la réconciliation entre les Premières Nations et les Franco-Yukonais. En 2025, elle a offert des ateliers de perlage qui ont été l’occasion de parler des traumatismes du passé et de guérison et elle a livré un exposé public qui invitait à réfléchir aux gestes que peut poser la communauté francophone pour soutenir la vérité et jeter des ponts. Dans son parcours personnel, elle apprend le wendat. Elle mène tous ces efforts de front avec son travail de directrice adjointe d’une école d’immersion et ses heures de bénévolat pour les activités francophones.
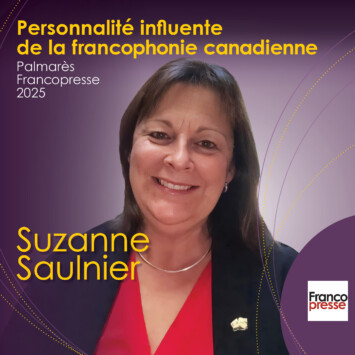
L’ouverture d’une nouvelle garderie à Pomquet, dans l’est de la Nouvelle-Écosse, en juin 2025 témoigne du travail acharné mené par Suzanne Saulnier en faveur du développement de la petite enfance en français en Nouvelle-Écosse. Directrice générale du Centre d’appui à la petite enfance de la Nouvelle-Écosse depuis sa création en 1992, elle ne cesse de travailler pour l’unité, l’excellence et la durabilité de ce secteur dans la province. Elle a mis l’accent sur les partenariats et la création de garderies pour veiller à ce que les enfants aient le meilleur départ possible pour leur éducation en français.
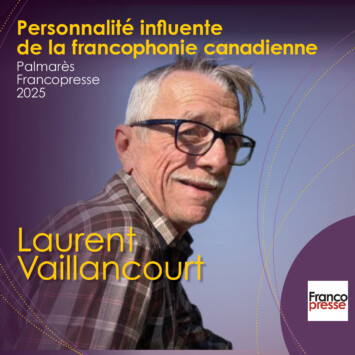
La médaille du couronnement du Roi Charles III décerné à Laurent L. Vaillancourt en aout 2025 atteste du demi-siècle – et plus – d’engagement et de création de ce sculpteur autodidacte, qui a également touché au dessin et à la scénographie. Ses expositions, souvent ancrées dans le territoire nord-ontarien, ont parcouru les provinces canadiennes de l’Est ainsi que la Colombie. Laurent L. Vaillancourt a aussi aidé à structurer son domaine; il est entre autres membre fondateur du Bureau des regroupements des artistes visuels de l’Ontario (BRAVO) et de la Galerie du Nouvel-Ontario, à Sudbury. Il est également fier instigateur et actuel vice-président de l’Écomusée de Hearst, en Ontario.
Méthodologie
Les candidatures au Palmarès des personnalités influentes de la francophonie canadienne de 2025 ont été soumises par les médias écrits de langue française en milieu minoritaire de partout au Canada.
Un jury composé de quatre personnes nommées au Palmarès entre 2021 et 2024, dont la présidente de l’édition de 2025, a évalué les candidatures et fait une sélection par consensus à la mi-décembre.
Le jury a tenu compte de l’influence des candidats et candidates sur la francophonie de leur région dans leur domaine respectif et s’est aussi laissé guidé par un souci de représentativité des régions du pays et de la diversité de la francophonie.