Presque tous les médias se demandent en ce moment comment utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour maximiser l’efficacité de leur fonctionnement. De quelle façon peut-elle servir à améliorer la couverture médiatique, à accélérer le travail, à accroitre l’auditoire et à augmenter les revenus?
Or, il est impossible de se poser ces questions en faisant fi du fait que cette technologie existe grâce aux contenus qu’elle a volés, que ses immenses centres de données polluent énormément et que les hallucinations qu’elle génère donnent l’impression qu’elle est alimentée aux champignons magiques.
Pour les médias en milieu minoritaire, un défi s’ajoute. La performance des grands modèles de langage (GML) – les ChatGPT, Gemini et Claude de ce monde qui peuvent produire des textes – est supérieure lorsqu’ils ont été entrainés à partir d’une grande quantité d’information.
L’information qui existe sur le Web concernant les communautés francophones en milieu minoritaire est cependant loin de répondre aux critères de ce qui constitue une «grande quantité d’information».
Les GML sont plus performants maintenant qu’ils peuvent parcourir le Web et voler du contenu en temps réel. Malgré cela, ChatGPT a répondu à une requête toute récente que Michel Ouellette avait fondé le Théâtre du Nouvel-Ontario de Sudbury, en Ontario.
Pourtant, en 1971, année de fondation du Théâtre, Michel Ouellette avait 10 ans et vivait à Smooth Rock Falls, à 400 km au nord de Sudbury.
En toute transparence : d’autres GML à qui la même requête a été soumise ont fourni une bonne réponse, soit que le Théâtre a été fondé par un collectif de jeune issu de l’Université Laurentienne, dont André Paiement. L’un des modèles interrogés précise même avoir pris de l’information auprès de sources fiables, comme Francopresse…
À lire : Intelligence artificielle : les véritables enjeux au-delà des craintes
Chaque média doit trouver la limite qu’il ne veut pas franchir quant à la production de contenu et l’expliquer à ses lecteurs et ses lectrices.
Les nouvelles technologies ont de tout temps modifié le travail des journalistes. L’IA aura aussi un effet. Quelques outils permettent déjà d’économiser du temps pour résumer des documents ou retranscrire des entrevues audios, par exemple.
Mais ces outils et les GML ne changent pas l’un des principes de base du journalisme : parler de l’expérience humaine en connexion avec la société dans laquelle nous évoluons.
Les GML peuvent écrire rapidement et avec précision la description d’un match de hockey, déchiffrer un rapport de police ou résumer un rapport économique. Ils ne peuvent cependant pas interroger des spécialistes et des gens lors d’un évènement.
La francophonie minoritaire a survécu parce que les êtres humains qui la composent se sont serré les coudes. Ils ont crié pour dénoncer les injustices, ils se sont levés pour raconter leurs histoires et rappeler leurs succès.
Pendant que chaque média explore quel rôle les outils d’IA peuvent jouer dans la salle de nouvelles, il ne faut pas perdre de vue ce qui distingue les journalistes d’une machine à recracher des mots.
Les journaux en milieu minoritaire sont le reflet de leur communauté. Vos médias ont besoin de vous pour y arriver. Ils ont besoin que vous les lisiez, mais surtout que vous leur parliez, aussi bien pour les remercier que pour les inviter à faire mieux, et que vous leur transmettiez de l’information.
Les IA ne pourront jamais jouer ce rôle de façon empathique. Elles ne seront jamais par et pour la francophonie minoritaire.
Et si les médias francophones disparaissaient, les GML n’auraient plus de sites où tirer les actualités de la francophonie. Dans ce cas, où allez-vous les trouver?
À lire : Bonjour Gemini, au revoir nouvelles sur la francophonie (Éditorial)
Francopresse a toujours mis les enjeux et les êtres humains de la francophonie de l’avant. Ce désir reste une priorité. Nous ne croyons pas que l’information est authentique si le texte qui présente aux lecteurs et lectrices l’expérience d’une personne était écrit par une machine.
Francopresse n’a jamais publié de texte écrit par une IA et ne prévoit pas emprunter cette voie.
Cela dit, l’équipe de Francopresse utilise à l’occasion certains outils alimentés par l’IA pour faciliter certaines tâches. La transparence étant au cœur de la confiance, Francopresse affichera dorénavant de quelle façon ces outils ont été utilisés dans la production et la révision d’un texte.
Si un outil a servi à résumer un rapport, à transcrire une entrevue menée par un ou une journaliste ou à raccourcir un paragraphe, nous le préciserons en fin de texte. Nous n’allons pas privilégier les images faites par l’IA, mais si nous devons en utiliser une, nous l’indiquerons.
Des êtres humains en chair et en os continueront d’écrire tous les textes, et les informations trouvées grâce à des outils d’IA feront toujours l’objet d’une vérification.
Cette façon de faire respecte nos valeurs de rigueur, d’exactitude et d’esprit critique. Elle constitue aussi une façon de rester branchés à notre humanité collective et à notre instinct de défense de nos droits en tant que minorité linguistique.
À lire : L’IA est-elle une menace pour la création littéraire francophone?
«Je réfléchis toujours à comment réduire mes émissions polluantes et à préserver la santé de mes sols», raconte le propriétaire de la ferme Les racines Légère à Caraquet au Nouveau-Brunswick, Alexis Légère.

«Je suis capable de bien vivre. Je génère des marges de profit probablement meilleures qu’un agriculteur conventionnel, car mes couts initiaux d’investissement, d’achat d’équipement sont plus faibles», affirme le maraicher Alexis Légère, au Nouveau-Brunswick.
Depuis quatre ans, l’Acadien possède un demi-acre de champ en modèle bio-intensif. Autrement dit, il cultive en rotation une trentaine de variétés de légumes qu’il vend en circuit court.
Sur son lopin de terre, l’ancien militant écologiste ne met ni engrais de synthèse ni pesticides dérivés du pétrole. Il privilégie du compost «organique et local». Mis à part son camion de livraison, il n’utilise aucune machinerie à essence.
«J’ai réalisé que l’agriculture était l’un des secteurs les plus polluants de la planète et j’ai pris des actions concrètes pour changer les choses et faire le plus durablement possible», partage le trentenaire, qui dit parvenir à dégager 60 000 dollars de revenus par an.
Selon le gouvernement, l’agriculture est responsable de 10 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada – exclusion faite du transport agricole et de la production d’engrais. Elle dégage principalement du dioxyde de carbone (CO2), du méthane et de l’oxyde nitreux.
À lire aussi : Quelle place pour les jeunes sur les fermes? (Acadie Nouvelle)
Les rejets d’oxyde nitreux, «en augmentation», sont attribuables à l’utilisation d’engrais azotés «pour fertiliser le canola dans les Prairies et le maïs en Ontario et au Québec», explique le directeur du Centre pour la gestion durable des sols de l’Université Dalhousie, en Nouvelle-Écosse, David Burton.

«En augmentant la matière organique dans le sol pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on améliore également la capacité du sol à retenir l’eau, ce qui lui confère une résistance à la sècheresse», détaille David Burton de l’Université Dalhousie.
Sous-produit de la digestion des animaux, le méthane est, lui, libéré dans l’air par les flatulences et les rots des ruminants et le stockage à long terme du fumier.
Selon David Burton, l’Alberta est la province qui arrive en tête des émissions de ce gaz au pouvoir réchauffant bien plus élevé que le CO2, puisqu’elle est l’une des plus grandes régions d’élevage de bétail au pays.
Le Canada s’est fixé comme objectif de réduire de 30 % ses rejets d’oxyde nitreux et de méthane d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2020.
«C’est tout à fait faisable, mais pour y parvenir, nous devrons modifier un grand nombre de nos pratiques agricoles, nous concentrer sur l’efficacité de la production plutôt que sur son ampleur», avance David Burton.
Il existe de nombreuses pistes prometteuses si l’on veut accélérer la décarbonation du secteur. Le chercheur basé en Alberta d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, Roland Kroebel, évoque par exemple le semis direct plutôt que le labour conventionnel, l’utilisation plus efficace des engrais azotés selon la règle de la bonne source, la bonne dose, au bon moment et au bon endroit.
«Mais dans le contexte agricole actuel au Canada, je ne pense pas que l’agriculture telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui puisse se passer d’engrais», précise Roland Kroebel.
Un avis que partage le vice-président de l’Union des cultivateurs franco-ontariens, Michel Dignard : «Grâce à l’amélioration des machineries et aux nouvelles technologies GPS plus précises, on a réduit la quantité d’engrais et d’herbicides qu’on utilise, mais c’est impossible de tout enlever.»
Dans le domaine de la production animale, le professeur associé à la Faculté de Sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval, à Québec, Stéphane Godbout, conseille de modifier le régime alimentaire du bétail.
Une étude européenne de 2016 avait montré que remplacer l’ensilage de maïs ou le soja dans l’alimentation des vaches par des grains de lin cuit, riches en oméga 3, de la luzerne ou encore du foin permet de réduire leurs émissions de méthane et d’augmenter leur production de lait.
Stéphane Godbout recommande également une meilleure gestion du fumier, avec un entreposage couvert à température plus basse, un temps de stockage moins long, etc.
Plusieurs programmes, à l’image du Fonds fédéral d’action à la ferme pour le climat, aident financièrement les exploitants à mettre en œuvre ces meilleures pratiques.
Depuis 2021 et la création de 14 Laboratoires vivants, producteurs et scientifiques élaboreront et testent également conjointement des pratiques innovantes visant à réduire les émissions de GES.
«Ce sont des outils très efficaces pour convaincre les agriculteurs, car ils voient ces pratiques mises en œuvre par leurs confrères et fonctionner sur le terrain», salue Stéphane Godbout.
Les grandes exploitations agricoles émettent-elles plus de GES que les petites? Pour Roland Kroebel d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, «il n’y a pas de relation directe entre la taille d’une ferme et ses émissions.»
«Vous pouvez trouver des petites exploitations qui sont absolument efficaces et d’autres qui ne le sont pas du tout», estime le chercheur.
«Plusieurs petites fermes qui émettent un peu relâcheront plus qu’une grande qui a adopté de bonnes pratiques pour réduire les gaz à effet de serre», renchérit Stéphane Godbout de l’Université Laval.
En revanche, David Burton de l’Université Dalhousie croit que «les grandes exploitations ne sont pas les meilleures, car elles sont très dépendantes des engrais et des herbicides et consomment beaucoup de carburant.»
«Je pense que les petites exploitations pensent plus à la santé de leur sol, à réduire les intrants et à utiliser des ressources comme le fumier animal et le compost», poursuit-il.
«Le modèle des grandes fermes est une anomalie mondiale, la majorité de la planète est nourrie par de petites fermes», appuie le maraicher Alexis Légère.
David Burton estime que la réduction des émissions de GES ne constitue pas «la première des priorités» des fermiers : «Ils s’inquiètent davantage de la sècheresse dans les Prairies, de leur situation financière.»

«Avant, on avait tendance à mettre l’engrais de bonne heure en une seule fois au printemps sur tout le champ. Aujourd’hui, avec l’aide de la technologie, on a le souci d’en mettre moins», assure l’agriculteur franco-ontarien, Michel Dignard.
«Nous n’avons pas réussi à leur faire comprendre qu’en diminuant leurs émissions, ils maintiendront leurs rendements, augmenteront leur rentabilité et deviendront moins sensibles aux aléas climatiques», regrette-t-il.
Michel Dignard considère pour sa part que les agriculteurs «essaient le plus possible de réduire leurs émissions, mais à des couts raisonnables», afin de maintenir leur exploitation à flot, dans un contexte de «compétition à l’international avec des marges de profit toujours plus petites».
«Réduire les rejets polluants est une priorité pour la relève, surtout pour la nouvelle génération d’agriculteurs qui n’hérite pas de la ferme et des pratiques des parents», renchérit Alexis Légère.
«La vieille génération y pense aussi, mais c’est moins accessible. La transition leur couterait trop cher. Ils seraient obligés de s’endetter, surtout s’ils produisent sur de grandes surfaces», ajoute celui qui est aussi président jeunesse de l’Union nationale des fermiers du Nouveau-Brunswick.
Se contenter de montrer du doigt le secteur agricole serait en outre trop facile : il n’est pas seulement un secteur émetteur, il est aussi l’une des solutions pour stocker massivement du carbone et lutter contre le changement climatique.
«En nourrissant les sols avec de la matière organique, le carbone se retrouve dans le sol plutôt que dans l’atmosphère, explique David Burton. Mais cela suppose que l’on perturbe la terre le moins possible.»
En dehors des standards de l’agriculture conventionnelle, Alexis Légère prône ainsi des cultures sans labour, «qui augmentent la matière organique souterraine, reconstruient la vie des sols et réduisent l’érosion».

Pour Roland Kroebel d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, «la communauté agricole est beaucoup plus sensibilisée qu’auparavant» à la nécessité de réduire les GES.
Sur sa ferme, l’Acadien ne laisse presque jamais sa terre à nu : «Elle est toujours couverte avec des cultures qui lui permettent de rester en place, malgré les intempéries, et qui fixent l’azote et la matière organique.»
En Ontario, Michel Dignard assure que beaucoup de paysans travaillent désormais leur sol à minima et recourent «aux plantes de couverture durant l’automne pour capturer le carbone».
Qu’elle soit une source ou un puits de carbone, l’agriculture canadienne est déjà victime des changements climatiques. Les sècheresses, les inondations et les tempêtes ont des impacts sur les rendements agricoles et les pratiques des professionnels.
«Ça vient d’une passion pour la ville de Tofino, l’Île de Vancouver, et du caractère assez unique du surf ici. Il y a aussi ce côté mystique, le brouillard en permanence», amorce le coproducteur et idéateur de la série, Anthony Cauchy, qui vit dans la région depuis plus de 15 ans.
Car si vous pensiez voir des peaux brulées par le soleil et des plages de sable chaud, passez votre chemin. Loin des clichés californiens ou hawaïens, la nouvelle série d’Unis TV s’attache à montrer le surf côté Ouest canadien, où l’eau avoisine les 14 °C en plein été et où les combinaisons vont de la tête jusqu’aux pieds.
Surf Bay suit le parcours d’une surfeuse renommée, Margot Swann (Camille Felton), profondément attachée à son village natal, Surf Bay. Mais lorsqu’un projet touristique menace la forêt centenaire, elle prend position, au risque de compromettre sa carrière et de se mettre à dos ses proches.
«C’est la première série dramatique filmée en français en Colombie-Britannique, donc c’est là où, d’une certaine manière, on fait déjà l’histoire», souligne fièrement Anthony Cauchy.
«On est allé chercher vraiment beaucoup de francophones sur place qui travaillaient déjà dans l’industrie», complète le réalisateur, Dominic Desjardins.

Une partie de la distribution de Surf Bay, côte Ouest. De gauche à droite et de haut en bas : Mia Wistaff, Henri Picard, Camille Felton, Karl Walcott, Jessica Heafey, France Perras, Tony Hiu Joong Giroux et Émilie Leclerc.
«Il y a des francophones qui rêvaient de travailler sur un projet en français qui se sont joints à l’équipe. On a à peu près un 50 % de l’équipe qui parle français, et ça, c’est formidable parce que sur le plateau ça a créé une dynamique.»
Une dynamique où l’on passe du français à l’anglais naturellement, sans jugement. «Ça reflète bien l’identité francophone d’ici, où l’anglais fait partie de l’environnement. Les francophones se retrouvent un peu comme des aimants, à s’agglomérer ensemble par affinité naturelle», commente-t-il.
Dominic Desjardins rappelle que la ville fictive de Surf Bay n’est pas une communauté francophone, mais que ceux-ci «se sont retrouvés comme un petit noyau autour du surf professionnel». Certaines scènes ont d’ailleurs été tournées dans la langue de Shakespeare.

L’actrice québécoise Camille Felton campe le personnage de Margot Swann, une surfeuse aux ambitions olympiques.
«C’était mon premier tournage en anglais!», témoigne de son côté l’actrice Camille Felton. «Ça a été un beau travail d’équipe, des deux côtés, de s’aider avec la langue.»
La Québécoise a dû relever d’autres défis pour cette production pas comme les autres, où la nature tient aussi l’un des rôles principaux.
À lire aussi : Financement de TV5 : l’industrie de la télé francophone s’inquiète
Même si elles avaient, pour la plupart des séquences de surf, des doublures, les deux actrices principales – Camille Felton et Mia Wistaff – se sont quand même (littéralement) jetées à l’eau.
L’interprète de Margot n’avait jamais mis un pied sur une planche de surf et elle l’affirme sans détour : «C’est le plus gros et beau show que j’ai fait. Celui qui m’a amenée plus loin dans mon jeu, dans ma préparation d’actrice, dans le leadeurship.»
Montagne, forêts, océan : «C’est un show très riche visuellement, un choc de nature. Tous les endroits où on a tourné étaient impressionnants», appuie Dominic Desjardins.
«C’est aussi un endroit qui est connu pour la défense de l’environnement. On a décidé d’inclure cet élément-là dans la série», indique Anthony Cauchy.
«C’est un enjeu qu’on retrouve énormément au niveau local ici. On sait qu’il y a de plus en plus de touristes qui viennent en Colombie-Britannique, donc c’est toujours le dilemme entre l’essor touristique, le développement, puis la préservation de l’environnement.»
C’est justement cette vision positive que Dominic Desjardins a voulu insuffler à la série.

On pense parfois que l’éco-activisme est mêlé d’angoisse, qui fait que les gens seraient peut-être portés à être désenchantés, passifs et déprimés. Ça fait du bien de voir qu’en fait, on n’est pas passifs, on n’est pas victimes, qu’il y a moyen, en fait, de prendre les choses en main.
L’équipe de tournage a elle-même essayé de réduire son empreinte carbone au maximum, avec l’aide d’une conseillère.

Zoélie (Mia Wistaff) et Margot (Camille Felton), deux des personnages principaux de Surf Bay.
«On n’était pas en train de faire quelque chose qui se rapportait au surf qu’on voit d’habitude à la télé, décrit le réalisateur de la série, Dominic Desjardins. C’est du surf au Canada. L’océan est froid tout le temps, même l’été; on voit des sapins de la brume.»
Avant de poser sa caméra, il a regardé beaucoup de documentaires et discuté avec des professionnels qui ont l’habitude d’évoluer dans cet environnement-là. Il s’est aussi inspiré des sœurs Olin, deux surfeuses professionnelles de la région. L’une d’entre elles, Mathea, est d’ailleurs la doublure de l’actrice principale, Camille Felton.
«On est allé chercher cette expérience-là pour pouvoir être authentique et aller chercher les plus belles prises possibles dans l’océan.»
La série marque aussi la première collaboration entre les deux diffuseurs TV5Unis et Crave, où la série sera sous-titrée en anglais. «On va pouvoir toucher le plus de monde possible à travers le Canada. Donc c’est sûr qu’au niveau de la visibilité on est gagnant», se réjouit Anthony Cauchy.
Pour Jérôme Hellio, directeur des contenus pour TV5 et Unis TV, cette série est parfaite pour la tranche d’âge de téléspectateurs qu’il vise : les jeunes de moins de 25 ans.

Le producteur Anthony Cauchy n’hésite pas à qualifier Surf Bay, côte Ouest de projet historique.
«C’est très important de soutenir la relève partout au pays en français», ajoute-t-il, citant de nouvelles boites de production comme Locomotive Media – qui coproduit Surf Bay –, fondée par Anthony Cauchy et basée à Vancouver.
«C’est un projet risqué, un projet audacieux. On mêlait action avec un tournage très serré par rapport à tout le volume de contenu qu’on devait filmer. Ça demandait une gymnastique énorme. Je ne sais pas si on y serait arrivé s’il n’y avait pas eu toute cette fierté partagée de faire ce premier projet ici en langue française», relève Anthony Cauchy.
Il espère que cette première ouvrira la voie à d’autres projets en français dans l’Ouest. «Parce qu’on sait qu’il y en a plus à l’Est, à Winnipeg par exemple, mais ici c’était assez restreint quand même.»
«Dans les différentes régions du Canada, il y a de la production francophone qui se fait. Il y a des petites familles qui se retrouvent sur le plateau. En arrivant de Toronto, j’ai rencontré ici une nouvelle famille à laquelle se sont joints des acteurs qui venaient du Québec et d’ailleurs», livre Dominic Desjardins.
Lui aussi espère que d’autres Surf Bay verront le jour, pour mettre en valeur la réalité francophone hors Québec, «qui existe, qui est forte et qui a de belles choses à raconter».
À lire aussi : Cinéma francophone : une formation pour assurer la relève
Les dix épisodes de 23 minutes de Surf Bay, côte Ouest, coproduits par Reign Films et Locomotive Média, seront disponibles sur TV5Unis au printemps 2026 et sur la plateforme Crave en 2027.
La Société Santé en français (SSF), l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) et cinq établissements postsecondaires de la région atlantique se partagent 78 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer l’accès aux soins de santé en français dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire.
L’argent provient du Programme pour les langues officielles en santé et du Plan d’action pour les langues officielles.
Le partage : La SSF reçoit la plus grande part, avec 37 millions de dollars. En partie redistribué dans les 16 réseaux régionaux, l’argent sera utilisé pour l’intégration de travailleurs bilingues et pour adapter des services existants.
Avec 9,4 millions, l’ACUFC et son Secrétariat national du Consortium national de formation en santé tenteront d’améliorer l’accès, le recrutement et la formation dans les programmes de santé des établissements postsecondaires francophones. Ils chercheront aussi à créer davantage d’occasions de stages en milieu minoritaire.
Finalement, l’Université de Moncton, le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, l’Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse) et le Collège de l’Île (Île-du-Prince-Édouard) se partagent 32 millions afin d’augmenter le nombre d’étudiants dans divers programmes de formation en santé.
À lire : Santé en français : un droit encore à réclamer et des calculs à repenser
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick rejoint celui du Canada pour demander à la Cour suprême du Canada de rejeter l’appel de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) concernant la nomination de lieutenants-gouverneurs unilingues dans la province.
La SANB demande l’annulation de la nomination, en 2019, de l’ancienne lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, Brenda Murphy – qui ne parlait pas français lors de son entrée en fonction –, et de suspendre la décision pendant 12 mois pour ne pas déstabiliser le système juridique de la province.
Le nœud du problème : La SANB a remporté sa cause en première instance, mais a perdu devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. Le juge a statué que c’est l’institution qui doit être bilingue – bureau et relations avec le public. S’il est préférable que la personne qui occupe le poste le soit aussi, ce ne serait pas obligatoire. La province affirme que cette interprétation est la bonne.
Le gouvernement fédéral qualifie le projet «T.N.-O. : Notre territoire pour l’avenir» comme «l’une des plus importantes initiatives de conservation des terres dirigées par des Autochtones dans le monde», peut-on lire dans un communiqué.
La ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Julie Dabrusin, a annoncé qu’Ottawa investira 300 millions de dollars pour protéger le territoire et qu’un montant supplémentaire de 75 millions, provenant de partenaires philanthropiques, s’y ajoutera.
2 % du Canada : Ce financement appuiera le travail des Premières Nations des Territoires du Nord-Ouest dans la protection et la conservation de 380 000 km2 de terres, ce qui représente près de 30 % du territoire, soit 2 % de la superficie du Canada.
L’argent pourra être utilisé pour le programme des gardiens autochtones, la gestion des aires protégées, des actions climatiques et le développement économique reliés à la conservation.
À lire aussi : Les communautés autochtones, «championnes des énergies renouvelables»

La première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt (à gauche) a souligné que les dirigeants des provinces et territoires «se sont rencontrés beaucoup plus souvent» depuis le début des hostilités déclenchées par Donald Trump. David Eby de la Colombie-Britannique et Scott Moe de la Saskatchewan étaient assis à sa gauche. Photo : Capture d’écran – YouTube
Mercredi, à Huntsville, en Ontario, les premiers et premières ministres des provinces et des territoires ont mis de l’avant leurs principales priorités et demandes au gouvernement fédéral, à l’issue du Conseil de la fédération, qui a duré trois jours.
Les discussions ont notamment porté sur les feux de forêt, les projets d’intérêt national et des relations avec les États-Unis. Mark Carney a d’ailleurs participé à la rencontre de mardi, une présence rare du premier ministre canadien, qui ne participe habituellement pas à cette rencontre annuelle.
Économie : Le travail a déjà commencé, mais les dirigeants se sont tous engagés à faire tomber le maximum de barrières au commerce intérieur, comme celles concernant la vente d’alcool et la reconnaissance des compétences des travailleurs. Un nouvel accord de reconnaissance mutuelle sur les biens de consommation devrait entrer en vigueur avant la fin de l’année.
L’Ontario, la Saskatchewan et l’Alberta ont également signé un protocole d’entente en vue de construire de nouveaux oléoducs, des voies ferrées et d’autres infrastructures énergétiques et commerciales. Pour l’instant, le Manitoba, qui se trouve entre des trois provinces, ne fait pas partie de l’accord.

De gauche à droite : P. J. Akeeagok du Nunavut, Danielle Smith de l’Alberta et Rob Lantz de l’Île-du-Prince-Édouard. Ce dernier sera le président du Conseil de la fédération pour les douze prochains mois.
Immigration : Les provinces réclament un plus grand contrôle des cibles en immigration sur leur territoire, un peu comme le Québec. «Nous connaissons mieux notre marché du travail», a déclaré le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, lors de la conférence de presse de clôture. Il a même affirmé que sa province allait commencer à délivrer ses propres permis de travail.
Sécurité publique : Le Conseil demande au gouvernement fédéral de modifier le Code criminel pour réformer le système de liberté sous caution et ainsi lutter contre les récidives et les infractions violentes, tout en prenant en compte des enjeux comme la pauvreté, l’itinérance, les dépendances et les problèmes de santé mentale.
Santé : Les membres du Conseil demandent d’augmenter les transferts pour le financement des systèmes de santé des provinces et territoires. Une demande qui revient chaque année, mais qui est martelée moins vigoureusement cette année.
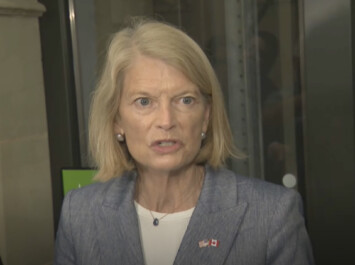
La sénatrice républicaine de l’Alaska, Lisa Murkowski, a dit ne pas pouvoir expliquer la rhétorique du «51e État» de Donald Trump.
Trois sénatrices et un sénateur des États-Unis – trois démocrates et une républicaine – étaient à Ottawa lundi pour rencontrer le premier ministre Mark Carney. En mêlée de presse, ils ont partagé leur désir de poursuivre la relation commerciale avec leur pays voisin et le partenariat pour la sécurité du continent. Ils aimeraient surtout voir la fin du mouvement de boycottage des produits des États-Unis et le retour des touristes du Canada.
Peu de progrès : Les sénateurs ont qualifié la discussion de constructive. Malgré toute leur bonne volonté et leur ouverture, les quatre n’ont pas pu faire de promesses ou de commentaires en lien avec les décisions de leur président qui sont à l’origine de l’instabilité commerciale entre les deux pays.
Dans un communiqué publié après la rencontre, Mark Carney a souligné les mêmes éléments et indiqué que les négociations commerciales se poursuivaient. Le ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, Dominic LeBlanc, s’est d’ailleurs rendu à Washington cette semaine.
Le président des États-Unis a annoncé il y a deux semaines que de nouveaux tarifs douaniers de 35 % seraient imposés à partir du 1er aout sur les produits canadiens qui ne respectent pas l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
«Comme entrepreneuse francophone en situation minoritaire, je me sens un peu comme une pionnière. Un monde de possibilités s’offre à moi, car je suis la seule à offrir ce type de services», affirme la fondatrice de Black Lantern, Murielle Jassinthe.

Au Nunavut, Murielle Jassinthe a fondé l’entreprise de conseil Black Lantern Inc. Elle aimerait que les ressources disponibles pour aider les femmes soient plus facilement accessibles.
La Québécoise, arrivée au Nunavut il y a 11 ans, a lancé sa société de conseil en arts et culture en 2019. Gestion des relations publiques et de l’image de marque, soutien au développement stratégique et créatif, elle offre une multitude de services à des artistes, des organisations culturelles et des entreprises.
Elle propose également du mentorat sur la diversité, l’équité et l’inclusion ainsi que des ateliers de sensibilisation au racisme systémique.
«Ce que j’aime dans l’entrepreneuriat, c’est la liberté de faire ce que je veux, de développer mes propres idées. Quel que soit son domaine d’expertise, on défriche beaucoup quand on est son propre patron», assure l’artiste interdisciplinaire de 43 ans.
Murielle Jassinthe ne cache pas les nombreux obstacles auxquels elle a été confrontée pour en arriver là : «En tant que femme noire entrepreneuse, qui en plus est francophone en situation minoritaire, le défi est de faire entendre sa voix.»
«À partir du moment où tu apprends à te positionner en tant que spécialiste, à exiger un prix juste pour tes activités, on te regarde différemment, on commence à t’écouter», poursuit-elle.
Élargir sa clientèle et convaincre de la pertinence de ses idées restent un travail de tous les instants.
Quand on est à son compte, on porte toutes les casquettes. On doit créer son marché, sa marque. Il faut être là constamment à faire de la publicité, du réseautage. Ça demande beaucoup de résilience et de créativité
«Quand on est à son compte, on porte toutes les casquettes. On doit créer son marché, sa marque. Il faut être là constamment à faire de la publicité, du réseautage. Ça demande beaucoup de résilience et de créativité», témoigne une autre entrepreneuse, .
La Guadeloupéenne, arrivée à Vancouver en Colombie-Britannique en 2017, a créé Griottes Polyglottes en 2020 en pleine pandémie de COVID-19. L’organisme permet à sa clientèle d’améliorer son français ou son anglais grâce au théâtre et à l’improvisation.
«Au début, je voulais y arriver toute seule, mais il ne faut pas être isolée quand on est entrepreneure. On se rend vite compte que l’on a besoin d’aide», rapporte-t-elle.
À lire aussi : L’épuisement militant : «Une bataille contre soi-même»
Ingrid Broussillon n’hésite pas à frapper à toutes les portes : la Société de développement économique de la Colombie-Britannique, Futurpreneur, le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE), The Black Business Association of British-Columbia, Women Entrepreneurs in BC ou encore la Chambre de commerce francophone de Vancouver.

En Colombie-Britannique, Ingrid Broussillon a créé Griottes Polyglottes et The WoW Culture. Elle se dit chanceuse d’avoir eu de nombreux appuis.
Ces organismes lui offrent du mentorat et de la formation dans les domaines de la vente, du markéting et de la comptabilité. Elle a également reçu des prix qui l’ont fait connaitre.
«Je me sens très reconnaissante et privilégiée. J’ai pu bénéficier d’aides en tant que femme, en tant que francophone, en tant qu’immigrante et en tant que noire», insiste la quadragénaire.
À ses débuts, Murielle Jassinthe, qui se qualifie elle-même d’«autodidacte», a aussi dû apprendre à naviguer dans les méandres de la bureaucratie. Choisir la forme sociale de sa compagnie, monter son plan d’affaires, faire sa comptabilité, autant d’épreuves à surmonter.
«Et puis en milieu minoritaire, trouver des comptables, des avocats capables de t’aider dans ta langue maternelle est un autre grand défi», relève Murielle Jassinthe.
Pour l’instant, le site internet de Black Lantern est uniquement en anglais, car «mon gars de l’IT est unilingue anglophone» : «Je pense engager quelqu’un pour le traduire, mais ça coute cher.»
Le fait de travailler en français à l’extérieur du Québec présente cependant des avantages. «On est comme une petite famille plus solidaire, on s’entraide, estime Ingrid Broussillon. Les organismes francophones me donnent de la visibilité et m’embauchent pour donner des ateliers. Ça m’aide à maintenir mon bizness.»
À lire aussi : Le repreneuriat, «un outil pour faire vivre les communautés francophones»
Murielle Jassinthe a, elle, bénéficié de l’accompagnement de Carrefour Nunavut, l’organisme nunavois de développement économique. Elle considère néanmoins qu’il faut «davantage de soutien en personne» et «plus de programmes de financements clairement identifiés.»

«L’entrepreneuriat est encore plus difficile pour les nouvelles arrivantes qui ne maitrisent pas les codes sociaux et la culture de l’entreprise au Canada», explique Soukaina Boutiyeb de l’AFFC.
«Il n’y a pas assez de ressources adaptées aux réalités des entrepreneuses francophones, qui souffrent d’une vulnérabilité économique accrue et de difficultés d’accès à un réseau professionnel local», confirme la directrice générale de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC), Soukaina Boutiyeb.
Dans un courriel de réponse, le RDÉE Canada reconnait que «l’accès au capital, le manque de ressources entrepreneuriales disponibles en français et la rareté des réseaux de femmes entrepreneuses à l’extérieur du Québec» constituent des «freins» à la réussite entrepreneuriale des femmes en situation minoritaire.
Mais l’organisme national assure les appuyer «à travers plusieurs leviers, qu’ils soient nationaux ou portés par ses membres dans les provinces et territoires».
«Dans tout le réseau, nos membres offrent du mentorat d’affaires, des services de démarrage, des webinaires et des activités de réseautage, incluant un appui spécifique aux femmes», précise le courriel.
La Société économique de l’Ontario propose par exemple les programmes d’entrepreneuriat Ambitions au féminin et Élan F, tandis que le RDÉE Nouveau-Brunswick appuie les femmes dans la reprise d’entreprises existantes à travers l’initiative Solution Repreneuriat.
À lire aussi : Une nouvelle stratégie pour l’intégration des immigrantes francophones
Aujourd’hui, Murielle Jassinthe ne parvient pas encore à vivre de son activité d’entrepreneuse. Elle est obligée de conserver un «travail de jour» dans le domaine de la communication.
«En situation minoritaire et en région reculée, le bassin de clientèle est forcément plus petit, mais mon objectif reste de faire grossir Black Lantern, notamment l’activité d’agente d’artistes», indique-t-elle.
En Colombie-Britannique, Griottes Polyglottes est plus florissante. La société compte cinq membres du personnel à temps partiel et enregistre plus de 200 clients et clientes depuis sa création. Ingrid Broussillon a par ailleurs fini de rembourser le prêt que l’organisme Futurpreneur lui avait consenti.
C’est rentable, mais c’est difficile de maintenir la balance entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Je fais de très longues journées, parfois de 7 h à 2 h du matin
Passionnée, la Franco-Canadienne a démarré une nouvelle entreprise il y a deux ans, The WoW Culture. Elle donne désormais des ateliers de théâtre et d’improvisation afin de former à la diversité et à l’inclusion.
«L’entrepreneuriat amène un vrai dynamisme, renforce l’esprit de communauté. Ça donne de la visibilité économique à la francophonie», observe-t-elle.
Pour Soukaina Boutiyeb, les femmes offrent plus que jamais des «modèles inspirants» et contribuent à diversifier l’écosystème entrepreneurial, «souvent avec une approche inclusive et innovante».
À lire aussi : Entrepreneuriat des jeunes : «le bilinguisme est un atout incontestable»
«Alors que le cout de la vie augmente, ces opportunités permettent aux familles et aux visiteurs d’explorer des endroits qui n’auraient peut-être pas été [accessibles] autrement», estime le directeur général du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ), Mark Bannerman.
Il voit le «Laissez passer Un Canada fort» comme un levier pour valoriser la culture et le patrimoine, en créant des occasions d’apprentissage et en espérant que les visiteurs apprécient leur expérience et reviennent.
«Tout programme qui offre des laissez-passer d’entrée gratuits ou à prix réduit encouragera les visiteurs à prendre le temps et l’effort de visiter les sites touristiques francophones», estime-t-il.
Mark Bannerman conseille aux entreprises francophones de présenter des prix réduits, d’augmenter leur visibilité en ligne et de développer une visite guidée spécialisée, pour profiter de l’afflux de visiteurs cet été.
Des portes ouvertes sur la culture et la nature canadiennes
Disponible jusqu’au 2 septembre, le «Laissez passer Un Canada fort» permet d’entrer gratuitement dans les sites administrés par Parcs Canada, notamment les parcs nationaux, les aires marines et les lieux historiques. Les frais de camping dans ces sites sont également réduits de 25 %.
Par ailleurs, le 17 juillet, l’entrée est gratuite a été ajoutée pour 86 galeries et musées provinciaux et territoriaux pour les jeunes de moins de 17 ans. Les personnes âgées de 18 à 24 ans bénéficient, quant à elles, d’un rabais de 50 %.
VIA Rail propose aussi la gratuité pour les mineurs accompagnés d’un adulte et des réductions pour les 18 à 24 ans.
Une initiative pour les familles
«Pour de nombreuses familles, les couts d’entrée dans les musées ou les parcs, ainsi que les frais de transport pour s’y rendre, peuvent rapidement représenter un obstacle, surtout pendant la période estivale», fait remarquer l’attachée de presse du cabinet du ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, Hermine Landry.
Elle donne l’exemple d’une famille de cinq personnes visitant le Musée canadien de la nature, à Ottawa. Celle-ci pourra économiser au moins 50 $ en frais d’entrée. Pour un séjour de cinq jours au Parc national Forillon, au Québec, une famille de deux adultes et deux enfants économiserait jusqu’à 135 $ grâce l’entrée gratuite et une réduction de 25 % sur le camping.
Enfin, une famille de quatre personnes faisant le trajet Montréal-Ottawa pour un weekend pourrait économiser 251 $ avec les rabais de VIA Rail.
Un moteur économique
D’après l’attachée de presse du cabinet du ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, Hermine Landry, voyager au Canada permet de soutenir «plus de 240 000 entreprises touristiques et contribue à près de 2 millions d’emplois à travers le pays».
En 2023, les Canadiens et les Canadiennes ayant voyagé à l’intérieur du pays ont généré «plus de 95 milliards de dollars» pour l’économie, rapporte-t-elle.
Elle rappelle que les sites de Parcs Canada contribuent au maintien d’environ 40 000 emplois à l’échelle nationale, qui génèrent près de 4 milliards de dollars pour le produit intérieur brut (PIB) du pays et que les visiteurs y dépensent environ 11 millions de dollars par jour.

Le «Laissez-passer Un Canada Fort» était une promesse de Mark Carney durant sa campagne électorale.
«Plus de services, plus de stationnement»
Malgré les objectifs du programme fédéral, certains entrepreneurs touristiques s’interrogent sur la capacité à gérer l’afflux de touristes.
Sylvie Grégoire, propriétaire du restaurant Chez François à Canmore, en Alberta, depuis 35 ans, exprime des réserves. Pour elle, ce laissez-passer semble avoir été lancé «à la dernière minute». Elle estime qu’il profitera surtout aux personnes des régions de Calgary et d’Edmonton, et non à celles qui ont déjà planifié leurs vacances et qui viennent de plus loin.
La restauratrice ne pense pas que le laissez-passer changera «grand-chose» en matière de revenus pour son entreprise, car l’été est déjà une saison touristique «tellement occupée». Elle souligne que le parc national de Banff, par exemple, est déjà très achalandé, même avant le congé d’été.
«Il y a déjà beaucoup de monde, trop de monde, on ne peut pas trouver un stationnement, même dans les stationnements qui sont gratuits», témoigne-t-elle. Elle aurait préféré que l’argent soit investi dans des places de stationnement.
Sylvie Grégoire plaide également pour la mise en place de plus de services au sein du parc national de Banff, comme des employés pour accueillir et diriger les visiteurs, car ce n’est «pas un petit parc, c’est pas un parc d’amusement».
Il est 8 heures jeudi matin, le thermomètre affiche 30 °C de ressenti – humidex compris –, mais des jeunes s’activent déjà dans la cafétéria du Collège Montmorency, à Laval.
Autour des tables, les chandails affichent fièrement les couleurs de toutes les provinces et de tous les territoires. Les JeuxFC accueillent cette année plus de 800 jeunes d’expression française de 14 à 18 ans d’un bout à l’autre du Canada.
À lire aussi : Jeux de la francophonie canadienne à Laval : une jeunesse qui s’affirme
Pour la plupart, c’est leur première participation aux JeuxFC, les derniers ayant eu lieu en 2017, au Nouveau-Brunswick. Et nombreux sont celles et ceux qui ont répondu à l’appel.

Hayden Cotton est le président de Jeunesse Acadienne et Francophone de l’Île-du-Prince-Édouard (JAFLIPE).
«Avec 73 jeunes, c’est la plus grosse délégation que l’Île-du-Prince-Édouard a eue aux Jeux, donc on est très content», partage Hayden Cotton, entraineur d’athlétisme et président de Jeunesse Acadienne et Francophone de l’Île-du-Prince-Édouard (JAFLIPE), l’organisme chargé du recrutement pour les JeuxFC dans la province.
«On voulait le plus de monde possible, donc on a vraiment regardé jusqu’à la dernière date pour trouver des personnes.»
L’Insulaire est habitué à ces grands rassemblements; il a déjà concouru à plusieurs reprises aux Jeux de l’Acadie. Selon lui, c’est dans ce genre d’évènement que la francophonie prend tout son sens.
«Pour plusieurs jeunes – surtout ceux qui viennent de l’immersion –, ça leur donne une opportunité de parler français à l’extérieur de l’école. Parce qu’il y en a beaucoup qui n’en ont pas.»
«Des fois, ce sont les jeunes qui viennent d’immersion qui parlent plus français que ceux qui viennent d’une école francophone», relève-t-il.
À lire aussi : Entrepreneuriat des jeunes : «le bilinguisme est un atout incontestable»

Les jeunes sont montés sur scène pour faire entendre leurs voix et résonner leurs instruments.
«C’est tellement l’fun de pouvoir parler à tout le monde en français», se réjouit Mathis, entouré de ses camarades albertains, qui viennent de finir de déjeuner, car les épreuves du matin vont bien commencer.
Sa voisine de table, Sophie, se dit chanceuse de pouvoir se faire des amis. «On a un très bon cercle. Il n’y a pas de jugement, on est à l’aise. Ici, tu peux être toi-même. Les gens sont accueillants, personne ne te fait sentir mal.»
«Ça nous fait comme nous rapprocher. Je me sens faire partie d’un groupe», complète Mathis, qui prend aussi plaisir à entendre tous ces accents et parlers différents.
On vient pour montrer l’exemple et montrer la diversité de nos accents. C’est beau de voir tous ces jeunes avec ces différents backgrounds. On est aussi là pour les encourager, pour mettre en avant cette francophonie plurielle.
La province n’a eu aucun mal à recruter des participants, bien au contraire. «On a malheureusement dû dire non à certains», rapporte Cristina, entraineuse de volleyball de plage. Par exemple, pour son équipe, plus de 40 personnes ont postulé pour seulement six places disponibles.
«Notre but est de continuer à aller chercher le plus de jeunes possible pour les prochaines éditions. On ne veut pas les empêcher de vivre leur francophonie à 100 %», ajoute Maxime.
Tous les bénévoles de l’évènement – pour la majorité du Québec – ont suivi une formation sur l’insécurité linguistique, présentée par des membres du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique.
«Je ne pensais pas qu’il y avait autant de jeunes francophones dans tout le pays», confie Lorraine, bénévole avec son mari pour la nouvelle épreuve d’art culinaire. «Ça te fait prendre conscience qu’il ne faut pas porter de jugement.»
Hayden Cotton témoigne néanmoins d’un incident, en marge des JeuxFC, dans un magasin.
«Un de mes jeunes d’immersion en français m’a parlé, puis un homme est venu me voir pour me demander quelle langue le gars parlait, parce que cette personne n’avait pas compris que c’était du français. Moi je suis habitué à ça, mais les jeunes ne le sont pas. Comme je ne veux pas faire les jeunes se sentir mauvais, je ne vais pas leur dire que c’est arrivé. Parce que je sais comment, des fois, ça pourrait ruiner les Jeux pour lui.»
«Il reste une heure les chefs, let’s go!»
À l’École hôtelière et d’administration de Laval, on s’affaire derrière les fourneaux. L’art culinaire faisait son entrée au calendrier des épreuves cette année. Au menu : faire son épicerie pour 10 $, cuisiner pendant 90 minutes, puis présenter le plat devant un jury.
Raviolis aux épinards, gâteau de crêpes, pad thaï, soupe réconfortante : les brigades s’organisent et gèrent la tension. «Je suis un peu nerveuse», souffle Émilie, du Yukon, entre deux découpes de légumes. «Il y a beaucoup à faire en peu de temps.»
«J’ai l’habitude de parler anglais chez moi quand je cuisine, donc là je suis heureuse de pouvoir le faire en français», témoigne de son côté Hailey, représentant la Nouvelle-Écosse.
Loïc Fauteux-Goulet, coach culinaire pour la Colombie-Britannique, croit que ces occasions marquent à vie. «Il y a des choses qu’on sait mieux faire en anglais, d’autres en français. Là, c’est chouette qu’ils développent leur art culinaire en français. Ils cuisineront certainement ensuite toute leur vie dans cette langue», assure le gagnant de la saison 7 du Great Canadian Baking Show, sur CBC.
Les apprentis chefs ont également relevé un défi, vendredi, mettant à l’honneur le patrimoine culinaire de leur province ou territoire. Ils devaient apporter une spécialité de chez eux. De quoi célébrer leur identité, devant et dans l’assiette.
Plus de 200 chefs autochtones se sont rendus dans la région de la capitale nationale, jeudi, pour participer au Sommet des Premières Nations.
L’objectif : établir les règles de la collaboration entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral concernant les grands projets d’infrastructures qui seront développés grâce à la Loi sur l’unité de l’économie canadienne (anciennement projet de loi C-5, adopté en juin). La rencontre s’est cependant déroulée à huis clos.
Les enjeux : La veille du sommet, plusieurs chefs autochtones ont rappelé qu’ils regrettaient de ne pas avoir été consultés avant l’adoption du projet de loi, en juin.
Selon la cheffe nationale de l’Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse Nepinak, les avis divergent. Certains chefs sont inquiets des pouvoirs que le fédéral s’est octroyés avec cette loi. D’autres veulent avancer rapidement avec le gouvernement.
Ils s’entendent tout de même sur un point : «Les chefs ont été très clairs : l’accord des Premières Nations pour des projets importants n’est pas optionnel», a rappelé Cindy Woodhouse Nepinak en conférence de presse, mercredi.
Un premier acte : Avant le début de la rencontre, le premier ministre, Mark Carney, a affirmé que la loi sur les grands projets est la première législation qui inclut le développement économique des Premières Nations comme principe central.
«Ceci est le premier acte», a déclaré Mark Carney aux médias avant le début du sommet. «Je suis principalement ici pour écouter.» Le premier ministre a toutefois exclu toute modification de la loi.
La liste des projets possibles énumérés par le premier ministre n’inclut pas de projets qui pourraient améliorer la qualité de vie des Premières Nations – comme des logements et des infrastructures de traitement des eaux –, mais il avance que les revenus découlant des grands projets peuvent assurer l’avenir des Autochtones.
Des rencontres similaires avec les Inuit et les Métis auront lieu dans les prochaines semaines.
À lire : Élection fédérale : les Autochtones attendent plus de mesures concrètes
Neuf Premières Nations de l’Ontario ont annoncé mardi qu’elles contesteraient devant la Cour supérieure de la province la loi fédérale sur les grands projets et une autre loi provinciale visant également à accélérer les projets d’infrastructures.
Elles soutiennent que les ces lois ont été adoptées «sans l’information nécessaire pour comprendre et répondre à de potentiels effets négatifs sérieux» pour les territoires et les générations futures..
Contre les lois, mais pas le développement : Dans leur communiqué, les signataires indiquent que leur combat n’est pas contre le développement économique. «Ce n’est pas une bataille entre développements et aucun développement. C’est entre faire les choses de façon imprudente et faire les choses correctement», affirme le chef de la Nation Oneida de la Thames, Todd Cornelius.

Mark Carney a dû répondre à une autre menace de tarifs du président des États-Unis. Dans une lettre, Donald Trump a annoncé de nouveaux tarifs douaniers de 35 % sur tous les produits canadiens qui ne sont pas couverts par l’accord de libre-échange le 1er aout. Photo :
Mercredi, le gouvernement fédéral a annoncé une série de mesures pour protéger l’industrie de l’acier au Canada.
Tarifs et marché intérieur : Les premières mesures visent à limiter l’importation d’acier en provenance de pays autres que les États-Unis ou le Mexique. Pour y arriver, des tarifs douaniers de 50 % seront mis en place dans les prochains jours sur des quantités d’acier provenant de pays avec lesquels le Canada n’a pas d’accord de libre-échange. Les produits contenant de l’acier chinois seront également soumis à un droit de douane supplémentaire de 25 %.
En deuxième lieu, des investissements appuieront financièrement les entreprises et les employés.
Finalement, les entreprises qui auront des contrats avec le gouvernement fédéral devront s’approvisionner en acier auprès d’entreprises canadiennes.
Enjeux : La moitié de la production d’acier au Canada traversait la frontière sud dans le passé. Selon le vice-président de l’Association canadienne des producteurs d’acier, François Desmarais, l’imposition de tarifs douaniers de 25 % en avril avait déjà entrainé une diminution de 30 % des exportations et la perte de 700 emplois.
À lire : L’économie franco-canadienne doit se tourner vers l’est et l’ouest
Juste avant une réunion de son cabinet, mardi, le premier ministre Mark Carney a laissé entendre que même si le Canada parvenait à une entente commerciale avec le gouvernement de Donald Trump, les tarifs douaniers ne disparaitraient pas nécessairement.
Changement de discours : Mark Carney laissait entendre en campagne électorale qu’il cherchait à complètement éliminer les tarifs douaniers.
Le Bureau de l’ombud de l’approvisionnement (BOA) a sonné l’alarme, lundi, à propos de problèmes récurrents dans l’administration de contrats fédéraux.
Dans son étude, Alexander Jeglic parle de mauvaise planification et de mauvaises définitions de la portée des projets de construction, de clauses contractuelles vagues et des mécanismes de règlement des différends complexes et dispendieux.
Ce que ça coute : Ces problèmes entrainent des dépassements de couts et des retards. Ils affectent aussi l’équité, l’efficacité et le rapport qualité-prix des projets fédéraux.
L’ombud indique que son bureau «a été témoin du nombre croissant de plaintes des fournisseurs concernant l’administration des contrats de construction». Il encourage l’utilisation de services hors cour pour régler les différends plus efficacement et sans bloquer les projets.

Francesca Albanese n’avait pas pu rencontrer la ministre des Affaires étrangères lors de son passage à Ottawa en novembre 2024.
Deux députés du Nouveau Parti démocratique (NPD) ont annoncé leur intention de déposer la candidature de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, au prochain prix Nobel de la paix.
La porte-parole du NPD en matière d’affaires étrangères et de défense, Heather McPherson, et le leadeur parlementaire du parti, Alexandre Boulerice, reconnaissent le travail de dénonciation de la rapporteuse spéciale pour demander aux dirigeants du monde de travailler à mettre fin aux «violations des droits de la personne commises contre les Palestiniens par le cabinet de guerre israélien».
Les noms des récipiendaires des prix Nobel 2025 seront annoncés du 6 au 13 octobre 2025.
À lire : Le Canada évite une rapporteuse de l’ONU pour les territoires palestiniens
«Enfin, on semble embarquer dans le train de vouloir être à l’offensive avec la francophonie par le biais de la francophonie économique», lâche le président-directeur général du Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE) Canada Canada, Yan Plante.
Néanmoins, il avance que la proximité géographique avec les États-Unis (deux tiers des Canadiens et Canadiennes vivent à moins de 100 kilomètres de la frontière) et le taux de change – qui permet de dégager 20 % de marge, «sans même faire un effort de productivité» – peuvent freiner les réflexes commerciaux à l’intérieur du pays.
Pour lui, la situation actuelle tarifaire avec les États-Unis pousse les entreprises canadiennes à faire affaire entre elles, notamment les 116 760 entreprises francophones en dehors du Québec, selon les données de Statistique Canada de 2021.

Le PDG du RDÉE Canada, Yan Plante, voudrait voir «un pas de plus» du côté des provinces, afin de les voir devenir de «véritables champions du commerce francophone».
Plus de 10 % d’entre elles ont des revenus totaux de plus de 5 millions de dollars par année en moyenne. «Ces entreprises ont une masse critique qui est suffisante pour qu’on pense à maximiser des corridors de commerce au sein du Canada», souligne Yan Plante.
À ses yeux, la crise actuelle avec les États-Unis représente le «moment où jamais» pour améliorer le commerce à l’intérieur du pays.
Yan Plante affirme que le gouvernement fédéral a «fait tomber une cinquantaine de barrières» en adoptant le projet de loi C-5, juste avant le relâche estivale du Parlement, fin juin.
Ce projet de loi comporte deux volets. Le premier élimine une cinquantaine de barrières commerciales entre les provinces et territoires. Le second, plus controversé, vise à permettre la réalisation de grands projets qualifiés «d’intérêt national» par le gouvernement de Mark Carney, mais mal accueillis par plusieurs communautés autochtones et des groupes écologistes.
À lire aussi : Les limites du commerce interprovincial au Canada
«Mais le nœud de l’enjeu du commerce interprovincial au Canada, ce n’est pas le fédéral, ce sont les provinces entre elles, qui exercent un protectionnisme», avance Yan Plante.
Il cite par exemple les règles de limite de poids par camion ou les heures de circulation de certains poids lourds, susceptibles de varier d’une province à une autre : «Il y a toutes sortes de dédoublements qui freinent le commerce canadien.»
Seuls les ministres responsables de la francophonie, poussés par leurs gouvernements provinciaux et territoriaux, peuvent agir, estime-t-il.
Certains ont déjà signé des ententes interprovinciales, comme l’Ontario et le Manitoba ou l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, afin d’éliminer les obstacles au libre-échange des biens et services. Ces efforts demeurent néanmoins insuffisants pour le RDÉE.
Yan Plante rappelle que le nombre de francophones dans le monde passera de 350 à 700 millions d’ici 2050 : «Le Canada, avec sa francophonie, peut être placé de façon stratégique pour faire des affaires en français.»
D’après lui, le pays à la feuille d’érable est déjà bien positionné pour faire des affaires en France, en Belgique, en Suisse, ainsi que dans une quinzaine de pays d’Afrique et d’Asie.
Allons conquérir le monde, soit, mais commençons donc par être meilleurs dans notre propre cour.
À lire aussi : L’économie franco-canadienne doit se tourner vers l’est et l’ouest

Robert Gauvin, ministre responsable de la Francophonie du Nouveau-Brunswick, affirme que c’est le rôle des gouvernements provinciaux «d’ouvrir leurs portes» pour permettre le commerce interprovincial.
Le Nouveau-Brunswick travaille actuellement à renouveler ses ententes de coopération en francophonie canadienne avec le Manitoba et le Québec, son principal partenaire.
«On exporte et on échange avec le Québec pour 7,5 milliards de dollars, soit 32 % de nos échanges interprovinciaux», affirme le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Francophonie du Nouveau-Brunswick, Robert Gauvin, en entrevue avec Francopresse.
La province est actuellement en discussion avec l’Ontario pour signer une entente formelle en francophonie canadienne l’an prochain.
Sur la scène internationale, le Nouveau-Brunswick est membre de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), ce qui facilite les relations et les échanges, indique le ministre Gauvin.
Sachant que son gouvernement effectuait 92 % de ses exportations vers les États-Unis avant l’élection de Donald Trump, Robert Gauvin assure qu’il est primordial «de reconnaitre nos amis, nos partenaires et de diversifier justement nos exportations, nos liens d’affaires et nos relations».
Contactés, les ministères responsables de la francophonie en l’Alberta, en Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest n’avaient toutefois pas répondu à nos demandes au moment de la publication.
À lire aussi : Entrepreneuriat des jeunes : «le bilinguisme est un atout incontestable»