«L’avis de la Cour internationale de justice (CIJ) est une nouvelle arme juridique, utile pour toutes les poursuites climatiques contre des États et des entreprises», affirme Thomas Burelli, professeur de droit à l’Université d’Ottawa et directeur du Centre du droit de l’environnement et de la durabilité mondiale.
Le juriste fait référence à la décision rendue par la CIJ, le 23 juillet, qui fera date dans l’histoire.
Les États violant leurs obligations climatiques pourraient se voir réclamer des réparations par les pays les plus touchés, a conclu la plus haute instance juridique de l’Organisation des Nations unies (ONU).
Si un État qui s’estime lésé arrive à montrer que l’action – ou l’inaction – d’un pays lui cause des torts, il pourrait alors exiger que cessent les activités polluantes en question.

C’est historique, ça marque à la fois un tournant en termes de négociations sur le climat et ça clarifie les obligations d’agir des États pour limiter la hausse des températures
«Grand poids juridique, normatif et politique»
Bien que non contraignant, cet avis «majeur aura un impact sur le droit canadien et la jurisprudence au pays», estime Albert Lalonde, coresponsable du Laboratoire conscience climatique de la Fondation David Suzuki.
«La CIJ est une autorité sans équivoque, reconnue et respectée par la communauté internationale», assure-t-il.
La décision crée un précédent. Les avocats doivent déjà inclure l’avis dans leurs argumentaires juridiques, car il a un grand poids juridique, normatif et politique
L’avis pourra être utilisé dans plusieurs causes canadiennes qui attendent toujours leur dénouement. C’est notamment le cas de la poursuite La Rose c. Sa Majesté le Roi, intentée en octobre 2019 par 15 jeunes.
Ces plaignants et plaignantes reprochent au gouvernement fédéral de brimer leur droit de jouir d’un environnement propre et sain. Ils l’accusent également de compromettre leur avenir en contribuant, par ses actions, aux changements climatiques et en échouant à réduire suffisamment les émissions de gaz à effet de serre (GES).
En décembre 2023, la Cour d’appel fédérale a jugé leur requête recevable. Un tribunal devra déterminer, en octobre 2026, si les actions d’Ottawa violent les droits des jeunes plaignants en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, notamment de son article 7, qui protège les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité.
La Charte canadienne à la lumière de l’avis de la CIJ
«Le gouvernement jugeait notre poursuite trop vaste, trop complexe et trop politique, explique Albert Lalonde, l’un des membres de la poursuite. Mais la CIJ vient de nous donner raison sur le fond de notre raisonnement. Ça simplifie notre travail de défense.»
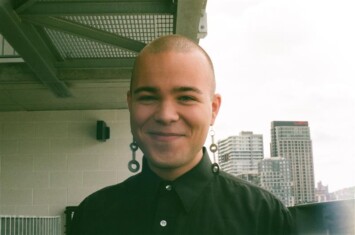
«Les règles qu’énonce la CIJ sont très pertinentes pour notre poursuite», considère Albert Lalonde, l’un des plaignants dans l’affaire La Rose c. Sa Majesté le Roi.
Dans sa décision, la CIJ a en effet établi que les États ont l’obligation de :
- réduire leurs émissions de GES, de contribuer à l’objectif commun
- limiter la hausse des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, de prévenir les dommages environnementaux,
- garantir le droit à un environnement propre, sain et durable,
- coopérer de bonne foi avec les autres pays pour protéger les populations, surtout les plus vulnérables.
Un autre litige climatique, Mathur contre Ontario, est devant les tribunaux. Sept jeunes Ontariennes allèguent que l’objectif de réduction des GES du gouvernement ontarien de Doug Ford est insuffisant et enfreint leurs droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.
Leur contestation sera entendue une deuxième fois devant la Cour supérieure de l’Ontario les 1er et 2 décembre prochain.
L’avis de la CIJ donne vraiment de l’espoir à nos clients, car en matière de changements climatiques, les juges canadiens se tournent souvent vers des juridictions étrangères pour obtenir des conseils sur la manière d’interpréter ce type de questions juridiques nouvelles
Dans ces deux affaires, le professeur de droit de l’Université métropolitaine de Toronto, Christopher Campbell-Duruflé, s’attend lui aussi à ce que la Charte canadienne soit interprétée à la lumière de l’avis de la CIJ, «car il existe une jurisprudence constante de la Cour suprême selon laquelle la Charte doit protéger tout autant que le droit international.»
À lire aussi : Écoanxiété : passer de la peur à l’action
«Signal très fort» au Canada

«Le Canada a une obligation de bonne foi de mettre en œuvre la décision de la CIJ. C’est le moment de faire une pause et de voir si les lois et les règlements sont conformes à l’avis», souligne le professeur Christopher Campbell-Duruflé.
Selon la CIJ, les États ont par ailleurs une «obligation de diligence» qui les contraint à mieux contrôler les activités du secteur privé, y compris celles de l’industrie pétrolière et gazière.
«Le Canada doit être vigilant dans la conduite de ses affaires internes et adopter les lois et les règlements nécessaires pour réduire ses émissions de GES», insiste Christopher Campbell-Duruflé.
Thomas Burelli estime également que «l’avis envoie un signal très fort». «Ça doit probablement faire réfléchir le gouvernement, mais je ne pense pas que le Canada arrêtera pour autant l’exploitation des énergies fossiles.»
Ce dernier avance que dans le cadre d’éventuelles poursuites contre le projet de loi C-5 ou des projets d’intérêt national autorisés dans le cadre de cette loi, «les plaignants se saisiront sans doute de la décision de la CIJ».
«Le Canada doit désormais évaluer tous les nouveaux projets de pipelines, d’exploitation de gaz, de pétrole ou de sables bitumineux à la lumière de son devoir de diligence», poursuit Christopher Campbell-Duruflé.
À moyen terme, Thomas Burelli anticipe de son côté de nouvelles poursuites judiciaires entamées par différents États et organisations contre le Canada, quatrième producteur de pétrole au monde.
À ses yeux, les pays les plus touchés par le réchauffement climatique pourraient exercer davantage de «pressions diplomatiques» sur Ottawa dans le but d’obtenir des programmes d’aide et du financement.
À lire aussi : Agriculture et climat : une relation compliquée
Revers pour le Canada
La CIJ a rejeté l’idée, défendue notamment par le Canada, que les traités climatiques existants – et notamment le processus de négociation des conférences des Nations unies (COP) annuelles – étaient suffisants. Les États ont «des obligations strictes de protéger le système climatique», a-t-elle argüé.
À l’image d’autres grands pays émetteurs de GES, le Canada soutenait que le droit coutumier, soit les règles de base reconnues par la communauté internationale sans être écrites dans des traités, ne s’appliquait pas aux questions climatiques.
«La Cour a dit qu’aller aux COP, établir des cibles de réduction, c’était insuffisant pour qu’un pays respecte ses obligations climatiques», explique Thomas Burelli.
Selon le juriste, l’avis changera les rapports de force lors des négociations internationales sur le climat : «Ce sera très discuté lors de la COP 30, qui a lieu en novembre. Reste à savoir si ça va refroidir les négociateurs ou, au contraire, avoir un effet catalyseur.»











