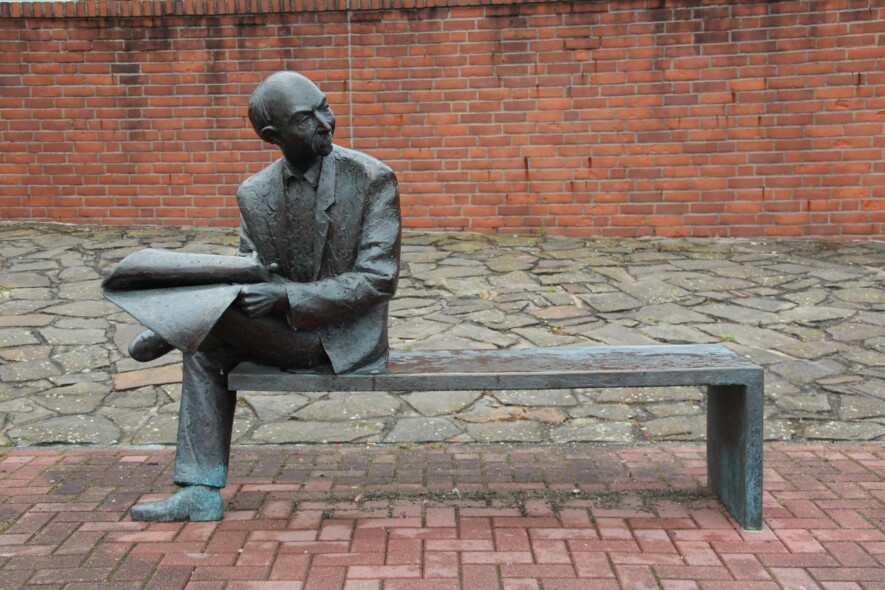Le Livre blanc : Vérités, défis, occasions à saisir et pistes d’avenir sur les médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire (MCLOSM) et été rédigé à partir d’une autoévaluation de ces derniers, d’un sondage auprès des francophones de l’extérieur du Québec et des anglophones du Québec, des témoignages d’acteurs clés, d’entretiens qualitatifs réalisés auprès de leadeurs communautaires, institutionnels et sectoriels, ainsi que d’une recension des écrits sur le sujet.
Pour revigorer les journaux et les radios de langue minoritaire, le Livre blanc propose des pistes d’interventions nécessitant l’engagement simultané de quatre secteurs.
À lire aussi : La presse francophone minoritaire, un média qui a du caractère
Repenser leur modèle et attirer les jeunes
Les médias eux-mêmes détiennent la première clé. Ils doivent «affirmer [leur] rôle non seulement comme fournisseur d’information locale, mais aussi comme créateur de valeur identitaire, linguistique et culturelle». Ils doivent repenser leur modèle d’affaires, intensifier leur transformation technologique et mobiliser leurs publics, particulièrement les jeunes.
Leurs efforts seront cependant vains s’ils ne reçoivent pas d’appui. Au premier chef, les organismes qui les représentent – Réseau.Presse (éditeur de Francopresse), l’Alliance des radios communautaires du Canada, Quebec Community Newspapers Association, le English-Language Arts Network et le Consortium – doivent promouvoir les MCLOSM, appuyer la mutualisation de certains services et poursuivre les négociations avec divers bailleurs de fonds.
C’est quoi le Consortium?
Réseau.Presse, l’Alliance des radios communautaires du Canada, Quebec Community Newspapers Association et English-Language Arts Network ont conjointement créé le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire en 2016. Il leur permet d’avoir une voix plus forte pour leurs revendications communes.
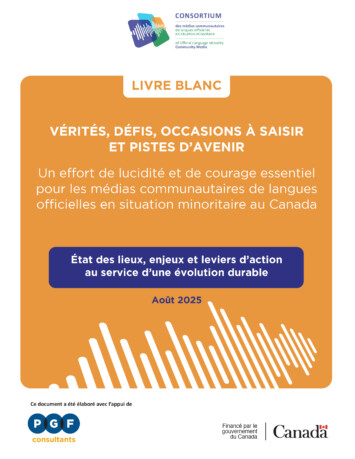
Les francophones et les organismes qui composent les communautés de langues officielles en milieu minoritaire ont également un rôle important à jouer. Les médias locaux doivent être intégrés dans les stratégies locales, le développement de contenu et les habitudes de consommations, avance le document.
Finalement, les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral doivent reconnaitre le rôle essentiel des MCLOSM dans la vitalité de leur communauté. En plus de les soutenir avec «une part équitable, récurrente et stable de la publicité gouvernementale», ils devront aussi fournir du financement prévisible pour permettre une planification à long terme et l’adaptation constante requise par le numérique.
Le gouvernement du Canada devrait aussi modifier ses règlements et ses critères pour permettre à un plus grand nombre de ces médias d’avoir accès à certaines mesures fiscales.
À lire : Renouvèlement de l’IJL : une francophonie plus riche
Un constant alarmant
Les médias de langues officielles en milieu minoritaire font face aux mêmes défis financiers que les autres médias canadiens. Le Livre blanc fait cependant état de plusieurs autres lacunes qui leur sont propres.
Lors des entretiens, 78 % des acteurs et actrices de l’écosystème ont souligné des enjeux financiers. Dans l’enquête par autoévaluations, environ les deux tiers des MCLOSM révèlent disposer d’un budget annuel de moins de 500 000 $.
Le bassin de talents potentiels pour travailler dans ces médias est de plus en plus limité et des programmes de formation ont disparu au cours des dernières années. Les MCLOSM jouent par conséquent souvent un rôle de formateur qui n’est pas reconnu dans le secteur et par les gouvernements.
Un peu plus du quart des médias sondés disent compter moins de deux employés à temps plein – ce qui peut inclure le personnel administratif –, 47 % ont moins de deux pigistes ou contractuels.
Votre francophonie au bout des doigts
Lisez notre infolettre
les mercredis et samedis
Un virage numérique sans issue?
Les plus grands défis à relever se trouvent du côté de la stratégie numérique des médias écrits et des radios. Dans leur autoévaluation, ils rapportent ne pas être outillés pour le réaliser pleinement.
Auto-identification des capacités numérique des MCLOSM
- 74 % n’ont pas de plan d’action numérique;
- 56 % n’ont pas de personnel dédié à la présence numérique;
- 88 % ont des ressources humaines insuffisantes pour y arriver;
- 81 % manquent de financement;
- 65 % manquent de temps et de formation.
Combler tous ces retards ne règlera cependant pas tous les problèmes, rappelle-t-on dans le Livre blanc. Une fois sur le Web, les médias sont en compétition contre tout ce qu’il y a sur la toile, tentent de rejoindre des publics sur de grandes étendues géographiques et desservent des «marchés de niche difficilement monétisables».
Par conséquent, «les retombées financières demeurent insuffisantes pour que les canaux numériques assurent une source de revenus viable, capable de soutenir adéquatement les salles de rédaction ou le fonctionnement des médias».
À lire : Les petits médias francophones face aux défis de la vidéo
Un public varié
Selon le sondage réalisé par la firme Nanos pour alimenter la réflexion, 45 % des francophones de l’extérieur du Québec consomment le contenu d’au moins un média écrit, principalement pour s’informer sur l’actualité locale et pour lire en français. Pour les radios francophones, 44 % des répondants disent les écouter.
Les journaux bénéficient d’un taux de satisfaction et de confiance élevé : 76 % des 666 francophones de l’extérieur du Québec qui ont répondu au sondage en ligne estiment que leur journal fait un très bon ou un bon travail. Leur niveau de confiance envers ceux-ci est supérieur à celui accordé aux médias privés, mais inférieur à celui du diffuseur public.
Bien que les 18 à 34 ans figurent parmi les principaux consommateurs de contenus des journaux communautaires locaux de langue officielle minoritaire selon le sondage, leurs habitudes se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux. Des efforts accrus seront nécessaires pour parvenir à les rejoindre.
Démocratie et tensions locales
«Le rôle crucial de ces médias sur le plan démocratique demeure largement sous-estimé, voire méconnu, par une partie du public et des décisionnaires», relève encore le document. Ces médias accompagnent pourtant les communautés de langues officielles en situation minoritaire dans leur développement du sentiment d’appartenance, la préservation de l’identité culturelle et la vitalité.
Si les recommandations du Livre blanc encouragent un rapprochement entre les médias et la communauté qu’ils couvrent, il reconnait le défi que cela représente.
L’indépendance et la déontologie journalistique peuvent créer des tensions éditoriales avec les organismes communautaires. Le rôle démocratique d’un média peut ainsi décourager certains membres de la communauté ou certaines associations à collaborer avec ceux-ci.
À lire : Achat de publicité à Meta : un «pied de nez» par Ottawa aux médias locaux