
Que ce soit comme journaliste, autrice, conférencière ou autre, Robertine Barry a défendu la condition féminine.
Mais ce n’est pas avec sa voix que Robertine Barry ébranlera les colonnes du temple de la société patriarcale dans laquelle elle vivait, mais avec sa plume, sous le nom de Françoise.
Réputée être la première canadienne-française à gagner sa vie comme journaliste, cette célibataire libre-penseuse, vivant dans un monde conservateur sur lequel l’Église exerce encore une grande emprise, ira complètement à l’encontre de l’idéal féminin de l’époque, selon lequel elle aurait dû être une épouse et une mère dévouée.
Les mots, qui ont été l’épée par laquelle cette féministe avant l’heure a revendiqué une meilleure condition pour les femmes, ont été présents dès sa jeune enfance.
Robertine grandit dans une famille à l’aise. Née à L’Isle-Verte, au Québec, en 1863, elle était neuvième de treize enfants. Elle se plonge très jeune dans les œuvres de La Fontaine, puis de Hugo, de Lamartine et même des sœurs Brontë.
Après l’école primaire, Robertine ira parfaire son éducation classique au couvent Jésus-Marie à Trois-Pistoles, puis chez les Ursulines à Québec.
Le voile ou la plume?

Fondateur et directeur du journal La Patrie, Honoré Beaugrand donnera à Robertine Barry sa première chance comme journaliste.
À son retour de Québec à Trois-Pistoles, où sa famille s’est installée, elle songe un moment à devenir religieuse comme sa sœur Évelyne.
Sur les conseils de son père, elle part à Halifax pour y enseigner la musique dans un couvent, question de voir si elle a la vocation. La réponse sera non.
Elle décide alors de tenter sa chance à l’écriture, et particulièrement au journalisme. Mais le risque est grand, car en son temps, très peu de femmes peuvent vivre de ce métier.
Elle sollicitera plusieurs éditeurs et essuiera plusieurs refus, jusqu’à ce qu’elle rencontre, en 1891, Honoré Beaugrand, directeur fondateur de La Patrie, l’un des grands journaux canadiens-français de l’époque.
Beaugrand est bien connu pour ses idées libérales radicales et anticléricales. Il embauche Robertine, mais surtout, il ne la confine pas aux pages féminines comme c’était la coutume à l’époque.
Robertine devient Françoise
Robertine Barry va alors déployer ses ailes. Elle prend le nom de plume de Françoise, en l’honneur de saint François de Sales. Dès ses débuts, elle revendique le droit des filles à l’instruction et s’en prend aux mentalités conservatrices.
Ella connaitra bientôt une certaine notoriété avec sa «Chronique du lundi» qu’Honoré Beaugrand publie en première page du journal.
Françoise s’en donne à cœur joie. Ses textes portent, entre autres, sur le droit de vote des femmes, le besoin d’interdire juridiquement le travail des enfants, la mise en place de refuges pour les femmes victimes de violence et l’éducation laïque.
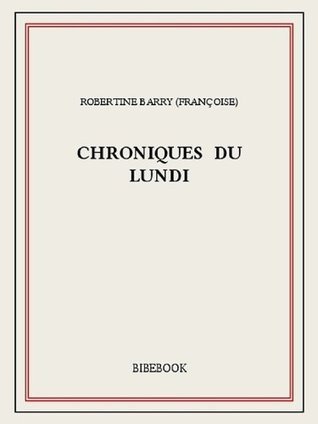
Recueil de certains numéros de la «Chronique du lundi» de Françoise, parue dans le journal La Patrie.
Elle réclame même pour les femmes l’accès à l’université et le droit d’exercer les mêmes professions que les hommes. La décrire comme une avant-gardiste serait un euphémisme.
Ses prises de position vont à l’encontre de plusieurs personnalités en vue, dont Henri Bourassa, futur fondateur du journal québécois Le Devoir et antiféministe. Certains, par dérision, l’appellent d’ailleurs «Monsieur».
Écrite à la première personne, sous la forme d’une conversation, mélangeant digressions, anecdotes et humour, la «Chronique du lundi» sera publiée jusqu’en 1900. Françoise publiera à compte d’auteur un recueil regroupant ses chroniques du début de sa carrière.
Pendant ces années, elle écrira aussi pour d’autres journaux et magazines montréalais, comme Le Coin du feu, le Bulletin, le Franc Parler, la Femme et plusieurs autres.
Représentante du Canada à des expositions universelles
La réputation de Françoise ne fait que grandir. Avec une autre pionnière journaliste canadienne-française, Joséphine Dandurand (née Marchand), elle sera représentante des Canadiennes à l’Exposition universelle de Paris en 1900.
Elle sera également déléguée aux expositions universelles de Saint-Louis au Missouri en 1904 et de Milan en 1906. Lors de ce dernier voyage, elle aura d’ailleurs une rencontre officielle avec le pape Pie X.
Le voyage à Paris mettra fin à sa collaboration avec le journal d’Honoré Beaugrand. De retour à Montréal, elle est atteinte de la fièvre typhoïde, mais rien n’arrête cette femme d’une énergie et d’une détermination hors du commun.
Une fois remise de sa maladie, elle fonde en 1902, avec ses propres économies, Le Journal de Françoise, qu’elle dirigera jusqu’en 1909 et qui restera son œuvre majeure. Plus de 500 collaborateurs signeront des textes dans cette publication, dont certains noms réputés tels qu’Émile Nelligan.
Une amitié intime
Puisqu’on en parle, ouvrons une petite parenthèse sur les liens entre l’auteur de Soir d’hiver et du Vaisseau d’or et Françoise.
Dès 1999, des murmures se font entendre voulant que le poète soit épris de la journaliste, de 16 ans son ainée. Françoise, qui est une amie de sa mère, accueille Nelligan à plusieurs reprises chez elle à Montréal. Il lui récite de ses poèmes et se confie en elle ; elle lui donne des conseils.
On ne sait pas jusqu’où ira cette relation, mais Nelligan évoquera Françoise dans plusieurs poèmes enflammés, dont Rêve d’artiste, dans lequel il la nomme «sa sœur d’amitié». Puis, une brouille s’installera entre les deux.
Robertine Barry, dite Françoise, s’engage aussi dans des regroupements féminins, dont en tant que vice-présidente du Canadian’s Women Press et présidente de l’Association des femmes journalistes canadiennes-françaises.

Premier conseil d’administration de Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, dont Robertine Barry (en bas, à droite) a été cofondatrice.
Elle fera partie en 1907 du premier conseil d’administration de la première association féministe canadienne-française, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste.
Elle participera aussi à la fondation d’un premier collège classique féminin qui deviendra le Collège Marguerite-Bourgeois.
Elle n’arrête pas d’écrire pour autant. Elle écrira notamment une pièce de théâtre, Méprise, en 1905. Le premier ministre canadien Wilfrid Laurier viendra à Montréal pour la voir.
Après la fermeture du Journal de Françoise, en 1909, la dépression la guette. Elle fait un dernier voyage à Paris et meurt quelques mois après son retour, le 7 janvier 1910. Elle avait 46 ans.
Elle aura été célibataire toute sa vie. Robertine Barry, dite Françoise, a beaucoup écrit sur la question pour souligner la liberté que le célibat lui apportait. Un jour, dans son journal personnel, elle a écrit : «Je ne suis pas de celles qui considèrent le mariage comme le but vers lequel doivent tendre les plus nobles efforts de toute une vie.»
Quelqu’un d’autre écrira, bien plus tard : la femme est l’avenir de l’homme.
L’homme derrière ce premier guichet était un ingénieur écossais du nom de John Shepherd-Barron. Pour la petite histoire, on raconte qu’un vendredi de 1965, il a fait face à des portes closes, à la banque, alors qu’il voulait retirer de l’argent. Situation pour le moins gênante pour ce dirigeant de la société De La Rue, qui entre autres, imprimait des billets de banque…

C’est à la succursale d’Enfield de la banque Barclays qu’a été inauguré le premier guichet automatique du monde, le 27 juin 1967.
Assez contrarié, il rentre chez lui. Alors qu’il prend un bain, il réfléchit à tout ça et paf!, c’est la révélation : si on peut le faire pour les barres de chocolat, on peut aussi le faire pour des billets de banque! Il faut croire que, dans son bain, John Shepherd-Barron ne jouait pas au sous-marin. De La Rue s’associera à la Barclays pour écrire l’histoire.
Mais il s’en est fallu de peu pour que la Barclays se fasse damer le pion.
Quelques jours après l’ouverture du premier guichet, la suédoise Uppsala Sparbank, inaugurait, le 6 juillet 1967, un distributeur de monnaie (nommé Bankomat) mis au point par la société Metior. Presque en même temps, une autre banque britannique, la Westminster Bank, mettait en fonction son distributeur.
Comme on le voit, plusieurs personnes planchaient en même temps sur cette idée, dont des inventeurs aux États-Unis, où le premier guichet entrera en activité le 2 septembre 1969, dans une succursale de la Chemical Bank à New York.
Vu longtemps comme «l’inventeur» du guichet automatique, John Shepherd-Barron est décoré en 2005 de l’Ordre de l’Empire britannique pour son exploit. C’est alors que son titre d’inventeur sera contesté par James Goodfellow.
Écossais lui aussi, Goodfellow est le cerveau derrière le guichet de la Westminster Bank. Et il a un brevet du 2 mai 1966 pour le prouver.
D’ailleurs, on le considère également comme l’inventeur du NIP (numéro d’identification personnel), qui permet à une personne d’avoir une carte unique pour accéder aux guichets. Shepherd-Barron soutiendra aussi être l’inventeur du NIP. C’est cela, oui.
Interrogé sur son rival écossais en 2005, Shepherd-Barron dira que ce qui le démarque de Goodfellow est qu’il a mis au point tout le système des guichets automatiques. Selon lui, la machine de son rival était un «échec élégant». Et les gants étaient jetés.
La confusion au Canada aussi
Qu’en est-il au Canada? Qui a gagné la course au premier guichet automatique? C’est selon.
En fait, deux histoires contradictoires circulent.

La CIBC a été la première à mettre en service un guichet automatique au Canada, en 1969. Ou peut-être pas selon la coopérative Sherwood Credit Union de la Saskatchewan.
D’un côté, il y a la CIBC qui revendique la palme. Le premier guichet de cette banque a été mis en service le 1er décembre 1969 à Toronto. Les clients pouvaient retirer un maximum de 30 dollars, ce qui permettait à l’époque d’acheter probablement une voiture, un chalet et toute la collection des Beatles. Petite exagération.
De l’autre côté, alors que l’on trouve bien des références corroborant cette première place, d’autres sources renvoient plutôt à la coopérative saskatchewanaise de crédit Sherwood Credit Union (maintenant Conexus).
L’Encyclopédie de la Saskatchewan explique que les deux guichets de cette coopérative à Régina ont ouvert en… 1977, soit bien après celui de la CIBC et, d’ailleurs, celui du Québec en 1972.
Malheureusement, il a été impossible pour Le Rétroviseur de faire la lumière sur cette épineuse question. Disons seulement qu’il serait étonnant que les premiers guichets soient apparus au Canada si longtemps (11 ans) après leur invention. Disons.
À la conquête du monde
Ce qui est sans équivoque, c’est que les guichets n’ont pas pris de temps à se répandre partout sur la planète.

Combien de temps reste-t-il avant que nous chantions le requiem de l’argent comptant?
Dès la fin de 1971, environ 1000 distributeurs sont installés dans le monde. En 1997, ils prouvent leur utilité à New York lorsqu’un blizzard frappe la ville et force les banques à demeurer fermées pendant plusieurs jours. Les guichets, eux, ont fait face aux intempéries et ont pu continuer le travail. Pas de répit pour Mélanie.
Comme des lapins, les guichets automatiques se sont multipliés. De 100 000 en 1984, le nombre de guichets dépasse maintenant trois-millions d’unités, dont 70 000 au Canada. Par ici la monnaie.
Le début de la fin?
A-t-on atteint l’apogée? Les statistiques montrent qu’un déclin général s’est amorcé en 2021. Ici et là, les guichets sont… moins aguichants.
Il serait facile de penser que la pandémie est en cause, mais en fait, la baisse avait commencé à se manifester quelques années auparavant, comme en France, qui a noté une diminution de la fréquence de l’utilisation dès 2016, ainsi qu’en Belgique. Aux États-Unis, le nombre de guichets a baissé de 450 000 en 2022.
Au Canada, dans le réseau Desjardins, le guichet était en chute libre : une machine sur cinq a disparu entre 2015 et 2019. En 2018, le PDG Guy Cormier créait l’émoi en prédisant la fin du guichet en 2028!

Même des transactions en bitcoins sont possibles à certains guichets automatiques, comme celui-ci au Massachusetts.
Le coupable? De plus en plus, les transactions s’effectuent par carte de débit, carte de crédit ou autres moyens électroniques. Une tendance lourde.
Par contre, les guichets n’ont pas dit leur dernier mot pour autant et l’industrie tente de se réinventer.
Mais l’autre menace qui guette les guichets est l’avenir de l’argent comptant. Certains, comme le patron de la Deutsche Bank, John Cryan, prédisait en 2017 que «le cash n’existera probablement plus dans dix ans». Il ne reste donc que quatre ans avant sa disparition.
La question qui tue : comme la Banque du Canada a indiqué qu’il faudra attendre quelques années avant que les nouveaux billets de banque à l’effigie de Charles III soient en circulation, le nouveau monarque gagnera-t-il cette course contre la montre? Le temps, c’est de l’argent.
P.-S. – Question d’«aguicher» les partisans, 1967 est aussi la dernière année où les Maple Leafs de Toronto ont gagné la coupe Stanley.
L’orthographe rectifiée — ou la nouvelle orthographe — a 33 ans. Ce chiffre peut avoir plusieurs sens.
C’est «l’âge du Christ», disait-on souvent «dans le temps». Les opposants à l’orthographe rectifiée pourraient donc dire qu’il s’agit du moment idéal pour «crucifier» cette réforme.

L’hymne des pythagoriciens au soleil levant représente des disciples de Pythagore chantant des Vers d’Or (ou Dorés) attribués à leur maitre après sa mort.
Mais les partisans des «nénufars» de ce monde peuvent s’inspirer du fait que «33» est un chiffre sacré, selon les adeptes de la numérologie inspirés de Pythagore, ce mathématicien que l’on connait surtout pour son célèbre théorème. Un sacré numéro que ce Pythagore.
Pour terminer sur la symbolique du chiffre 33, disons que dans l’islam, tous les gens qui vont au paradis ont 33 ans à leur arrivée. Qu’importe, tout le monde veut aller au ciel, oui mais personne ne veut mourir.
Malgré cette tentative de diversion, nous devons revenir au sujet du jour.
Les prémices de l’orthographe rectifiée
En 1989, le premier ministre français Michel Rocard crée le Conseil supérieur de la langue française et lui confie, entre autres, comme mission de proposer des rectifications à l’orthographe de la langue française.

Maurice Druon a présidé la réforme de l’orthographe, il y a 33 ans.
Pour accomplir cette tâche, ô combien ingrate, le Conseil forme ensuite un comité d’experts présidé par le respectable Maurice Druon.
Pour ceux qui ne connaitraient pas Druon, résumons : tour à tour, militaire, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, écrivain (Goncourt 1948), dramaturge, gaulliste et ministre sous Pompidou, député… Un homme aux 33 métiers quoi!
Ah oui, et entretemps, il avait été élu à l’Académie française, puis en était devenu secrétaire perpétuel. Immortel et perpétuel… tout un contrat. Il est, malgré tout, mort en 2009. Pour dire… un titre, ça demeure juste un titre.
C’est donc en tant que secrétaire perpétuel de l’Académie et pour l’ensemble de son œuvre que l’immortel et perpétuel Maurice Druon pilote la grande réforme de l’orthographe.
En décembre 1990, le résultat des travaux du comité est présenté par cet auteur des Rois maudits. Des Rois maudits à l’orthographe maudite, il n’y a qu’un pas qu’il est possible de franchir sans même y penser. C’est fait.
La guerre des mots
Avant de poursuivre, impossible de ne pas jeter un petit coup d’œil dans le passé. Le présent récit ne s’appelle pas Dans le rétroviseur pour rien.

En 1694, les membres de l’Académie française remettaient au roi Louis XIV la première édition de leur dictionnaire.
Depuis des siècles, les Français se disputent entre eux sur la façon d’écrire les mots. L’arrivée de l’imprimerie soulève le besoin d’une orthographe commune. Oui, mais laquelle?
Certains défendent l’orthographe dite étymologique, qui tend à conserver des lettres qu’on ne prononce pas, afin de maintenir une trace de leur origine latine ou grecque. Par exemple, le mot «savoir» était écrit à l’époque «sçavoir», car il dérivait du latin scire. Fallait le savoir. Passons.
D’autres, comme Louis Meigret, auteur de la première grammaire française, Tretté de la grammere francoeze, milite plutôt pour une orthographe phonétique ; il était en fait le premier à dire qu’il faudrait «écrire comme on parle». Ce sera partie remise.
On retrouvait également une multitude de lettres doublées ou de lettres muettes sans que ce soit nécessaire. Des rumeurs circulent voulant que les scribes, alors parmi les rares ayant le privilège de l’écriture, en soient les grands responsables. C’est que, ces suspects numéro un étaient payés selon la longueur de leur texte. Mais ce ne sont que des rumeurs…
Et que dire du son /ε̃/ comme dans hein? En français, on l’écrit de 23 façons.
L’Académie à la rescousse
Pour mettre de l’ordre dans ce capharnaüm de la langue écrite, le cardinal de Richelieu fonde en 1634 (ou 1635) l’Académie française, qui a pour principale mission de «donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences».
Pour y arriver, l’Académie compilera notamment — et surtout — un Dictionnaire, dont la première édition sera présentée… 60 ans plus tard. Ces choses-là prennent du temps, que voulez-vous.

L’Académie française, 1897.
L’Académie était alors très attachée à l’orthographe «ancienne», parce qu’on pouvait y déceler l’origine des mots.
Pour François Eudes de Mézeray, l’académicien qui va plancher sur les règles à définir, il valait mieux privilégier «l’ancienne orthographe, qui distingue les gens de Lettres d’avec les Ignorants et les simples femmes». Disons qu’il ne serait pas très populaire de nos jours.
L’orthographe sera réformée régulièrement au fil des éditions du Dictionnaire. En 1740, plus de 6 000 mots sur les 17 500 environ que comptait l’ouvrage sont modifiés.
Par exemple, on remplace des «s» par des accents circonflexes sur la voyelle précédente (apostre-apôtre), on élimine des consonnes muettes (advocat-avocat), on remplace des «y» par des «i» (cecy-ceci), etc.
Voltaire, alors membre de l’Académie, avait convaincu ses pairs de remplacer le «oi» par le «ai» dans les mots comme françois, anglois ou j’estoi. Bonne idée.
La réforme de 1990 n’est donc que la dernière mouture d’une longue suite de modifications à la langue française.
Qu’a changé la dernière rectification?
Bof, finalement, surtout de petites choses, quoique parfois ce sont les plus petites qui dérangent le plus. Comme leadeur qui a remplacé leader. Ah oui, on l’a déjà dit. Et ognon qui a succédé à oignon. Mentionné aussi.
Allo a perdu son accent circonflexe. Chapeau! Bigbang n’a plus son trait d’union (qui n’en a pas un d’ailleurs), tout comme millepatte (qui a aussi perdu son «s» au singulier).
Entre 1 400 et 5 000 modifications ont été «proposées». Les modifications sont proposées parce qu’elles ne sont pas obligatoires ; l’orthographe traditionnelle et la nouvelle sont admises. Ouf!
L’orthographe rectifiée, disions-nous, a 33 ans. Un âge charnière. «L’année du bonheur», à en croire un sondage où la majorité des répondants (70 %) ont indiqué avoir véritablement atteint cet état de plénitude à l’âge de 33 ans.
L’avenir semble prometteur pour l’orthographe. Bonne raison pour se réconcilier avec elle…

Le roi anglais Édouard 1er s’est approprié la pierre de Scone en Écosse pour la faire transporter à Londres.
Allons-y.
Toute cette affaire date du jour où le roi d’Angleterre Édouard 1er a carrément volé la pierre de Scone. Ce genre de choses arrive.
Quelques détails plus ou moins importants ici : la pierre est faite de grès jaune. Elle mesure environ 67 cm de long sur 27 cm de large et 42 cm d’épaisseur.
Curieusement, c’est à peu près la taille d’un épagneul… Cavalier King Charles, un chien nommé en honneur du roi Charles II, qui vouait presque un culte envers cette race de chien. Bref, c’était le corgi du XVIIe siècle.
Édouard 1er était surnommé Longshanks ou «longues jambes» (il faisait 1,90 m). Les cinéphiles qui ont vu le film Cœur vaillant (Braveheart) savent que le héros William Wallace lutte héroïquement pour empêcher ce roi d’Angleterre d’envahir l’Écosse.
Divulgâchons gaiment : à la fin, William Wallace, alias Cœur vaillant, est capturé, pendu, éviscéré et écartelé. Bref, il meurt.
Après quelques années de guerre, l’Écosse obtient son indépendance de l’Angleterre, puis la perd et la regagne jusqu’à ce que le roi Jacques VI d’Écosse unisse les deux royaumes en devenant aussi roi d’Angleterre après la mort d’Elizabeth 1re, celle qui avait fait tuer sa mère, la reine Marie Stuart. La belle époque.

Chaise de couronnement et de la pierre de Scone.
Donc, avant son petit différend avec Wallace, Édouard 1er, grâce sans doute à sa haute stature, avait réussi en 1296 à «enjamber» la frontière écossaise et à envahir le pays. L’occupation est temporaire, mais Édouard — nous y voilà — parvient à dérober la pierre de Scone et à l’apporter à Londres. On lui jette la première vous savez quoi? C’était peut-être le plus grand des voleurs. Oui, mais pas un gentleman. Demandez à Wallace.
La tant convoitée pierre du destin est installée à l’abbaye de Westminster, où étaient couronnés les souverains anglais depuis Guillaume le Conquérant. Notre, hum, bon roi Édouard fait construire sur mesure un trône, qu’on appellera «chaise du couronnement» afin d’y insérer la fameuse pierre sous le siège.
C’est sur ce trône d’Édouard 1er, avec la pierre de Scone en prime, que seront couronnés tous les souverains anglais et britanniques qui suivront.
Mais pourquoi désirait-on tant ce petit bloc de roche pas plus gros qu’un épagneul pour ne plus s’en passer? Encore une fois, la réponse est dans le rétroviseur.
Un bloc vieux comme Hérode
Avant d’être dérobée, la pierre était conservée à l’abbaye de Scone (d’où son nom), où les anciens rois écossais étaient couronnés. D’ailleurs, le scone, ce petit… truc difficile à définir (ni gâteau, ni biscuit, ni pain – cake?) pourrait avoir été baptisé du nom de l’endroit.
Le Lia Fàil — nom de la pierre en gaélique — était auparavant sur l’ile d’Iona, près de la côte ouest du pays du biscuit sablé (qui, d’ailleurs, a curieusement une allure ressemblant à notre pierre).
Et avant? C’est ici où le mythe rencontre la légende, où l’Histoire laisse place aux fables.

La pierre de Scone ou pierre du destin.
Selon la tradition, la pierre de Scone tire ses origines d’une histoire biblique qui remonte à entre 1 800 et 1 500 années avant notre ère (pour dire vrai, on ne le sait pas vraiment). Vieux comme Hérode indeed!
C’est à cette époque très antique que vivait Jacob, l’un des trois patriarches de l’Ancien Testament avec son père Isaac et son grand-père Abraham. Un jour, Jacob s’endort, sa tête reposant sur une… pierre, d’où le surnom d’«oreiller de Jacob» qu’on donne parfois à la fameuse roche.
Pendant son sommeil, Jacob voit en songe une échelle qui monte jusqu’au ciel, et sur laquelle des anges montent et descendent. Voilà pour la partie biblique.
De là, la pierre de Jacob emprunte différents chemins selon les légendes. L’une d’elles veut que l’objet désormais sacré ait abouti en Égypte et, de là, ait été transporté en Sicile, puis en Espagne et enfin en Irlande. On aurait installé la pierre sur la mythique colline de Tara, où les anciens rois irlandais étaient acclamés. Puis, un souverain irlandais, Fergus Mor, l’aurait apportée en Écosse. Allez savoir pourquoi! Jacob le sait peut-être.
Selon un autre récit, une princesse égyptienne nommée Scota, descendante de Moïse, aurait transporté la pierre dans un pays à qui elle a donné son nom : Scotland (Écosse).
Mais depuis, les géologues ont prouvé que la pierre provenait d’une carrière de la région de Scone et non de la Judée… Quand la science vient gâcher une belle histoire.
Et c’est pas fini…
Retour vers le futur : après avoir reposé tranquillement pendant des centaines d’années à Londres, la pierre vivra quelques péripéties.
Le Canada a un peu de pierre de Scone dans son histoire.
Lors du bombardement allemand de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, la pierre a été retirée et cachée dans un endroit tenu secret.
Craignant le pire, les responsables de la pierre ont envoyé au Canada des plans indiquant son emplacement au premier ministre canadien de l’époque, William Lyon Mackenzie King, ainsi qu’au lieutenant-gouverneur de l’Ontario. Très «tripatif».
Et ça continue…

Comme ses prédécesseurs royaux de longue date, Charles III sera couronné sur la pierre de Scone.
En 1950, aux petites heures du jour de Noël, quatre étudiants écossais nationalistes, avec à leur tête un certain Ian Hamilton, réussissent à pénétrer dans l’abbaye de Westminster et dérobent la pierre pour la ramener à son ancienne patrie. Mais trois mois plus tard, la pierre au curieux destin est ramenée à Londres. Les étudiants ne seront pas poursuivis.
Toutefois, en 1996, 700 ans précisément après le larcin d’Édouard 1er, justice est enfin faite : la pierre de Scone est formellement remise à l’Écosse.
Elle trône depuis dans la «salle de la couronne» au château d’Édimbourg. L’Écosse, bon prince, a accepté de la «prêter» à la famille royale et de l’expédier à Londres pour le couronnement de ce bon vieux roi Charles.
Qui sait cependant ce qui pourrait se passer pendant le trajet? Si jamais, par malheur, quelque chose devait arriver à la pierre avant le couronnement, pas de panique! Un épagneul Cavalier King Charles pourrait très bien faire l’affaire.

La poutine râpée acadienne : le résultat final.
C’est un pur hasard si deux mets aussi populaires issus du Canada francophone partagent le nom de poutine. C’est d’ailleurs la seule chose – outre la patate – que la poutine québécoise et la poutine acadienne ont en commun. Et encore là, tout un monde sépare la frite de la boulette gluante.
Si vous lisez quelque part que la poutine râpée est le plat «national» de l’Acadie, détrompez-vous! C’est un plat traditionnel acadien, mais uniquement dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, dont la région de Moncton.
Dans ce coin d’Acadie, on la mange n’importe quand, pour les petites ou les grandes occasions. À Noël et pour les pas d’occasions pantoute.
Au fil du temps, elle est tout de même devenue emblématique au pays de la Sagouine. Dans sa mémorable interprétation des Douze jours de Noël (Twelve Days of Christmas), l’ancien groupe acadien Les Méchants Maquereaux reçoit, au premier jour, «un gros mess de poutine râpée».
À ne pas confondre avec râpure

Chez Mémère, à Moncton, l’un des nombreux restaurants qui se spécialisent dans la poutine râpée.
Quelques restaurants ont fait de ce plat leur spécialité. À Bouctouche, où se trouve le vrai Pays de la Sagouine, il y a La Poutine à Léa et La Poutine acadienne. Il y a aussi Saint-Antoine poutine râpée à… Saint-Antoine. À Moncton, Chez mémère poutine & râpée offre la poutine du jour et, pour 25 cents de rabais, la poutine d’hier. Curieux, car certains, comme la chanteuse acadienne Lisa LeBlanc, disent qu’elle est meilleure le lendemain. M’enfin.
Une variante appelée râpure garnit les tables acadiennes de l’Île-du-Prince-Édouard et de la baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse. Il y a aussi des dérivés comme la poutine à trou, d’apparence similaire, mais qui est un dessert.
L’origine du mot poutine? Étrangement, tant pour l’acadienne que la québécoise, certains ont pensé que «poutine» pourrait être une déformation de «pouding», francisation du mot anglais pudding, qui lui-même proviendrait du français «boudin». Mais cette hypothèse ne semble pas tenir la route. La poutine ne fera pas chanter les p’tits Simard.
Une chose cependant est sure : la poutine râpée précède de loin la poutine du Québec, inventée vers la fin des années 1950.
Sur la piste de la poutine râpée

Le père Clément Cormier a tenté de retracer les origines de la poutine râpée à travers divers écrits.
Alors, d’où vient la poutine râpée? Vous êtes au bon endroit pour le découvrir.
La référence en la matière est le père Clément Cormier. Il semble en effet être le seul à s’être vraiment penché sur le passé de ce plat de la gastronomie acadienne. Historien et bâtisseur de l’Acadie moderne, il a été, entre autres, le recteur-fondateur de l’Université de Moncton.
Dans le premier cahier de la Société historique acadienne, paru en 1961, le père Cormier signe un article «savoureux» intitulé La poutine râpée, aux yeux de l’histoire. C’est une enquête à caractère populaire, rédigée par cet homme d’Église avec un sourire en coin évident.
Dès le départ, il met cartes sur table : la poutine râpée n’est pas une tradition apportée de la France, car si c’était le cas, on la retrouverait dans les cuisines de toutes les régions acadiennes. (L’écrivain Melvin Gallant, coauteur de La cuisine traditionnelle en Acadie, souligne que la pomme de terre, originaire d’Amérique du Sud, n’a été répandue à grande échelle en France qu’au milieu du XVIIIe siècle, soit bien après que les Français aient colonisé l’Acadie.)
Le père Cormier le confirme, la poutine râpée ne fait pas l’unanimité en Acadie.
Le visiteur de Caraquet ou de Tracadie désillusionne son hôte de Shédiac en faisant la moue devant cette masse gluante ; s’il a le goût du risque, par délicatesse, il acceptera d’y goûter sans trop grimacer.
Ç’a l’avantage d’être direct!
Il en remet plus loin : «Le compatriote de la Baie Ste-Marie regardera avec dédain ces boulettes incolores. […] Il faut le reconnaître : à mesure qu’on s’éloigne de la région monctonienne, notre “mets acadien” perd de son attrait pour devenir objet d’indifférence, de suspicion, de répugnance.» Plus qu’un direct, c’est un uppercut!

Plaque qui commémore l’arrivée des familles allemandes fondatrices de la ville de Moncton. Dès leur arrivée, les colons ont planté 200 livres de… pommes de terre.
La filière allemande…
Le père Cormier raconte ensuite dans son récit qu’une Acadienne vivant en Pennsylvanie après la Seconde Guerre mondiale avait offert à manger à deux ex-prisonniers allemands, venus quémander de la nourriture. Elle leur avait servi des poutines râpées qu’elle venait de préparer. À la vue de ces boules de pommes de terre, les deux Allemands se seraient écriés : «c’est notre mets national!»
Ce curieux témoignage amène le père Cormier à se souvenir que la ville de Moncton a été fondée par quelques familles allemandes arrivées – par hasard – de Pennsylvanie – dans les années 1760. La poutine râpée serait-elle germanique? Kaum zu glauben!
En fait, pas si difficile à croire que ça. Il existe un plat très prisé en Allemagne, et ailleurs en Europe centrale et de l’Est, qui ressemble étrangement à la poutine acadienne. Le knödel a plusieurs variantes, mais l’une d’elles consiste en une boule faite d’un mélange de pommes de terre crues et cuites râpées. Qui l’eût cru? La pomme de terre râpée, surement.
Mais… comment le knödel s’est-il transformé en poutine râpée? Poser la question, ce n’est pas toujours y répondre. Mystère et… boules gluantes. Mais on a un indice!
Arrivées de Pennsylvanie, les familles fondatrices allemandes ont eu peine à affronter le premier hiver. Certaines sources avancent qu’elles ont reçu l’aide de Mik’maq et d’Acadiens qui étaient revenus s’établir dans la région après la Déportation. À noter que, dès leur arrivée, les pionniers allemands ont planté 200 livres de… pommes de terre.
Une autre hypothèse veut qu’une fois bien établies, certaines familles allemandes aient embauché des Acadiennes comme domestiques. Celles-ci auraient ainsi appris à faire des knödels qui, au fil du temps, seraient devenus les poutines râpées. L’affaire est ketchup! D’ailleurs, le ketchup ne serait pas une mauvaise idée pour s’initier à la poutine râpée.
Toujours est-il que, malgré ses recherches, le père Cormier disait manquer de preuves pour attester hors de tout doute que la poutine acadienne avait des ancêtres dans l’outre-Rhin. Donc, une enquête qui a fait patate?
Mais, entre nous… jusqu’à preuve du contraire, on peut bien y croire.
Avertissement : Exceptionnellement, la présente édition du Rétroviseur est rédigée au «je», pour rendre honneur à cette chouette lettre au passé relativement jeune.

La lettre J a eu une longue gestation avant de venir au monde.
On ne double jamais la lettre «j». Comme le «i», sa voisine et sœur ainée, on ne lui met pas de point lorsqu’elle est majuscule (à moins qu’on ne l’ait simplement pas trouvé). Ce qui ne fait pas d’elle une minus pour autant. Au contraire!
Elle est un peu princesse : elle n’apparait jamais avant une consonne ou la voyelle «i» — sauf dans des mots empruntés, comme jihadisme — ni à la fin d’un mot (déj ne compte pas). Elle est une des dernières venues de notre alphabet. Histoire de J.
Malgré qu’elle serve d’initiale à tous ces mots jouissifs, et à bien d’autres, la lettre J a été adoptée officiellement dans notre alphabet seulement en 1762, par l’entremise de la 4e édition du Dictionnaire de l’Académie française.
Dans la préface de l’ouvrage, l’Académie explique que l’ajout du J — ainsi que du U, au même moment — fait partie de changements considérables «que les gens de lettres demandent depuis longtemps».
Le J et le U deviennent alors les 24e et 25e lettres de l’alphabet. La 26e sera le W, quoique, entre vous et moi, il y a anguille sous roche derrière toute cette affaire.

La lettre W n’est toujours pas reconnue par l’Académie française comme 26e lettre de l’alphabet.
Même si des mots commençant par la lettre W figurent dans le Dictionnaire de l’Académie française depuis la 5e édition (1798), l’Académie n’a pas encore ajouté cette lettre à l’alphabet.
La 8e — et plus récente — édition du Dictionnaire de l’Académie française atteste l’usage de cette lettre, mais souligne, comme dans la 7e édition (1878), que le W n’est utilisé que «pour écrire un certain nombre de mots empruntés aux langues [des peuples du Nord]».
Cela n’a pas empêché le Petit Larousse d’intégrer le W à l’alphabet français en 1948, suivi du Grand Robert en 1964.
Ces dictionnaires ont-ils le pouvoir de décréter l’ajout d’une lettre, même si l’Académie ne l’a pas fait? Pas sûr.
Mais il y a de l’espoir : la 9e édition du Dictionnaire adoptera tout probablement le W. Enfin, c’est ma prédiction. Cette édition est en préparation depuis… 1986. L’Académie a publié par tranches les sections terminées. Elle en est rendue au mot «sommairement».
Quand on est immortels, on peut prendre son temps. J’espère qu’on ne les paie pas à l’heure…
Le J doit tout au I
On a beaucoup écrit sur l’origine du J. Parfois, comme c’est souvent le cas lorsqu’on fouille l’histoire des choses, on trouve des explications différentes, voire contradictoires. C’est le défi de pouvoir séparer le bon grain de l’ivraie. Je braque ici le télescope sur le Rétroviseur, afin de reculer très loin.

1 Alphabet phénicien, 2 Alphabet grec (ionien, attique et eubéen), 3 Alphabet grec (classique, étrusque), 4 Alphabet latin.
Pour faire court (disons, moyennement court), notre alphabet est une modification de l’alphabet latin, adopté par les Romains, et il était lui-même une variation de l’alphabet étrusque tiré de l’alphabet grec, ce dernier étant issu de l’alphabet phénicien (le plus ancien qui mérite cette appellation) qui, en fait, était le résultat d’emprunts et d’inspirations de l’écriture cunéiforme des Sumériens et des hiéroglyphes égyptiens. L’arbre est dans ses feuilles marilon, marilé.
Ni les Phéniciens, ni les Grecs, ni les Étrusques, pas plus que les Romains n’avaient de lettre J dans leur alphabet respectif. Le I était alors suivi directement du K. La naissance du J dans notre alphabet — donc, son jour J — surviendra lors de la… Renaissance. C’est compliqué.
Mais pour tout dire, le J est un rejeton de la lettre I, qui s’appelle le iota chez les Grecs. Et ce sont eux qui ont commencé à utiliser le J à la fois pour le son «i» comme en français et pour le «ye».
Les Étrusques n’ont pas dérogé d’un iota (je m’excuse) à cette façon de faire, pas plus que les Romains, et ensuite les Français.
En France, au Moyen Âge, on a eu tendance à «allonger» le I lorsqu’il était en position prééminente, comme sous la forme d’une initiale. Le J aura différentes prononciations dans d’autres langues. C’est leur droit.
Une lettre, deux pères
La paternité du J est disputée par deux grammairiens européens.

Gian Giorgio Trissino est l’un des deux grammairiens à qui on attribue «l’invention» de la lettre J.
Dans le coin droit, on retrouve Gian Giorgio Trissino, dit Le Trissin, un Italien né en 1478. En 1524, Trissino écrit l’Epistola de le lettere nuovamente aggiunte ne la lingua Italiana adressée au pape Clément VII. Dans cet ouvrage, il crée les lettres J et U. Comme le I qui avait deux rôles, la lettre V était jusque-là utilisée pour représenter deux sons : celui du V et du U.
Dans le coin gauche, on aperçoit un rival de taille : Louis Meigret, un Français né vers 1510 et auteur de la première grande grammaire française. Dans son Tretté de la grammere francoeze, publié en 1550, il fait du I long un J et lui donne la prononciation actuelle [ʒ], comme dans «je suis libre».
Les Français font de Meigret le «père» des lettres J et U, même si son ouvrage parait 26 ans après celui de Trissino. Fake news?
Toujours est-il que certains attribuent à Trissino la forme actuelle du nom de Jésus dans plusieurs langues – dont le français et l’anglais. À l’origine écrit «Yeshua» en araméen, le prénom se transforme en «Iesous» en grec, légèrement modifié à «Iesus» en latin, avec la prononciation «ye».
Donc, Trissino remplace le I de Iesus par le J et Meigret lui donne la prononciation actuelle. Un travail d’équipe. Dans la langue anglaise, on préférera plutôt la prononciation «dj» pour le J, ce qui donnera «djisus». Chacun son truc.

L’alphabet latin est de loin le système d’écriture le plus utilisé dans le monde, soit par environ 40 % de la population mondiale.
Malgré «l’invention» du J et du U au XVIe siècle, le I et le V continueront d’être utilisés respectivement pour le J et le U pendant un certain temps.
À preuve, au siècle suivant un certain écrivain du nom de François-Marie Arouet décide de se créer un pseudonyme. Il prend son nom de famille et y ajoute les initiales L. J. (signifiant Le Jeune – pour imiter, croit-on, des auteurs de l’Antiquité, comme Pline le Jeune), ce qui donnerait aujourd’hui Arouet L. J.
Or, comme à l’époque le U et le J sont encore respectivement V et I, Arouet L.J s’écrit en fait AROVET L. I., ce qui donnera l’anagramme… Voltaire. Brillant!
Cette histoire de J m’a quelque peu épuisé. Permettez que je «finis-je» ici?