1974. Il y a 50 ans, un compositeur français rêve de produire un opéra rock.
Insatisfait de son projet, ce compositeur fait appel à un parolier canadien qu’il ne connait pas. Il le fait venir à Paris et lui fait écouter une mélodie en quête de mots.
Son invité se met à l’œuvre. «J’ai essayé tous les mots d’une syllabe – pars, va, seul, je marche seul», a-t-il raconté plus tard. Puis, viendra le coup de génie, le mot juste : stone.

Michel Berger, compositeur de la musique de Starmania, a recruté Luc Plamondon pour créer l’opéra rock.
Ce compositeur, c’était Michel Berger.
Lui-même chanteur, compositeur et producteur, il découvre les spectacles musicaux lors d’un voyage aux États-Unis.
Il est alors en couple avec sa future femme, France Gall, lorsqu’il écrit, en 1974, un album-concept, Angelina Dumas, inspiré de l’enlèvement de Patricia (Patty) Hearst, fille du magnat américain de la presse, Randolph Hearst. Cette dernière finira par épouser la cause de ses ravisseurs et participera à des braquages de banques avec eux.
L’album est enregistré avec France Gall, mais Michel Berger reste sur sa faim. Il part à la recherche d’un auteur qui pourrait mieux traduire la violence qu’il veut exprimer.
Sa complice lui fait écouter un album de la Québécoise Diane Dufresne, des chansons dont elle apprécie les paroles. Michel Berger retourne la pochette pour voir qui est le parolier : Luc Plamondon.
Berger l’appelle. Il est 5 heures du matin. Plamondon a raconté l’épisode : «Il s’était trompé dans le décalage horaire. Il m’a simplement dit “bonjour, je m’appelle Michel Berger. Je voudrais écrire un opéra rock avec toi”.»
Berger fera la musique, Plamondon les textes.
Ce sera la rencontre de deux francophonies que sépare l’Atlantique. Grand amateur de la culture américaine, Michel Berger est séduit par l’écriture de Plamondon, une poésie francophone teintée de l’influence de l’Oncle Sam.

Le parolier Luc Plamondon a écrit les paroles de toutes les chansons de l’opéra rock Starmania.
La création prend son temps
Les mois passent, l’évolution du projet nécessite réflexion. Finalement, en 1977, les deux nouveaux complices s’enferment pendant plusieurs mois à Antibes, sur la Côte d’Azur, pour plancher sur les chansons du futur Starmania. Il en ressortira un chef-d’œuvre.
Le monde est stone sera la chanson fétiche de Luc Plamondon. C’est la première et celle qui a donné le ton.
Mais plusieurs autres ont aussi traversé le temps : Le blues du businessman, Complainte de la serveuse automate, Les uns contre les autres, Ziggy, Quand on arrive en ville, Un garçon pas comme les autres, Ce soir on danse à Naziland.
Au départ, l’objectif de Michel Berger était d’améliorer son projet original, Angelina Dumas. Mais au final, on accouchera d’un opéra rock complètement nouveau.
De l’opus original de Berger, il ne restera dans Starmania qu’un personnage d’Angelina Dumas : Cristal. Cristal est l’animatrice d’une émission télé, Starmania, qui permet aux participants de devenir la star d’un soir, un genre de Star Académie instantané.
À l’image de Patty Hearst, Cristal se joint à un groupe violent, les Étoiles noires, et participe à leurs crimes.
L’histoire de Starmania est celle d’un Occident unifié, un État dont la capitale est Monopolis, terrorisée par les Étoiles noires. Un milliardaire veut en devenir le président : Zéro Janvier (celui qui aurait voulu être un artiste). Il vit dans une tour dorée de 121 étages avec, au sommet, une discothèque, le Naziland.
La populace vit surtout sous terre, où les Étoiles noires complotent au Underground café, dont la serveuse, Marie-Jeanne, rêve de cultiver ses tomates au soleil…

Premier opéra rock en français?
On présente souvent Starmania comme le premier opéra rock francophone. En fait, comme toujours, il faut faire nuance avec les superlatifs.
Autour de 1970, il y avait bien eu quelques adaptations en français d’opéras rocks américains, comme Hair.
Alors, premier opéra rock en français tiré d’une œuvre originale? Encore là La Révolution française, présentée en 1973, revendique le titre.
Mais un an plus tôt, en 1972, un chanteur d’origine italienne, Herbert Pagani, produit un album intitulé Mégalopolis, qui deviendra, trois ans plus tard, un spectacle où l’artiste joue tous les rôles.
Il s’agit d’une fresque musicale futuriste : un président des États d’Europe Unie, dont la capitale est Mégalopolis, enjoint ses électeurs à consommer et consommer. Une bande de jeunes vivent à contrecourant. Les tours en béton ont remplacé la nature.
Mégalopolis, Monopolis…
Outre les noms des deux villes, difficile de ne pas voir les similitudes entre Mégalopolis et Starmania. La complainte du chauffeur de taxi dans Mégalopolis annonce celle de la serveuse automate. Zéro Janvier semble faire écho à Gilbert, l’homme d’affaires de l’œuvre de Pagani qui a des rêves artistiques…
Il y a là carrément inspiration. Luc Plamondon a lui-même déclaré que, sans Mégalopolis, il n’aurait jamais osé créer Starmania.
Mais cela n’enlève rien à la qualité de l’œuvre. Après la sortie de l’album Starmania, en 1978, vient la première mouture du spectacle, en 1979. Les versions, tant sur disque que sur scène, se multiplieront avec le temps.
À l’image de la collaboration Berger-Plamondon, les interprètes proviendront des deux côtés de l’océan. Au départ, ce sont, du Québec, Diane Dufresne, Fabienne Thibault, Claude Dubois, Nanette Workman; de France : Daniel Balavoine, France Gall. Un grand nombre d’autres artistes connaitront la gloire avec Starmania.
Certains voient dans Starmania une œuvre prémonitoire. Zéro Janvier, l’homme d’affaires qui vit dans une haute tour, pourrait évoquer Donald Trump. L’attaque projetée à cette dite tour n’est pas sans faire penser aux évènements du 11 septembre 2001 qui se sont produits aux États-Unis.
Les chansons comme les thèmes semblent traverser le temps sans trop de rides.
Cinquante ans plus tard, le monde est toujours stone. Starmania aussi.
En aout 1908, l’explorateur et médecin français Jean-Baptiste Charcot entame une expédition en Antarctique en compagnie de plusieurs scientifiques. C’est son deuxième séjour hivernal sur le «continent austral». Plusieurs scientifiques font partie de l’équipage de 30 hommes à bord du Pourquoi-Pas? IV.

L’église Santissimo Nome di Gesù (du Très Saint Nom de Jésus) où, pendant plus de 400 ans, a été conservée une prétendue relique du prépuce du Christ.
En décembre, le groupe atteint l’ile Petermann, située près de la côte de la pointe nord de l’Antarctique. Charcot décide d’hiverner dans une grotte de cette petite ile, à un endroit qu’il nomme Port Circoncision. Normal, puisque c’était un 1er janvier.
Eh oui, jusqu’en 1974, l’Église catholique (l’Église orthodoxe le fait toujours) célébrait ce jour-là la fête de la circoncision – celle de Jésus entendons-nous –, nom raccourci de la «fête de la circoncision du saint Prépuce de Notre Seigneur».
La circoncision, ça se fête?
Selon la pratique juive de l’époque – et encore aujourd’hui – les enfants mâles sont circoncis au huitième jour de leur naissance. L’Évangile de saint Luc mentionne au passage la circoncision de l’Enfant Jésus, qui était juif, rappelons-le.
Lors de cette cérémonie, on lui a aussi donné son nom, un peu comme le font les chrétiens lors du baptême.
Vers l’an 340, le pape Libère officialise le 25 décembre comme date de célébration de la naissance du Christ, une idée qui circulait depuis quelque temps déjà. Comme le huitième jour qui suit Noël est le 1er janvier, Libère consacre tout normalement ce jour comme la fête de la circoncision de Jésus.
Une pratique qui remonte loin, très loin
L’Ancien Testament nous raconte que Dieu a conclu une alliance avec Abraham et ses descendants (qui formeront le peuple juif).

L’abbaye Saint-Sauveur de Charroux, en France, affirme détenir le vrai saint prépuce.
Comme symbole de ce pacte éternel, Dieu prescrit un acte précis : «[…] que tous vos mâles soient circoncis. Vous ferez circoncire la chair de votre prépuce, et ce sera le signe de l’alliance entre moi et vous. Quand ils auront huit jours, tous vos mâles seront circoncis, de génération en génération.»
La pratique se répandra à l’islam aussi, qui continue à la maintenir jusqu’à ce jour, mais elle fait l’objet de débats.
Quel rapport avec la foi chrétienne?
Les théologiens chrétiens vont donner à la circoncision du Christ plusieurs significations symboliques et spirituelles. Selon eux, il s’agissait donc d’un acte pour effacer les péchés; la circoncision préfigurerait la crucifixion et le baptême, nouveau signe d’alliance avec Dieu.

L’apôtre Jacques le Juste était le chef de l’Église de Jérusalem, qui a tranché la question de la circoncision des non-Juifs.
Mais peu de temps après la mort de Jésus, un débat sur la circoncision fait rage et aurait même pu freiner l’expansion du christianisme.
Alors que des apôtres et des disciples s’aventuraient hors de Jérusalem et de la Judée pour répandre la «Bonne Nouvelle», une réflexion élargie sur la circoncision s’est imposée : fallait-il obliger les nouveaux adeptes non juifs de Jésus à respecter les lois et de la tradition juives – et par conséquent à se faire circoncire –, comme le faisaient les apôtres?
Saint Paul, qui fait le plein de croyants au sein des populations grecques, milite pour exempter ceux-ci des pratiques du judaïsme, alors que bien des apôtres et anciens s’y opposent.
Le Concile de Jérusalem tranche
Il faut régler l’affaire une fois pour toutes. Une assemblée est convoquée dans la Ville sainte. Le contenu de ce qui a été baptisé le «Concile de Jérusalem», qui aurait eu lieu vers l’an 50, est consigné dans le livre des Actes des Apôtres du Nouveau Testament.

La circoncision du Christ.
La discussion est longue et tourne plutôt en faveur du statuquo. C’est alors que Pierre prend la parole. Il témoigne des conversions qu’il a faites auprès des païens : «Et Dieu, qui connait les cœurs, leur a donné l’Esprit saint tout comme à nous. Et il n’a fait aucune distinction entre eux et nous, puisqu’il a purifié leur cœur par la foi».
L’assemblée et son chef, l’apôtre Jacques le Juste, se rallient alors aux arguments de Pierre, figure respectée de tous. Saint Paul fera longuement mention dans ses écrits de l’inutilité de la circoncision, une position qui sera maintenue par l’Église de Rome lorsqu’elle se sera solidement structurée.
Cela n’empêchera pas l’Église de célébrer la circoncision du Christ, comme on l’a vu. Plus encore, le culte du prépuce de Jésus comme relique devient tout un phénomène au Moyen-Âge.
La multiplication du prépuce
Plus d’une vingtaine d’églises d’Europe, dont une douzaine en France seulement, affirmaient abriter la fameuse relique du prépuce de Jésus, ce qui bien entendu était physiquement impossible…

Jean-Baptiste Charcot a placé la circoncision dans la toponymie.
La légende la plus tenace veut que Marie ait conservé le prépuce de son fils pour le confier, après la résurrection, à Marie-Madeleine, disciple (et certains disent épouse) du Christ. Plus de 700 ans plus tard, un ange aurait apporté la relique au roi Charlemagne qui, à son tour, l’aurait remise au pape Léon III qui venait de le couronner à Rome.
Le prépuce aurait alors été placé dans la basilique de Latran, à Rome. Mais il aurait été dérobé en 1527 lors du sac de la ville par les troupes de Charles Quint. Miraculeusement, il aurait été retrouvé, 30 ans plus tard, par une jeune fille de Calcata et installé dans l’église de ce petit village au nord de Rome.
Tous les 1er janvier, une procession défilait dans les rues du village pour vénérer la prétendue relique, jusqu’à ce que celle-ci soit volée en 1973. On ne l’a pas revue depuis.
Retour de popularité de la circoncision au XXe siècle
Au XXe siècle, la circoncision revient en vogue, particulièrement dans les pays anglo-saxons, davantage pour des raisons d’hygiène et de santé, mais aussi pour des motifs religieux.
L’intervention maintient sa popularité jusque dans les années 1960, alors qu’elle se pratique chez la majorité des garçons au Canada. La proportion d’hommes circoncis se situe maintenant à environ 32 %, soit à peu près la même que dans le reste du monde.

Preuve de sa solidité, le navire Imo, qui a provoqué l’explosion du Mont-Blanc, a pu être récupéré et rebâti. Les mots «Belgian Relief» étaient toujours lisibles après la déflagration.
Si les grandes lignes de ce drame sont assez bien connues, les détails entourant la collision elle-même le sont moins, et ils sont dignes d’un scénario de film. Plusieurs hasards et un concours de circonstances feront en sorte que la trajectoire de deux navires se coupera dans les eaux entre Halifax et Dartmouth.
En 1917, Halifax est une ville de taille moyenne, avec ses 50 000 à 60 000 habitants. La Première Guerre mondiale fera d’Halifax une plaque tournante stratégique en raison de sa situation géographique et des eaux profondes de son havre libre de glaces à l’année. Le port, donnant sur l’océan Atlantique, est une escale parfaite pour les navires effectuant le trajet entre New York et l’Europe.
Le 3 décembre, un navire norvégien, le Imo, entre dans le havre d’Halifax, en provenance d’Europe. Il est vide. Le navire doit se rendre à New York chercher du matériel de secours destiné à la Belgique. On peut d’ailleurs voir en grandes lettres les mots «BELGIAN RELIEF» sur l’un de ses flancs.
Il jette l’ancre dans le bassin de Bedford, dans la partie nord du havre, à laquelle on accède en empruntant un petit détroit appelé The Narrows.
En raison de retards d’approvisionnement, le Imo ne peut partir que trois jours plus tard, le 6 décembre.
La veille, le Mont-Blanc, un navire français, arrive à Halifax, en provenance de New York, pour une escale avant d’entreprendre la traversée de l’Atlantique. Il transporte des tonnes de benzène, d’acide picrique très explosif et du TNT. Mais il arrive trop tard pour entrer dans les eaux du port, les filets anti-sous-marins ayant été déployés pour la nuit.
On entre dans la danse
Ce n’est que le matin du 6 décembre, vers 7 h 30, que le Mont-Blanc peut pénétrer dans le havre. À peu près au même moment, le Imo amorce sa sortie du bassin et s’engage dans les Narrows. Pressé de rattraper son retard, le capitaine pousse la note et navigue plus vite que permis.
Selon les règles, la navigation dans le havre doit se faire par la droite. Or, un navire se dirige vers le Imo dans la mauvaise «voie». Pour le contourner, le Imo doit se déplacer à gauche, vers le centre du détroit. Aussitôt fait, voilà qu’un autre navire arrive vers le Imo dans la voie du centre et l’oblige à bifurquer encore plus vers la gauche.
Pendant ce temps, le Mont-Blanc se dirige vers les Narrows, en longeant, comme le veut le règlement, la rive à sa droite, du côté de Dartmouth. Le pilote du navire français aperçoit, à un peu plus d’un kilomètre devant lui, le Imo qui est directement dans sa trajectoire à cause de ses manœuvres imprévues.
Un tango solitaire
Ayant le droit de passage, le Mont-Blanc lance un signal au Imo lui indiquant qu’il doit bifurquer vers sa droite pour le laisser passer. Pour une raison qu’on ignore, le Imo garde le cap.
Le capitaine du Mont-Blanc ordonne alors de stopper les moteurs et s’approche un peu plus de la rive. Encore une fois, il demande au Imo de s’éloigner vers le centre du détroit. Mais rien n’y fait.
Le Imo arrête à son tour ses moteurs, mais c’est trop tard : les deux navires sont sur leur lancée.
Dans un dernier geste désespéré, le capitaine du Mont-Blanc donne un brusque coup de barre à gauche, vers le centre du havre. Le navire passe devant le Imo, qui décide de redémarrer ses moteurs en sens inverse.
La manœuvre n’aidera en rien les choses, bien au contraire. Le mouvement des moteurs fait obliquer le Imo, qui finit par heurter le Mont-Blanc sur son flanc. Il est 8 h 45.

Photo de l’explosion prise depuis le bassin Bedford, environ 20 secondes après la déflagration. La hauteur de la fumée a été estimée à plus de 3 600 mètres.
Le Imo réussit à se dégager, laissant une brèche dans le Mont-Blanc. Les dommages sont minimes, mais l’impact et surtout le retrait de l’Imo provoquent des étincelles qui enflamment les vapeurs de benzène ayant coulé sur le pont.
Une grande colonne de fumée noire s’échappe du Imo. Des curieux s’approchent sur la rive, alors que plusieurs personnes regardent la scène spectaculaire de leur fenêtre. Des navires s’approchent pour tenter d’éteindre l’incendie.
La plupart des personnes présentes ne se rendent pas compte du danger. L’équipage du Mont-Blanc, si.
Dès que l’incendie s’est déclenché, le capitaine a ordonné l’évacuation du navire. À bord de canots de sauvetage, les membres d’équipage rament vers la rive, criant vers les bateaux qui s’approchent pour les avertir de l’imminente explosion. Mais dans le bruit et la confusion, c’est un cri dans le désert.
Le Mont-Blanc en feu, sans équipage, dérive de l’autre côté du havre, du côté d’Halifax. Puis, c’est l’explosion.
Il est 9 h 4 min 35 s.
L’apocalypse
L’onde de choc est terrible. Plus de 2,5 km2 du quartier Richmond d’Halifax sont détruits instantanément, de même que tout ce qui se trouvait dans un rayon de 800 mètres du navire.
L’explosion provoque un tsunami d’environ 18 mètres. Le déplacement de l’eau est tel que, par endroits, le fond du havre est brièvement à découvert. Un nuage de fumée blanche s’élève à plus de 3,6 kilomètres dans le ciel.

Vue du quartier de Richmond, à Halifax, peu après l’explosion. Dartmouth est de l’autre côté du havre.
Le Mont-Blanc est pulvérisé. Une partie de l’ancre du navire est projetée à presque quatre kilomètres de la déflagration. Plusieurs personnes seront également propulsées, certaines sur une distance d’un kilomètre. Quelques-uns survivront à leur chute.
En tout, environ 1 600 personnes meurent sur le coup. De 300 à 400 autres succomberont de leurs blessures les jours suivants. On comptera jusqu’à 9 000 blessés, dont des centaines ayant perdu la vue en raison des éclats de verre. Le drame a également laissé environ 25 000 personnes sans abri.
Ayant gagné la rive de Dartmouth, l’équipage du Mont-Blanc a survécu, sauf un membre. Quant au Imo, seulement 6 des 39 personnes à bord, étonnamment, ont été tuées. Le navire lui-même, poussé sur la rive opposée, a même pu être reconstruit.
Plusieurs années plus tard, un certain Robert Oppenheimer étudiera l’explosion afin de mieux prédire les effets de la bombe atomique…
À lire aussi : William Lusk Webster : un électron libre autour du projet Manhattan
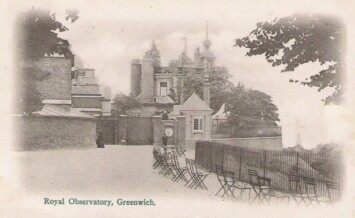
Carte postale de l’Observatoire royal de Greenwich en 1920.
Le temps et le méridien sont les revers d’une même médaille. Une médaille britannique, dans le cas de Greenwich, du nom d’une banlieue de Londres et de l’observatoire où la ligne imaginaire allant du pôle Nord au pôle Sud a été tracée, premièrement au XVIIe siècle, puis légèrement modifiée à quelques reprises avant d’être reconnue comme le méridien de référence par la plupart des pays industrialisés en 1884.
Depuis près de 150 ans donc, le méridien de Greenwich constitue la référence internationale, la longitude «zéro», qui sert à calculer la distance est-ouest et le temps.
Cette idée de «méridien zéro» ou de «premier méridien» remonte au monde romain. Au IIe siècle apr. J.-C., le grand savant grec Ptolémée avait fixé le «premier méridien» au point le plus à l’ouest connu à son époque, soit les iles Canaries, à l’ouest du Maroc actuel.
Plusieurs premiers méridiens, un seul l’emportera
Depuis le XVe siècle, chaque puissance maritime de l’Europe s’était choisi son propre méridien comme repère pour la navigation.
Pourquoi différents méridiens? Pour calculer la latitude, il ne peut y avoir qu’une ligne centrale à l’horizontale autour de la Terre, à son point le plus large, c’est-à-dire un «équateur».

Le méridien de Greenwich traversant le globe de nord au sud.
Mais pour ce qui est des longitudes, n’importe quelle ligne verticale peut diviser la Terre en deux. L’établissement d’une longitude – ou d’un méridien – de base doit faire l’objet d’un consensus.
La France est non seulement à l’origine d’un des grands méridiens de base des Temps modernes, mais elle en a offert probablement la définition la plus poétique.
En effet, le cosmographe et pilote hauturier Jacques Devault décrivait ainsi cette ligne en 1583 : «Méridien est une ligne qui se imagine de l’un des polles du monde à l’autre et passe droict par-dessus nostre tête auquel le soleil en y arrivant faict midy à tous ceux qui habittent desoubz icelle ligne.»
En plus d’être beau, c’est tout à fait exact.
En 1634, une ordonnance du roi Louis XIII rend obligatoire le méridien fixé par Ptolémée.
Au cours du même siècle nait ensuite le méridien de Paris, qui aura une très longue vie. Il a été mesuré en 1667 par des mathématiciens de l’Académie royale des sciences fondée un an plus tôt par Jean-Baptiste Colbert, principal ministre de Louis XIV.
Ce nouveau méridien de base français remplacera peu à peu celui fixé en 1634 sous Louis XIII.
Le mètre, un petit, petit bout de méridien…
La création du mètre est survenue au début de la Révolution française. Voulant mettre fin à la confusion des différentes mesures en cours et de se libérer des unités seigneuriales, le nouveau régime a voulu établir une mesure unique. Des scientifiques ont alors défini le mètre comme étant le dix-millionième partie de l’arc du méridien de Paris, entre le pôle Nord et l’Équateur, c’est-à-dire le quart de la circonférence nord-sud de la Terre.
Cette mesure est très similaire à l’unité proposée au XVIIe siècle par l’Anglais John Wilkins, en se basant sur la distance parcourue d’un pendule pendant une seconde, et qui mesurait… 993,7 millimètres. Coïncidence sans doute. Le savant italien Tiato Livio Burattini redéfinit peut après la mesure de Wilkins en la nommant metro cattlico, soit «mesure universelle», et d’où vient le mot mètre.
Adieu Paris, welcome Greenwich
Chez le voisin du nord, on avait aussi tracé un méridien, soit en 1676, à l’Observatoire royal de Greenwich, en banlieue de Londres. C’était l’époque où un Stuart portait encore la couronne d’Angleterre, plus précisément Charles II, fils du premier Charles, celui qui avait littéralement perdu la tête pendant la première révolution anglaise.

Carte de 1683 montrant le méridien de Paris traversant la France.
La longitude, qui passait sur un point situé dans l’institution, a été modifiée à quelques reprises avec l’arrivée de nouveaux instruments plus précis. Pendant le XIXe siècle, le méridien de Greenwich aura la cote parmi les marins, si bien qu’au début des années 1880, les deux-tiers des navires de par le monde, dont ceux des États-Unis, l’utilisent comme référence.
Il devient alors de plus en plus nécessaire de fixer une fois pour toutes le «premier méridien», la longitude 0, afin que tous soient sur la même… longitude, si on peut dire.
En 1884, le président américain de l’époque, Chester A. Arthur, convoque une grande conférence internationale du méridien à Washington. Plus de quarante délégués provenant de 25 pays y convergent.
En plus de sa popularité, le choix de Greenwich s’explique du fait que le système de fuseaux horaires découlant de ce méridien était devenu la norme aux États-Unis pour fixer des heures régulières.
Les participants adopteront à cette même conférence la division du globe en 24 zones ou fuseaux qui avait été proposée cinq ans auparavant par l’Écossais Sandford Fleming, un ingénieur de renom qui s’établira ensuite au Canada où il deviendra l’un des plus grands arpenteurs du chemin de fer.
L’heure de base fixée au méridien de Greenwich fera en sorte que la longitude à ses antipodes, littéralement à l’autre bout du monde, deviendra la ligne du changement de date, et où il est douze heures de plus qu’à Greenwich, ou de moins, selon de quel côté on se situe.

Le méridien de Greenwich tracé sur le terrain de l’Observatoire.
Un méridien dans la gorge
La France votera contre les propositions de la conférence de Washington, dans une vaine tentative de sauver son méridien, même si la Grande-Bretagne acceptait, en contrepartie, d’adopter le système métrique. Il faudra attendre 1911 et 9 minutes 21 secondes avant que la France ne reconnaisse Greenwich et n’aligne son «heure de Paris» à celle du fuseau horaire 0.
Le Portugal a réellement été le premier royaume européen à envoyer ses navires à tout vent.

Christophe Colomb arrivant en Amérique en 1492.
Les explorations sont entreprises en 1415 sur les côtes d’Afrique à l’instigation d’un des fils du roi Jean 1er. Le prince Henri le Navigateur avait, en effet, découvert qu’il y avait des trésors sur ce continent en participant à la prise de Ceuta, port commercial situé au bord du détroit de Gibraltar et enclavé dans le Maroc actuel.
Mais le prince Henri nourrit d’autres – et plus grandes – ambitions pour envoyer ses bateaux vers le sud : il veut mettre fin au monopole que détiennent les Vénitiens sur le commerce avec l’Asie orientale, souvent désignée comme «les Indes».
À noter qu’Henri a été surnommé le «Navigateur» en raison des missions qu’il a organisées. Il n’a pourtant lui-même jamais commandé de navire, ni mené d’expédition, ni découvert quoi que ce soit. Finalement, il était un navigateur… qui n’avait jamais navigué. Ohé ohé.
Des iles, puis la côte

François 1er, roi de France, a été le premier monarque à contester le partage du monde conclu entre le Portugal et l’Espagne.
Les (vrais) marins et explorateurs portugais découvrent premièrement les archipels des Açores et de Madère, qui sont inhabités. Puis, ils longent les côtes africaines, érigeant des forts et des comptoirs commerciaux par-ci par-là, jusqu’aux iles du Cap-Vert, au large du Sénégal actuel; ces iles sont aussi inhabitées.
Le grand voisin du Portugal, l’Espagne, en pleine campagne d’unification de ses royaumes, ne veut pas être en reste et jette son dévolu sur les iles Canaries, situées au sud de Madère, au large de la côte du sud du Maroc. Mais l’archipel des Canaries est peuplé depuis des centaines d’années; la conquête sera longue et sanglante.
La valse des traités et des bulles…
Par le traité d’Alcáçovas, en 1479, le Portugal et la Castille – le royaume au cœur de la formation de l’Espagne – s’entendent pour se reconnaitre mutuellement la possession de ces archipels et affirmer le contrôle du Portugal sur la côte de la Guinée, en Afrique.

Le cap des Aiguilles est la pointe la plus au sud de l’Afrique. L’explorateur portugais Bartolomeu Dias a été le premier Européen à le franchir, en 1488.
Deux ans plus tard, le pape Sixte IV édicte la bulle Aeterni regis, qui entérine le traité et donne ainsi sa bénédiction à un premier partage du monde entre des royaumes européens et à la volonté de ces derniers d’en faire la colonisation, évidemment sans égard aux populations autochtones.
Sixte IV accorde aussi au Portugal toutes les terres qu’il pourrait conquérir au sud du 27e parallèle (au sud des iles Canaries), jusqu’aux Indes, soit toute l’Asie, à condition d’en évangéliser les habitants.
Le Portugal poursuit alors ses explorations encore plus au sud. En 1488, Bartolomeu Dias devient le premier Européen à dépasser la pointe sud du continent africain. Il montre ainsi qu’on peut gagner l’océan Indien par la mer et atteindre les Indes, ce qu’il réalisera dix ans plus tard en accompagnant le navigateur Vasco de Gama.
Go Ouest
Entretemps, comme la route du Sud lui est coupée par son voisin, l’Espagne tente d’atteindre l’Asie vers l’Ouest. Quand Christophe Colomb met le pied aux Bahamas, le Portugal revendique ces terres, car elles sont au sud du 27e parallèle…
Il y a péril en la demeure espagnole. Ça tombe bien, le nouveau pape Alexandre VI est originaire d’Espagne. Il décide, en 1493, d’un nouveau partage du monde via une nouvelle bulle : Inter Cætera.
Cette fois-ci, la division n’est pas établie en fonction d’une latitude, mais plutôt d’un méridien, fixé à 100 lieues (environ 420 km) à l’ouest du Cap-Vert. Les terres situées à l’ouest de cette ligne dans l’océan Atlantique reviennent donc à l’Espagne, soit donc, en principe, toutes les Amériques.

Le monde tel que se le sont partagé le Portugal (en vert) et l’Espagne (en orange) aux XVe et XVIe siècles.
Mais le Portugal lève la main, craignant que ce partage menace ses prétentions en Asie de l’Est. Afin d’éviter une guerre, le Portugal et l’Espagne en arrivent à un compromis avec le traité de Tordesillas, qui pousse le méridien-frontière encore plus à l’ouest, soit à 370 lieus (1 770 km) du Cap-Vert.
Prémonitoire? Encore une fois, le hasard – ou est-ce bien un hasard? – fait bien les choses, car en 1500, l’explorateur portugais Cabral, voulant contourner l’Afrique et se rendre aux Indes, dérive loin vers l’ouest, jusqu’au continent américain.
Cette terre «découverte» est la seule partie des Amériques située à l’est du méridien du traité de Tordesillas. Le territoire deviendra le Brésil et il sera portugais. Sans Tordesillas, il n’y aurait pas de samba ni de bossanova!
Si la question de l’Afrique et de l’Amérique est réglée, le même problème se posera pour l’est de l’Asie. En principe, tout est réservé aux Portugais, qui d’ailleurs étendront leur influence dans la région.
Après le voyage de Magellan qui, pour le compte de l’Espagne, atteint les Philippines, les deux pays concluent en 1529 le traité de Saragosse, qui trace un méridien dans le Pacifique pour départager leurs zones d’influence. Le traité donne à l’Espagne accès aux Philippines, même si celles-ci se trouvent dans la «zone» portugaise.
Le testament d’Adam
Mais pendant que l’Espagne et le Portugal, à coups de bulles, se disputent et se partagent le monde, comme s’ils étaient… seuls au monde, d’autres puissances maritimes européennes – soit la France, l’Angleterre et plus tard les Pays-Bas – la trouvent de moins en moins drôle.

Page couverture de la version portugaise du traité de Tordesillas, conservée à la Bibliothèque nationale du Portugal, à Lisbonne.
C’est la France qui viendra «péter la bulle» des royaumes ibériques.
En 1533, le roi François 1er obtient du pape Clément VII une modification du traité de Tordesillas qui, désormais, ne touche que «les terres connues et non les terres ultérieurement découvertes par les autres Couronnes». La voie est libre pour que, l’année suivante, le roi François mandate la première expédition du Malouin Jacques Cartier dans ce qui deviendra le Canada.
Quelques années plus tard, le souverain français, ne manquant pas d’aplomb, aurait déclaré à l’empereur Charles Quint, roi (entre autres…) d’Espagne : «Le soleil luit pour moi comme pour les autres. Je voudrais bien voir la clause du testament d’Adam qui m’exclut du partage du monde.»
On n’a jamais trouvé cette clause, pas plus que celle qui autorisait les nations européennes à coloniser et à exercer leur emprise sur une bonne partie de la planète.
Il est difficile d’imaginer que, dans un pays comme le nôtre, où les droits de la personne constituent l’un des fondements de la société, on ait mis à l’écart presque toute une communauté ethnique dans les années 1940.
Et quand on dit «presque toute», c’est exactement ça : à l’hiver de 1942, environ 90 % de la population canadienne d’origine japonaise est rassemblée et relocalisée. Pourtant, les trois quarts des membres de cette communauté sont citoyens du Canada.
L’évènement déclencheur est l’attaque japonaise qui survient le 7 décembre 1941 contre la base navale de Pearl Harbor, sur l’ile d’Ohau, à Hawaii (le territoire deviendra le 50e État américain en 1959).
Le même jour, le Canada devient le premier pays à déclarer la guerre au Japon, devançant donc d’un jour les États-Unis, qui s’engagent ainsi dans le conflit mondial.
Tout se déroule alors très vite. Dans les jours suivants, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) arrête une quarantaine de Canadiens japonais qu’elle soupçonne de liens avec l’Empire nippon.
Ensuite, les autorités saisissent tous les bateaux de pêche appartenant aux personnes d’origine japonaise, confisquent leurs caméras et radios à ondes courtes, et ferment leurs journaux ainsi que leurs écoles. Un couvre-feu leur est imposé. On craint l’ennemi de l’intérieur…
Mais ce n’est qu’un début. La situation s’envenime lorsque, le 25 décembre, les troupes japonaises capturent la garnison militaire de Hong Kong, où deux bataillons déployés par le Canada venaient d’arriver. Les soldats canadiens et alliés qui survivent à l’attaque resteront prisonniers de guerre jusqu’en aout 1945.

Camp d’internement de Lemon Creek, en Colombie-Britannique.
Expulsion, éparpillement, dénuement
Au cours de l’hiver 1942, c’est le début du cauchemar pour les Canadiens japonais : le 24 février, le cabinet fédéral adopte un décret qui permettra de déplacer, en théorie, n’importe qui, mais qui visera spécifiquement la communauté japonaise habitant dans un territoire, appelé «zone protégée» longeant la côte de la Colombie-Britannique et s’étendant 160 kilomètres vers l’intérieur.
Environ 22 000 personnes d’origine japonaise seront évacuées de cette «zone protégée» au cours de l’année.
L’opération débute vers la mi-mars. Un premier groupe d’environ 8 000 personnes sont envoyées au parc Hastings, à Vancouver, qui servira de centre de transit. Les détenus sont logés dans de petits bâtiments utilisés habituellement pour le bétail.
De là, ils sont transportés dans des camps d’internement isolés à l’intérieur des terres en Colombie-Britannique.
La vie dans les camps est dure. Plusieurs familles sont installées dans des tentes ou de petites cabanes mal bâties. Bien souvent, les camps sont surpeuplés, privés d’eau courante et d’électricité. La nourriture laisse à désirer.
Beaucoup d’hommes sont envoyés hors des camps pour construire des autoroutes dans la province, en Alberta ou en Ontario.
Quelques familles réussissent à ne pas être séparées en acceptant de travailler dans des fermes de betteraves à sucre en manque de main-d’œuvre en Alberta et au Manitoba.
Environ 700 hommes qui résistent à l’internement passeront des années dans des camps de prisonniers de guerre en Ontario, notamment à Petawawa et au camp 101, à Angler, sur la rive nord du lac Supérieur.

Slocan City abritait un camp d’internement pour les Canadiens d’origine japonaise et servait de lieu de transit vers d’autres camps. C’est aussi de là que plusieurs ont été déportés au Japon.
Confiscation et vente des biens
Au moment de l’expulsion, les autorités ont pris possession des objets personnels que les prisonniers ne pouvaient prendre avec eux et ont saisi leurs propriétés dans la «zone protégée».
Le gouvernement a créé un bureau spécial pour administrer ces biens. Le fédéral assurait alors qu’il ne s’agissait pas de les confisquer, mais de les gérer dans l’intérêt des propriétaires.
Mais en 1943, l’«intérêt» passe des prisonniers au gouvernement. Ce dernier se donne alors le pouvoir de liquider ces biens afin de financer… l’internement des Canadiens japonais. Ironie, quand tu nous tiens…
En 1944, certaines personnes, particulièrement dans les milieux politiques de la Colombie-Britannique, commencent à demander l’expulsion définitive des Canadiens japonais. Après la guerre, on offre alors aux prisonniers le choix de s’établir à l’est des Rocheuses ou d’être envoyés au Japon. Près de 10 000 d’entre eux optent pour la mère patrie.
Mais lorsque la paix survient en 1945, plusieurs changent d’idée et ne veulent plus se rendre dans un Japon dévasté par la guerre.
À priori, le gouvernement refuse ces demandes, mais en 1947, il permet aux Canadiens japonais qui sont toujours au pays de rester.
Entretemps, environ 4 000 des détenus ont été déportés au Japon; la moitié d’entre eux environ était née au Canada et n’avait jamais mis les pieds en terre nippone.
Plusieurs retourneront vers la côte ouest, mais ils devront recommencer leur vie à zéro. Une commission créée en 1947 sur la confiscation et la vente des biens saisis leur donnera droit à une restitution de la valeur monétaire de leurs biens, mais elle sera minime.
D’autres choisiront de rester dans les environs des lieux où ils ont été internés ou bien ils iront s’établir dans d’autres villes, notamment à Toronto.
En 1949, ils obtiendront le droit de vote, en même temps que les Canadiens d’origine chinoise.

Dans les jours suivant l’attaque de Pearl Harbor, des centaines de bateaux de pêcheurs d’origine japonaise ont été saisies en Colombie-Britannique, dont à Stevenson (photo)
Épilogue
Ce n’est que près de 40 ans plus tard que le gouvernement fédéral reconnait ses torts.
Le 22 septembre 1988, à la Chambre des Communes, le premier ministre Brian Mulroney présente des excuses officielles à la communauté japonaise canadienne.
Une entente est conclue pour notamment verser 21 000 dollars à chaque personne directement touchée par l’internement. Le gouvernement accepte aussi d’accorder la citoyenneté canadienne aux déportés et à leurs descendants.
Enfin, il met sur pied un fonds de 24 millions de dollars pour la création de ce qui est aujourd’hui la Fondation canadienne des relations raciales.
Alors, qu’est-ce que du creton? Ou des cretons, c’est selon. Pour Le Robert, il s’agit d’un «pâté à base de viande de porc assaisonnée avec des oignons». Le Larousse? «Au Canada, charcuterie généralement constituée de viande de porc haché.»

C’est le moment idéal de l’année pour savourer du creton.
C’est assez réducteur comme définitions. Le creton, c’est bien plus que ça. Ce n’est pas parce qu’on s’appelle creton qu’on peut se laisser insulter.
Pour une description plus poétique, on peut se tourner vers l’écrivain normand Jean de Fleury qui décrivait ainsi les «cretouns» dans son Essai sur le patois normand de La Hague paru en 1886 : «résidus de graisses, rapetissés, plissés, ratatinés, crétis par le feu». C’est beau.
Est-ce à dire que les «cretouns» serait l’ancêtre du creton canadien? Nom d’une Jehane Benoît! (Elle a une recette de cretons d’ailleurs.) Mystère. Mais on sait une chose : c’est bon.
On ne sait pas trop non plus quand ce mets a été créé; c’était surement dans quelque chaumière de l’ancien Canada, au Québec actuel. C’est chaud.
En fait, pas vraiment chaud, car le creton se mange généralement froid.
Les meilleurs plats sont des restants
Comme bien d’autres plats populaires, le creton est probablement le fruit de restants qu’on ne voulait pas perdre. Il se pourrait qu’à l’époque, après avoir tué le cochon à l’automne, l’auteur ou auteure de la recette ait décidé que de faire des cretons était une façon de conserver la viande pendant la saison froide.

Les cretons peuvent servir autant à satisfaire une petite fringale qu’à épater la galerie pour les grandes occasions.
Ou bien les cretons viendraient-ils des «bonnes sœurs» venues de France? En tout cas, on retrouve beaucoup de références à une recette des Ursulines de Québec à laquelle on attribue l’épithète «ancestrale». Hum, food for thought, comme aurait dit Shakespeare.
Loin de se cantonner au Québec, les cretons ont fait du chemin depuis leur arrivée ou leur création en Nouvelle-France. Un peu par osmose, ils se sont répandus ailleurs dans le Canada moderne, au gré des déplacements, de la parenté, de génération en génération.
Après des mille, voire des millions de tartinades sur des morceaux de pain grillé, le creton atteint la consécration au tournant du deuxième millénaire : il fait son entrée dans Le Petit Larousse en 2002, en même temps que bleuetier, débriefer (eh oui), feng shui, papy-boom (re-eh oui), canoë-kayak, snowboard (re-re) et zirable (mot poitevin implanté par les colons français en Acadie, puis par les Acadiens en Louisiane). Une bien grosse année.
Le Robert, de son côté, inclura «cretons» cinq ans plus tard, en 2007.
D’ici ou de France?
Tout cela est fort étonnant quand on constate que «cretons» a fait son apparition dans le Dictionnaire de l’Académie française dès sa 6e édition, en… 1835.

Plusieurs entreprises produisent des cretons commercialement qui sont vendus notamment dans les supermarchés.
Les Immortels font remonter l’origine du mot au moins au XIIe siècle. Selon eux, il s’agirait «probablement» d’un emprunt du moyen néerlandais kerte, qui signifie «entaille».
La courte définition de «creton» dans ce dictionnaire des dictionnaires est restée sensiblement la même depuis sa première entrée : «Résidu de la fonte du suif et de la graisse des animaux, dont on fait ordinairement des pains qui servent à nourrir les chiens de basse-cour et les chiens de chasse.»
Dans la 8e édition, on a ajouté au début «Morceau de graisse». Puis, dans la 9e édition, l’actuelle, il est précisé que la graisse vient du porc. Le truc sur les chiens de basse-cour et de chasse a disparu.
Fait intéressant, des liens externes sur l’usage du mot dans différentes régions en français et ailleurs ont été ajoutés dans la dernière édition.
On apprend ainsi qu’en Belgique, le mot est utilisé pour désigner de «minces tranches de lard grillé», de «petits morceaux de lard coupés en dés et frits, que l’on incorpore dans certains plats» ou encore des «résidus croustillants de la fonte de la panne de porc».
Le terme est aussi répandu dans plusieurs régions de France, surtout dans le Nord où il semble surgir en premier, comme dans la Somme, la Lorraine et les Ardennes.
«Répandu» n’est peut-être pas le bon mot, car il s’agit de régions près de la Belgique. Il serait plausible, puisque l’origine étymologique pointe vers les Pays-Bas, que le mot soit passé par la Belgique et le Nord de la France pour aboutir en Nouvelle-France. Finalement, on s’est passé le mot.
Mais assez d’analyse grammaticale. Passons à table.
De la table à la télé
Contrairement à nos amis européens qui n’en font que du résidu de gras ou de suif, ici le creton est à base de viande, précisément de porc haché. À cela s’ajoutent quelques ingrédients tout simples : oignons, cannelle, clou de girofle, persil séché et parfois sarriette.
Certaines variantes contiennent des miettes de pain, de l’ail, du bouillon de poulet ou de la gélatine (pas sûr…). Enfin, le célèbre Ricardo n’y va pas avec le dos de la fourchette en osant du gras de canard, du lait, du vin blanc, du piment de la Jamaïque, des flocons d’avoine. Alouette.

Premier monastère des Ursulines de Québec, en 1840. Le creton canadien y serait-il né?
Un petit truc de grand-mère : on peut ajouter une demi-tasse de beurre, à la fin de la cuisson, pour rendre le tout plus lisse.
Au début des années 1960, on parle de cretons en chanson, soit dans la très populaire chanson, Gros Jambon, de Réal Giguère :
Y’a personne qui savait de quel coin y venait
Mais, nous, on se doutait ben que c’était un Québécois
Parce qu’il sacrait tout le temps et mangeait ben des cretons
Pis y avait tout le poil frisé comme un mouton
Le creton entre véritablement dans l’imaginaire culturel québécois et franco-canadien grâce au savoureux personnage de Lison Dubé Paré (Josée Deschênes) dans la série La Petite Vie parce que son mari, Rénald (Marc Labrèche), l’appelait disons affectueusement Creton.
Il faut dire qu’un autre mets traditionnel québécois et franco-canadien avait une grande place dans l’émission : le pâté chinois. Mais ce sera pour un autre numéro du Rétroviseur…
Bon. Assez parler culture. Car, c’est bien connu, la culture, c’est comme du creton : moins on en a, plus on l’étale.
L’histoire du train est fascinante. On sait évidemment qu’il a joué un rôle central dans la fondation du pays. Il est intéressant de savoir que les premiers chemins de fer n’étaient pas en fer, mais en bois. Pour les… férus d’histoire, voyons ça de plus près.
La genèse du train : Grande-Bretagne
Les premiers rails font leur apparition en Grande-Bretagne au tournant du XIXe siècle. On ne parle pas encore de «train»; il s’agit plus ou moins d’un charriot sur des rails tirés par des chevaux. Parfois des ânes. Parfois des mules. On reste dans la même famille.

L’ancêtre de la locomotive, la Salamanca, a été construite au début du XIXe siècle, en Grande-Bretagne.
Tout va alors très vite : alors que l’invention sert au départ à transporter de la marchandise, notamment du charbon, du bois, du blé ou des pommes de terre, le premier service public de train pour passagers est inauguré dès 1807 à Oystermouth, dans le Pays de Galles, mais sur une courte distance.
Il faudra attendre 1830 pour la première ligne entre deux villes, soit Liverpool et Manchester. C’est la première ligne également à n’utiliser que des locomotives à vapeur. Exit les chevaux; ils sont désormais interdits.
La locomotive à vapeur avait d’ailleurs été inventée dès 1802 en Angleterre. Les simples rails de bois avaient rapidement laissé leur place à des rails encore en bois, mais revêtus de lisses de fer. On innove en 1820 par des rails en fer forgé. L’ère du véritable «chemin de fer» commence.
Le Bas-Canada, précurseur
Les autres pays industrialisés suivent rapidement les traces de la Grande-Bretagne, d’abord en Europe et en Amérique du Nord, puis un peu partout dans le monde.
Au Canada, le véritable premier chemin de fer est terminé en 1836, entre La Prairie, en banlieue de Montréal, et Saint-Jean-sur-Richelieu (alors appelé Dorchester), au Québec, dans ce qui était à l’époque le Bas-Canada.

La photo emblématique de la pose du «dernier crampon» du chemin de fer du Canadien Pacifique par Donald Smith, l’un des financiers du projet.
Ce n’était qu’un court tronçon de 26 kilomètres, mais comme on dit, petit train va loin. Le projet, financé par nul autre que le brasseur John Molson (oui, celui-là), sera l’un des maillons qui permettra désormais d’acheminer des marchandises de Montréal à New York.
Le trajet est un peu compliqué cependant : du port de Montréal, il faut traverser le fleuve Saint-Laurent jusqu’au port de La Prairie. Les marchandises sont alors transvidées dans des wagons qui partent ensuite pour Saint-Jean-sur-Richelieu.
Arrivées à ce nouveau point de transit, les marchandises sont chargées sur des bateaux, qui descendent la rivière Richelieu, jusqu’au sud du lac Champlain, pour emprunter ensuite le fleuve Hudson, grâce au canal Champlain terminé en 1823. Enfin, les denrées poursuivent leur route sur ce cours d’eau jusqu’à New York.
L’inauguration du premier «voyage», le 21 juillet 1836, a réuni les grandes personnalités du temps, dont le lieutenant-gouverneur du Bas-Canada, Lord Gosford, et un certain… Louis-Joseph Papineau, alors toujours chef du Parti patriote et futur rebelle.
Le tissage d’une toile de fer
Puis, mille après mille, jour après jour, le réseau ferroviaire s’étend au Canada, comme un peu partout dans le monde. Au Canada et aux États-Unis, il jouera un rôle central dans la construction des deux pays.
Le chemin de fer devient si important dans le développement économique qu’il se retrouvera dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB), la loi de 1867 créant le Canada par l’union de l’Ontario, du Québec (formant alors la Province du Canada), le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.

La première locomotive fabriquée au Canada a été construite à Toronto en 1853 par James Good. L’engin no 2, baptisé «Toronto», figure fièrement sur cette photo de 1881.
Si en Ontario et au Québec, le réseau ferroviaire est déjà bien étendu, ce n’est pas le cas dans les deux plus petits partenaires du nouveau pacte canadien.
L’article 145 de l’AANB fait état de la «déclaration commune» du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse et de «l’importance primordiale revêtue par la construction d’un chemin de fer intercolonial pour la consolidation de l’union de l’Amérique du Nord britannique.»
Le chemin de fer sera l’un des enjeux majeurs de l’adhésion de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard à la Confédération canadienne, qui aura lieu respectivement en 1871 et en 1873.
Le chemin de fer Intercolonial qui relie Halifax au fleuve Saint-Laurent sera achevé en 1876. Le défi sera immensément plus grand pour réaliser le tronçon de l’Ouest jusqu’à la côte du Pacifique.
Une entreprise colossale
Le chemin de fer promis à la Colombie-Britannique est un projet gigantesque : 1 600 km et un passage à travers les montagnes Rocheuses. En raison d’un scandale financier et politique qui a forcé la démission du premier ministre John A. Macdonald et de son gouvernement en 1873, les travaux ne s’amorcent qu’en 1881.
La compagnie du Canadien Pacifique réussit l’exploit extraordinaire quatre ans plus tard, avec la célèbre pose du «dernier crampon» le 7 novembre 1885. Le premier train de passagers de Montréal à Port Moody, près de Vancouver, fera le trajet en six jours, du 28 juin au 4 juillet 1886.
Bien plus tard, l’historien et concepteur du drapeau canadien, George F. Stanley, écrira dans un chapitre de The Canadians 1867-1967 : «Des liens d’acier et de sentiment étaient nécessaires pour maintenir la nouvelle Confédération. Sans les chemins de fer, le Canada n’aurait pas existé.»

Plaque commémorative de la construction du premier chemin de fer du Canada.
Mais ce «rêve canadien» a été réalisé à grands couts humains. Plus de 15 000 travailleurs chinois ont participé à la construction du chemin de fer dans les Rocheuses. Une main-d’œuvre bon marché qui a été largement exploitée.
On estime que trois travailleurs chinois ont perdu la vie lors d’accidents pour chaque kilomètre de voie ferrée dans le canyon du Fraser en Colombie-Britannique.
Plus de 200 ans après l’arrivée du «cheval de fer» au Canada, les défis pour la survie de l’industrie sont toujours très grands, particulièrement du côté du service passager.
Alors qu’en Europe et ailleurs dans le monde, le train à grande vitesse a sauvé l’industrie, le Canada se fait tirer l’oreille. Le gouvernement fédéral caresse plutôt un projet de «train à grande fréquence» entre Québec et Toronto, et encore là, il faudra attendre au milieu des années 2030.
Entretemps, le train pourra continuer de siffler sur la colline. Mais peut-être que personne ne viendra…

L’un des portraits les plus connus de Louis XVII, à l’âge de 7 ans.
Pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter à la Révolution française. Peu après le début de celle-ci, en octobre 1789, la famille royale quitte de force le château de Versailles pour s’installer dans celui des Tuileries, à Paris.
Trois ans plus tard, en 1792, la monarchie est abolie : la famille royale est incarcérée dans la veille tour du Temple, d’où Marie-Antoinette, Louis XVI et sa sœur Élisabeth («Madame Élisabeth») ne sortiront que pour être guillotinés.
Mais il reste, dans cette «prison du Temple», deux enfants du couple royal encore vivants (deux étaient morts en bas âge avant la Révolution), dont Marie-Thérèse, l’ainée de la famille, qu’on surnommait «Madame Royale».
Divulgâchage : elle sortira vivante de tout ce chaos et épousera plus tard son propre cousin, le duc d’Angoulême, fils du roi Charles X, frère de Louis XVI. Ah! Les histoires de familles!
Le petit roi…
L’autre enfant est celui qui est à l’origine notre intrigue. Louis-Charles est devenu dauphin à la mort de son frère ainé, Louis-Joseph Xavier François, survenue un peu plus d’un mois avant la prise de la Bastille, en pleins États généraux.

Originaire d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, Carl Nadeau a passé sa vie adulte à Fort Wayne, dans l’État de l’Indiana.
Le dauphin n’a que 7 ans lorsqu’il est enfermé avec sa famille. Après l’exécution de ses parents, les royalistes le reconnaissent comme Louis XVII.
Mais le prince est un enfant à la santé fragile. Les conditions de vie au Temple sont horribles, et son état ne fera que se détériorer ; il meurt, à son tour, en janvier 1795.
Mais est-il vraiment mort?
En fait, il faut plutôt se demander qui est l’enfant mort au Temple.
Car très vite, des rumeurs se mettent à circuler voulant que Louis XVII ait été exfiltré de son donjon et qu’il ait été remplacé par un enfant malade, qui aurait été sourd-muet. Des théories de toutes sortes seront énoncées, des centaines de livres seront écrits sur ce qui deviendra l’une des plus grandes énigmes de France.
De nombreux «Louis XVII» se manifestent. Les historiens en ont recensé plus d’une centaine. Le plus célèbre d’entre eux est Karl Wilhelm Naundorff, un horloger prussien.
Et Naundorff devint Bourbon
Vivant à Berlin, ce prétendu descendant déclare publiquement être en fait Louis XVII.

Jusque sur son son lit de mort, Karl Wilhelm Naundorff soutiendra qu’il était Louis XVII.
En 1833, il arrive (ou revient, selon les points de vue) en France pour faire reconnaitre son identité. Il convainc beaucoup de gens, tellement que cela dérange.
Deux ans plus tard, il est expulsé en Grande-Bretagne, puis il s’installe aux Pays-Bas où il meurt en 1845.
Par la suite, sa famille obtient des autorités des Pays-Bas l’autorisation de porter le patronyme «de Bourbon». Ses descendants à ce jour continuent de rêver à la couronne de France. Mais comme toute bonne famille, elle se divise en deux clans.
La branche aujourd’hui «française» remonte à l’un des fils de Naundorff, Charles-Edmond. L’autre branche, dite «canadienne», descend d’un autre fils, Adelberth. On la nomme «canadienne» puisque ses membres vivent en Ontario depuis 1952.
Né en 1933 aux Pays-Bas, Charles-Louis de Bourbon est venu s’installer au Canada. Il a fait carrière dans l’industrie du vêtement, puis dans l’immobilier et a continué, jusqu’à sa mort en 1922, de prétendre activement à la couronne de France, allant jusqu’à écrire deux livres : Louis XVII a survécu à la prison du Temple et I Exist.
Charles-Louis de Bourbon et son lointain cousin, Charles-Louis Edmond, de la branche française, ont chacun contesté le titre royal jusqu’à leur mort.
Mais où en est cette affaire aujourd’hui? Il semble que Hugues de Bourbon, représentant actuel de la branche française, libraire de son état, ne veuille plus jouer à cette joute royale, ce qui laisse la porte toute grande ouverte à l’Ontarien Michel-Henri (Henri VII pour ses partisans) pour devenir l’unique prétendant de la famille Naundorff.
Des tests d’ADN et des contrexpertises ont tour à tour laissé entrevoir, ou non, que l’enfant du Temple était Louis XVII.
Un prétendant néobrunswickois
Un autre Canadien a aspiré à la couronne de France, mais sans que ces prétentions aient des échos dans la mère patrie.

Un jeune Carl Nadeau, de son vivant prétendant néobrunswickois d’une descendance de Louis XVII.
Carl Nadeau, originaire d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, a été professeur de littérature anglaise à l’Université St. Francis, à Fort Wayne, en Indiana, où il est mort en 2011. Toute sa vie d’adulte, il a cherché à démontrer qu’il était le descendant de Louis XVII.
Sa théorie veut que le prince, une fois évadé de la prison du Temple, soit caché à Londres. Devenu adulte, Louis XVII part pour le Canada afin de fuir ceux qui voudraient sa perte (notamment Napoléon et les frères de Louis XVI).
Il aboutit au Madawaska, au Nouveau-Brunswick, où il prend un nom courant, celui de Nadeau, pour se fondre dans la masse. Il y meurt sans être découvert, mais son secret se transmet de père en fils jusqu’à Carl Nadeau.
Après la mort de ce dernier, des experts mettront un terme à cette belle histoire, en montrant que l’ADN de la famille de Carl Nadeau est identique à celui des autres Nadeau d’Amérique.
Ça se bouscule au portillon du trône
Un mot enfin sur les prétendants plus sérieux au trône de Louis XIV… plus sérieux, car leur ascendance royale ne fait aucun de doute. Encore là, deux clans s’affrontent.

Pierre tombale de Karl Wilhelm Naundorff, à Delft, aux Pays-Bas.
D’un côté, les «Orléanistes», partisans de la branche cadette des Bourbon, plus précisément de la lignée de Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV, et dont un membre, Louis-Philippe 1er, a été le dernier roi français. Le prétendant actuel est Jean d’Orléans.
De l’autre côté, les «Légitimistes», qui misent sur Louis de Bourbon, descendant de la branche espagnole de la célèbre famille royale française.
Né en Espagne (sa résidence principale est à Madrid) Louis de Bourbon est : 1) l’arrière-petit-fils du roi espagnol Alphonse XII ; 2) petit-cousin du roi actuel d’Espagne, Philippe VI ; 3) descendant de Louis XIV ; 4) ouf!; 5) ah oui, il est aussi arrière-petit-fils du dictateur Franco, dont il a souvent défendu l’héritage!
Toutes ces tribulations ne mèneront sans doute à rien puisque la France ne semble nullement désireuse de restaurer la monarchie. Mais cela nous permet de nous rappeler qu’il y avait, autrefois, un petit roi…
Lorsqu’il a été élu premier ministre en 2015, Trudeau fils s’est installé avec sa famille au Rideau Cottage, près de Rideau Hall, résidence de la gouverneure générale, en raison de l’état lamentable du 24, promenade Sussex.

La résidence officielle des premiers ministres du Canada, avant les rénovations effectuées avant 1950.
Depuis, on ne sait plus trop quoi faire de cette résidence officielle maintenant vide. Rénover? Tout raser? Les paris sont encore ouverts, huit ans plus tard…
Pour tout dire, la vieille demeure traine de vieux démons. Ça tombe bien, l’Halloween est à nos portes. Amusant. Presque.
Certains pensent que le fantôme de l’homme qui a fait construire la maison au 24, promenade Sussex rend parfois visite à la vieille demeure. Encore des histoires de peur.
Pourtant, tout avait bien commencé lorsque Joseph Merrill Currier, un entrepreneur ayant connu du succès dans l’industrie du bois, décide, peu après la Confédération, de faire construire une superbe résidence comme cadeau de noces à sa troisième femme.
Ah ah! La troisième femme. Qu’en est-il des deux premières? Puisque vous le demandez, voici.
Jamais deux sans trois
C’est avec la première, Christina Wilson, que Joseph a eu ses quatre enfants. Hélas, trois fois hélas, trois d’entre eux meurent de la scarlatine, et Christina succombe ensuite en raison de son chagrin.
Le destin de sa deuxième femme, Ann Elizabeth Crosby, sera encore pire. Peu après leur retour de leur lune de miel, Joseph a la mauvaise idée de faire visiter le moulin Watson, dont il était copropriétaire, à sa nouvelle conjointe.

Joseph Merrill Currier, homme d’affaires et député fédéral, a fait construire le 24, promenade Sussex à Ottawa pour sa troisième femme.
Femme issue d’une famille aisée, Ann visite le site vêtue d’une robe à crinoline. Comble de malheur, sa tenue se prend dans l’une des turbines du moulin et la mariée est violemment projetée contre un pilier. Une fin abrupte du deuxième mariage.
La légende veut que, depuis sa mort en 1861, Ann hante le moulin. Celui-ci, toujours en activité, organise chaque année des soirées hantées en mémoire de la jeune infortunée. Hou hou.
Quelques années plus tard, Joseph Merrill Currier s’éprend d’Hannah Wright, elle aussi née d’une famille riche, qu’il épouse en 1868. Pour Currier, Wright sera la bonne…
En guise de cadeau de noces, Joseph fait bâtir une somptueuse résidence non loin du centre de la ville d’Ottawa, au bord de la rivière des Outaouais.
Joseph donne à la nouvelle demeure le nom de Gorffwysfa (prononcé «gore – voïce – va»), un nom gallois signifiant, selon les sources, «lieu de repos», «lieu de paix» ou «havre de paix». Bien… 155 ans plus tard, on peut dire que la résidence est un «lieu de paix», puisque plus personne n’y habite.
La pendaison de crémaillère de Gorffwysfa attire environ 500 personnes, dont le premier ministre John A. Macdonald, qui allait devenir lui-même plus tard un adepte des pendaisons. Hou hou!
Prise en main par le gouvernement fédéral
La résidence devient un endroit où se réunit l’élite de la capitale et des personnalités de passage en ville. Currier meurt en 1884 ; sa femme lui survit jusqu’en 1901. La demeure est alors vendue à un autre grand commerçant de bois, William Cameron Edwards, qui à son décès, en 1921, la lèguera à son neveu.

Justin Trudeau, bébé au 24, promenade Sussex, en 1972, sous le regard de sa mère, Margaret Sinclair, et dans les bras de Pat Nixon, femme du président américain Richard Nixon.
Jusque-là tout va bien, mais dans les années 1940, le gouvernement fédéral convoite le domaine. Ottawa possède déjà presque tous les terrains qui longent la rivière des Outaouais à cet endroit et veut éviter toute exploitation des berges.
En 1943, le gouvernement exproprie la propriété, mais le neveu Edwards s’y opposera vivement pendant quelques années. Le lieu de paix était devenu un objet de discorde, mais au bout du compte, en 1946, le gouvernement obtient gain de cause.
Gorffwysfa devient en 1949 la résidence officielle du premier ministre du Canada. Louis St-Laurent sera le premier à s’y installer, mais on a dû le convaincre. Il était au départ contre l’idée d’une résidence officielle. Il finit par acquiescer, à condition de payer un loyer, une pratique qui se poursuivra jusqu’en 1971, alors qu’un certain Trudeau est premier ministre.
Après le calme, la tourmente
Les années et les premiers ministres se succèdent, et la vie au 24 Sussex y est assez paisible, jusqu’à… jusqu’à ce que, dans la nuit du 5 novembre 1995, un homme – André Dallaire – s’introduise sans frapper dans la résidence habitée à l’époque par Jean Chrétien et sa femme Aline.
Dallaire est armé d’un couteau pliant dont la lame fait une dizaine de centimètres. Arrivé près de la chambre du premier ministre, l’homme est confronté par Aline Chrétien. Celle-ci rentre aussitôt dans la chambre et verrouille la porte. Elle appelle la GRC qui, à son arrivée, trouve André Dallaire toujours sur place et l’arrête.

Vue arrière du 24, promenade Sussex.
Souffrant de schizophrénie depuis l’adolescence, l’assaillant dira par la suite avoir entendu des voix l’ordonnant de tuer Jean Chrétien pour venger la victoire du oui au référendum sur la souveraineté du Québec tenue quelques jours auparavant. Dallaire sera condamné pour tentative de meurtre, mais n’ira pas en prison en raison de son état mental.
Dix-huit ans après l’incident Dallaire, voilà que le 24, promenade Sussex fait l’objet d’une autre invasion : des rats. Les efforts pour régler le problème ont permis de découvrir une quantité de carcasses et d’excréments de rats à l’intérieur des murs, au grenier et au sous-sol.
Avec l’infestation de rats et la présence d’autres problèmes, le débat est encore ouvert à savoir si on injectera les dizaines de millions de dollars nécessaires afin que Gorffwysfa redevienne ce havre de paix qu’il a déjà été ou si on la laissera aux fantômes.