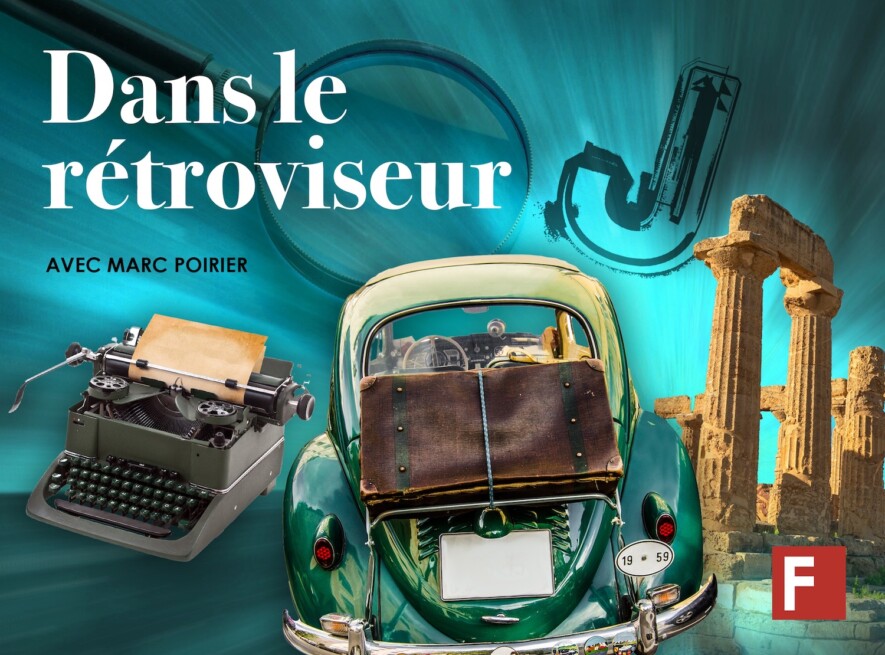L’histoire du train est fascinante. On sait évidemment qu’il a joué un rôle central dans la fondation du pays. Il est intéressant de savoir que les premiers chemins de fer n’étaient pas en fer, mais en bois. Pour les… férus d’histoire, voyons ça de plus près.
La genèse du train : Grande-Bretagne
Les premiers rails font leur apparition en Grande-Bretagne au tournant du XIXe siècle. On ne parle pas encore de «train»; il s’agit plus ou moins d’un charriot sur des rails tirés par des chevaux. Parfois des ânes. Parfois des mules. On reste dans la même famille.

L’ancêtre de la locomotive, la Salamanca, a été construite au début du XIXe siècle, en Grande-Bretagne.
Tout va alors très vite : alors que l’invention sert au départ à transporter de la marchandise, notamment du charbon, du bois, du blé ou des pommes de terre, le premier service public de train pour passagers est inauguré dès 1807 à Oystermouth, dans le Pays de Galles, mais sur une courte distance.
Il faudra attendre 1830 pour la première ligne entre deux villes, soit Liverpool et Manchester. C’est la première ligne également à n’utiliser que des locomotives à vapeur. Exit les chevaux; ils sont désormais interdits.
La locomotive à vapeur avait d’ailleurs été inventée dès 1802 en Angleterre. Les simples rails de bois avaient rapidement laissé leur place à des rails encore en bois, mais revêtus de lisses de fer. On innove en 1820 par des rails en fer forgé. L’ère du véritable «chemin de fer» commence.
Le Bas-Canada, précurseur
Les autres pays industrialisés suivent rapidement les traces de la Grande-Bretagne, d’abord en Europe et en Amérique du Nord, puis un peu partout dans le monde.
Au Canada, le véritable premier chemin de fer est terminé en 1836, entre La Prairie, en banlieue de Montréal, et Saint-Jean-sur-Richelieu (alors appelé Dorchester), au Québec, dans ce qui était à l’époque le Bas-Canada.

La photo emblématique de la pose du «dernier crampon» du chemin de fer du Canadien Pacifique par Donald Smith, l’un des financiers du projet.
Ce n’était qu’un court tronçon de 26 kilomètres, mais comme on dit, petit train va loin. Le projet, financé par nul autre que le brasseur John Molson (oui, celui-là), sera l’un des maillons qui permettra désormais d’acheminer des marchandises de Montréal à New York.
Le trajet est un peu compliqué cependant : du port de Montréal, il faut traverser le fleuve Saint-Laurent jusqu’au port de La Prairie. Les marchandises sont alors transvidées dans des wagons qui partent ensuite pour Saint-Jean-sur-Richelieu.
Arrivées à ce nouveau point de transit, les marchandises sont chargées sur des bateaux, qui descendent la rivière Richelieu, jusqu’au sud du lac Champlain, pour emprunter ensuite le fleuve Hudson, grâce au canal Champlain terminé en 1823. Enfin, les denrées poursuivent leur route sur ce cours d’eau jusqu’à New York.
L’inauguration du premier «voyage», le 21 juillet 1836, a réuni les grandes personnalités du temps, dont le lieutenant-gouverneur du Bas-Canada, Lord Gosford, et un certain… Louis-Joseph Papineau, alors toujours chef du Parti patriote et futur rebelle.
Le tissage d’une toile de fer
Puis, mille après mille, jour après jour, le réseau ferroviaire s’étend au Canada, comme un peu partout dans le monde. Au Canada et aux États-Unis, il jouera un rôle central dans la construction des deux pays.
Le chemin de fer devient si important dans le développement économique qu’il se retrouvera dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB), la loi de 1867 créant le Canada par l’union de l’Ontario, du Québec (formant alors la Province du Canada), le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.

La première locomotive fabriquée au Canada a été construite à Toronto en 1853 par James Good. L’engin no 2, baptisé «Toronto», figure fièrement sur cette photo de 1881.
Si en Ontario et au Québec, le réseau ferroviaire est déjà bien étendu, ce n’est pas le cas dans les deux plus petits partenaires du nouveau pacte canadien.
L’article 145 de l’AANB fait état de la «déclaration commune» du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse et de «l’importance primordiale revêtue par la construction d’un chemin de fer intercolonial pour la consolidation de l’union de l’Amérique du Nord britannique.»
Le chemin de fer sera l’un des enjeux majeurs de l’adhésion de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard à la Confédération canadienne, qui aura lieu respectivement en 1871 et en 1873.
Le chemin de fer Intercolonial qui relie Halifax au fleuve Saint-Laurent sera achevé en 1876. Le défi sera immensément plus grand pour réaliser le tronçon de l’Ouest jusqu’à la côte du Pacifique.
Une entreprise colossale
Le chemin de fer promis à la Colombie-Britannique est un projet gigantesque : 1 600 km et un passage à travers les montagnes Rocheuses. En raison d’un scandale financier et politique qui a forcé la démission du premier ministre John A. Macdonald et de son gouvernement en 1873, les travaux ne s’amorcent qu’en 1881.
La compagnie du Canadien Pacifique réussit l’exploit extraordinaire quatre ans plus tard, avec la célèbre pose du «dernier crampon» le 7 novembre 1885. Le premier train de passagers de Montréal à Port Moody, près de Vancouver, fera le trajet en six jours, du 28 juin au 4 juillet 1886.
Bien plus tard, l’historien et concepteur du drapeau canadien, George F. Stanley, écrira dans un chapitre de The Canadians 1867-1967 : «Des liens d’acier et de sentiment étaient nécessaires pour maintenir la nouvelle Confédération. Sans les chemins de fer, le Canada n’aurait pas existé.»

Plaque commémorative de la construction du premier chemin de fer du Canada.
Mais ce «rêve canadien» a été réalisé à grands couts humains. Plus de 15 000 travailleurs chinois ont participé à la construction du chemin de fer dans les Rocheuses. Une main-d’œuvre bon marché qui a été largement exploitée.
On estime que trois travailleurs chinois ont perdu la vie lors d’accidents pour chaque kilomètre de voie ferrée dans le canyon du Fraser en Colombie-Britannique.
Plus de 200 ans après l’arrivée du «cheval de fer» au Canada, les défis pour la survie de l’industrie sont toujours très grands, particulièrement du côté du service passager.
Alors qu’en Europe et ailleurs dans le monde, le train à grande vitesse a sauvé l’industrie, le Canada se fait tirer l’oreille. Le gouvernement fédéral caresse plutôt un projet de «train à grande fréquence» entre Québec et Toronto, et encore là, il faudra attendre au milieu des années 2030.
Entretemps, le train pourra continuer de siffler sur la colline. Mais peut-être que personne ne viendra…