Cette nuit-là, et les quelques jours suivants, des centaines, voire des milliers de personnes – surtout des hommes – marginalisées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ont décidé qu’elles en avaient assez d’être traitées en parias de la société.

Symbole de la fierté 2ELGBTQI+.
À quoi correspond cet éveil de conscience? Pourquoi cette volonté d’agir réprimée pendant tant d’années a-t-elle explosé à ce moment précis, dans un bar de Greenwich Village, à New York?
La répression s’abattait contre les bars gais depuis le début des années 1960 dans la plus grande ville des États-Unis. Des policiers en civil allaient jusqu’à «piéger» les homosexuels dans des bars en engageant une conversation avec eux et en arrêtant ceux qui leur proposaient de quitter les lieux ensemble.
Persécutés depuis Mathusalem
Évidemment, les États-Unis ne faisaient pas exception dans leur façon de traiter les homosexuels, victimes de persécutions depuis des temps immémoriaux.
Les grandes religions monothéistes y ont été pour beaucoup en considérant l’homosexualité comme abominable et parfois en la punissant de mort. Certaines religions ont aujourd’hui révisé leur position, d’autres pas.
Dans le monde occidental, ce n’est vraiment qu’au milieu du XXe siècle qu’on assiste à un changement de paradigme. Le Royaume-Uni donne le ton en 1957 avec le rapport Wolfenden, qui propose de mettre fin à 400 ans d’illégalité pour les homosexuels.

Le Rapport Wolfenden de 1957 préconise, pour la première fois, la décriminalisation des activités homosexuelles au Royaume-Uni.
La loi sur la bougrerie – la Buggery Act – avait été adoptée en 1533 sous Henri VIII rendant la sodomie punissable de pendaison, une sentence qui a été maintenue jusqu’en 1861.
L’interdiction de pratiquer des actes homosexuels s’est étendue par la suite dans les colonies britanniques, et certains anciens territoires du Royaume-Uni, notamment en Afrique, la maintiennent encore à ce jour.
Dix ans après le rapport Wolfenden, en 1967, le Royaume-Uni adopte une loi décriminalisant l’homosexualité.
Inspiré par ce qui se passait au pays de la reine Elizabeth II, Pierre Elliot Trudeau, alors ministre de la Justice, dépose en décembre 1967 le fameux «bill omnibus», un projet de loi pour moderniser le Code criminel canadien, notamment en décriminalisant l’avortement et l’homosexualité.
Trudeau avait alors lancé cette phrase dont on se souvient encore : «L’État n’a rien à faire dans les chambres à coucher de la nation.» Le projet de loi est adopté en 1969, Trudeau étant devenu entretemps premier ministre du Canada.
Malgré ces avancées, les États-Unis sont alors toujours à la traine dans l’acceptation de l’homosexualité.
En 1952, l’Association américaine de psychiatrie, dans son Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, désigne l’homosexualité comme un «désordre mental» et une «déviation sexuelle» au même titre que la pédophilie. Cette «définition» n’allait être modifiée qu’en… 1974.
Pas surprenant donc qu’à la fin des années 1960, les corps policiers américains sévissaient toujours contre les bars gais.
Greenwich Village, refuge des homosexuels
À l’époque, le quartier de Greenwich Village – ainsi que celui de Harlem – à New York comptait une importante population d’homosexuels depuis plusieurs années. Et le Stonewall Inn était l’un des seuls bars où les homosexuels pouvaient se rencontrer.

Le Stonewall Inn, situé au 53 de la rue Christopher dans le quartier Greenwich Village, à New York.
Environ 98 % de la clientèle était mâle, surtout âgée de 18 ans à la jeune trentaine. On y retrouvait des hommes habillés partiellement ou totalement en femme, des transgenres, des prostitués et quelques sans-abris.
Comme plusieurs bars gais des États-Unis, l’établissement était la propriété de la mafia. Il n’avait pas de permis d’alcool. Ses propriétaires versaient des pots-de-vin à la police afin de rester en affaires.
Cela n’empêchait pas les descentes, mais les propriétaires étaient avertis au préalable par leurs contacts au sein de la police. Or, ce n’est pas ce qui s’est passé dans la nuit du 28 juin 1969.
Vers une heure et vingt du matin, quatre policiers en civil et deux autres en uniforme arrivent au bar. Une fois à l’intérieur, ils verrouillent les portes. Les agents commencent à arrêter des clients et à les entasser dans leurs fourgons.
Ceux qu’ils laissent sortir se regroupent près du bar. D’autres personnes les rejoignent.
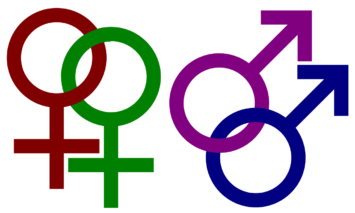
La lutte pour l’acceptation de l’homosexualité a été longue et ardue.
Puis, les policiers sortent avec une femme menottée. Celle-ci se débat avec vigueur et harangue les gens qui se sont amassés autour du bar en leur demandant pourquoi ils «ne font rien».
La colère monte dans la foule, qui a atteint maintenant entre 500 et 600 personnes. Lorsque la police jette rudement la femme dans un fourgon, tout bascule et tourne à l’émeute. Les policiers perdent le contrôle de la situation et certains se barricadent dans le bar où, peu après, un incendie se déclenche.
L’escouade tactique arrive sur les lieux, mais elle est vite dépassée par les évènements elle aussi. Les affrontements violents se poursuivent jusqu’à quatre heures du matin.
Le lendemain, d’autres affrontements éclatent avec la police au même endroit.
Trois jours plus tard, le même scénario se reproduit. Les mécontents se chiffrent alors entre 500 et 1000 personnes.
Dans les semaines qui suivent, des résidents du quartier s’organisent en groupe de revendication pour les droits des homosexuels. En six semaines, trois journaux militants gais voient le jour à New York.

Le parc devant le Stonewall Inn est consacré à la commémoration des évènements du 28 juin 1969.
Dans ce bar plein de garçons pas comme les autres, les policiers de la Grosse pomme n’avaient pas fait face à un mur de pierre, mais de béton.
Il n’y aura plus de retour en arrière. Stonewall a été un moment charnière. Le mouvement pour les droits des homosexuels et des personnes ayant d’autres orientations sexuelles prend rapidement de l’ampleur et ne s’arrêtera plus.
Le 28 juin 1970, des marches de fierté ont lieu à New York, Chicago, San Francisco et Los Angeles pour marquer le premier anniversaire des émeutes de Stonewall. D’autres villes emboiteront le pas autant aux États-Unis qu’ailleurs dans le monde.
En juin 2019, une foule estimée à cinq-millions de personnes marche à New York pour souligner le 50e anniversaire de Stonewall. À cette occasion, le chef de police de la ville a présenté des excuses officielles pour les gestes perpétrés par les forces de l’ordre lors des émeutes de juin 1969.
De quoi être fiers.











