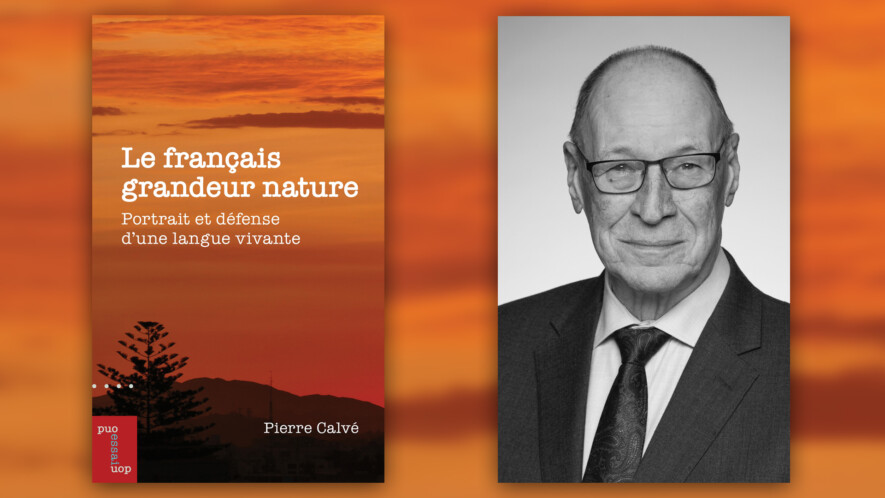Francopresse : Le titre de votre ouvrage contient les mots «langue vivante», «grandeur nature» et «défense». Pouvez-vous expliquer ces choix?
Pierre Calvé : D’abord, «grandeur nature», c’est bien important. Ce mot, ce titre n’a pas été choisi au hasard. Le français est une langue naturelle, c’est-à-dire le fruit naturel d’une évolution de milliers, de dizaines de milliers d’années.
La langue parlée, c’est la langue naturelle. C’est dans la langue de tous les jours, dans la langue spontanée, dans la langue qu’on emploie avec ses amis.
Elle évolue dans le temps, par une évolution naturelle. Elle évolue dans l’espace, selon les lieux géographiques où elle est parlée. Et elle évolue dans la société, selon les classes socioéconomiques, selon l’éducation des gens, selon les niveaux de langue et selon la capacité des individus à être mobiles linguistiquement, c’est-à-dire à ajuster leur niveau de langue aux situations d’usage.
Le français peut aussi bien – et il le fait souvent – se promener en jeans et t-shirt qu’en veston cravate ou en robe de gala.
L’évolution du français au contact d’autres langues, notamment de l’anglais, est-elle un phénomène naturel?
C’est tout à fait naturel.
Une étude de l’Université Laval a montré que, des 60 000 mots du français dans Le Petit Robert, 40 % à peu près ont été empruntés à d’autres langues au cours de l’histoire du français.
L’anglais a emprunté plus de 60 % de son vocabulaire au français pendant les 300 ans de présence du français en Angleterre, sous l’aristocratie. Alors, le français emprunte aujourd’hui et a emprunté à d’autres langues.
Ce n’est pas le fait d’emprunter beaucoup de mots qui fait qu’on s’assimile à l’anglais. C’est le fait de changer de langue, carrément. Alors, le danger, c’est qu’on perde sa langue maternelle parce qu’on adopte l’autre langue. Bien sûr, il y a des emprunts qu’il faut corriger, mais cette espèce d’attitude qu’on parle mal parce qu’on emprunte, non!
Un bon exemple d’emprunt corrigé, c’est qu’en technologie, on dit «on va tester le bogue». «Bug», c’est un mot anglais qui a été francisé par «bogue» et c’est parfaitement acceptable.
Comment la pression de la norme et la hiérarchisation des formes du français renforcent-elles l’insécurité linguistique, notamment chez les francophones en situation minoritaire?
Cette insécurité linguistique, elle existe chez tous les francophones, mais beaucoup chez ceux qui vivent en situation minoritaire.
La norme prescriptive considère qu’il n’y a qu’un seul bon usage, que les mots n’ont qu’un seul sens, et elle a écrasé le français et les francophones depuis très longtemps. On a tous été élevés avec l’impression que notre langue n’est pas le bon modèle.
J’ai beaucoup voyagé au Canada, à donner des cours un peu partout, des stages, des conférences, et souvent des enseignants de français à l’extérieur du Québec s’excusaient de la qualité de leur français. Je trouvais ça absolument incroyable qu’ils s’excusent. Chacun a la langue qui vient de son milieu.
Devrait-on ajouter des mots régionaux dans le lexique courant?
C’est certain qu’il faut mettre des mots régionaux.
Le gros problème qu’on a avec la tradition, par exemple le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française, c’est qu’il se limite au français standard, c’est-à-dire un français qui est dénaturalisé.
Quand [un dictionnaire] nomme qu’un mot appartient au français québécois régional, c’est souvent pour le condamner plutôt que simplement dire que ça appartient au langage familier.
Il y a aussi le français populaire qui est stigmatisé en tant que mauvais français. Si je dis «toi, mon chum, t’es t’après t’amancher pour te ramasser au cimetière», c’est du français folklorique qu’on trouve dans Les Belles-Sœurs, par exemple.
Quelqu’un qui immigre au Sénégal ou dans n’importe quel pays francophone en Afrique, que ce soit en Martinique ou ailleurs, il doit pouvoir s’ajuster aux mots régionaux.
Une langue vit dans son milieu. Par exemple, ici, on dit des tuques et des mitaines. En France, ils disent des bonnets et des moufles. C’est le genre de nuance qu’il faut faire quand on parle de mots régionaux.
Alors est-ce qu’on doit changer de langue? Absolument pas. Chacun son parler.
Il faut plutôt hiérarchiser et montrer l’acceptabilité de la langue selon la situation d’usage, selon les règles de la grammaire parlée, pas seulement écrite, et aussi selon les niveaux de langue soignés lorsque c’est nécessaire et qu’on accepte des niveaux très familiers dans des situations familières. C’est le genre de discernement que je fais beaucoup dans mon livre.
Les propos ont été réorganisés pour des raisons de longueur et de clarté.